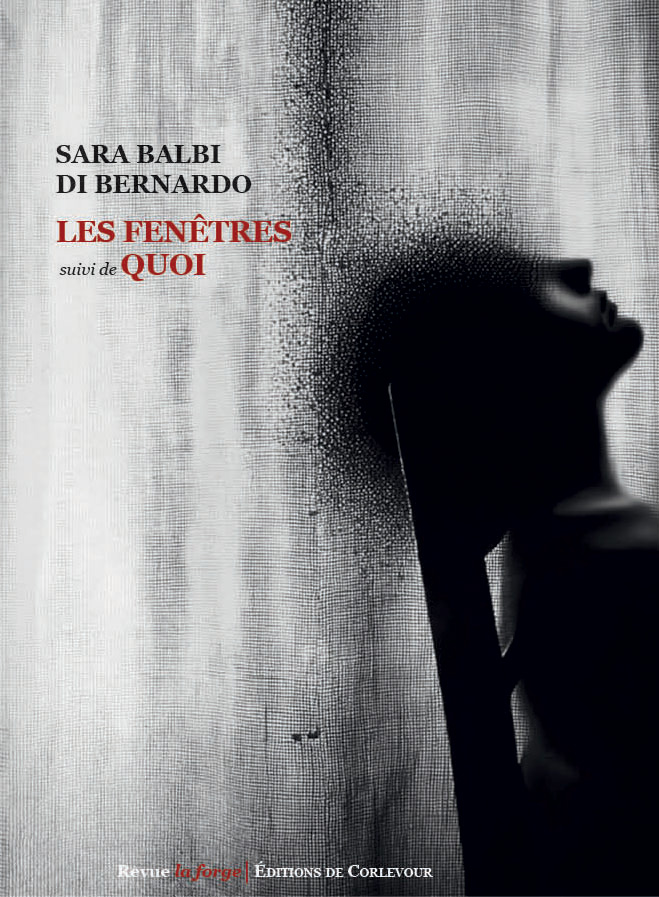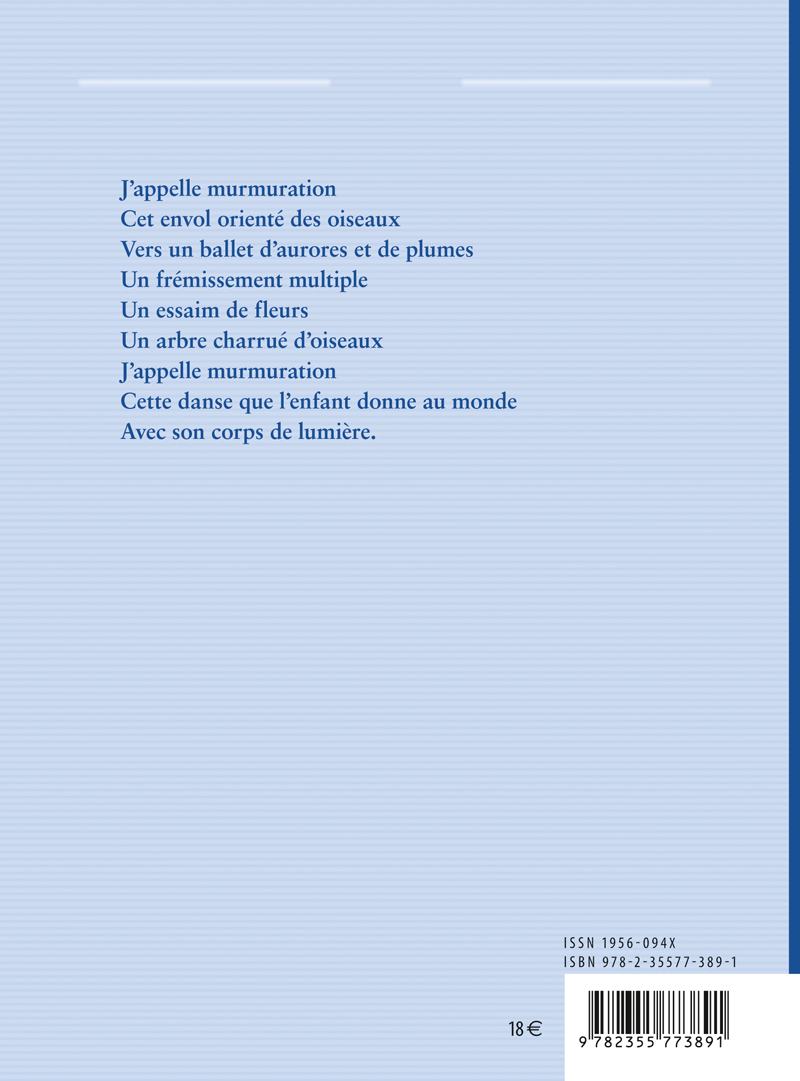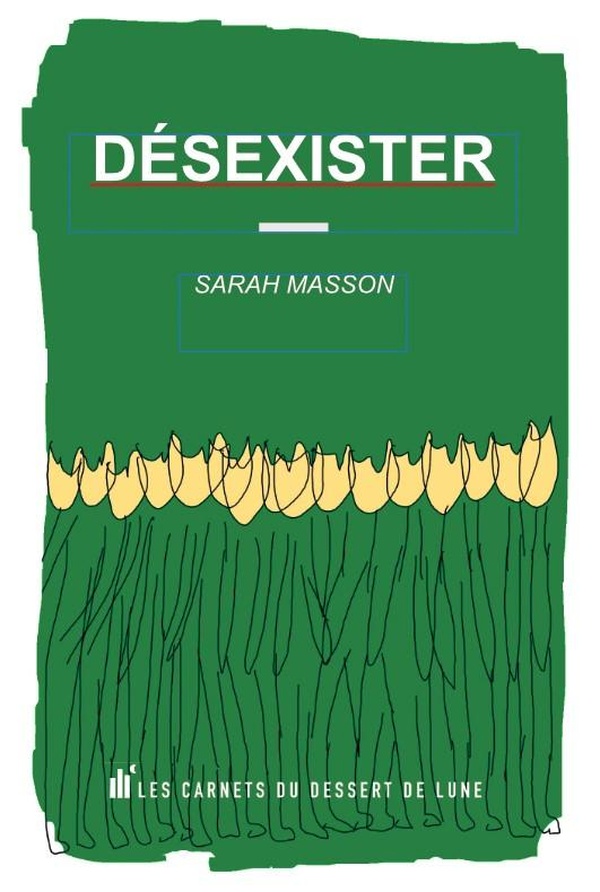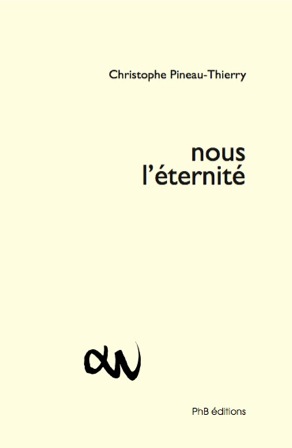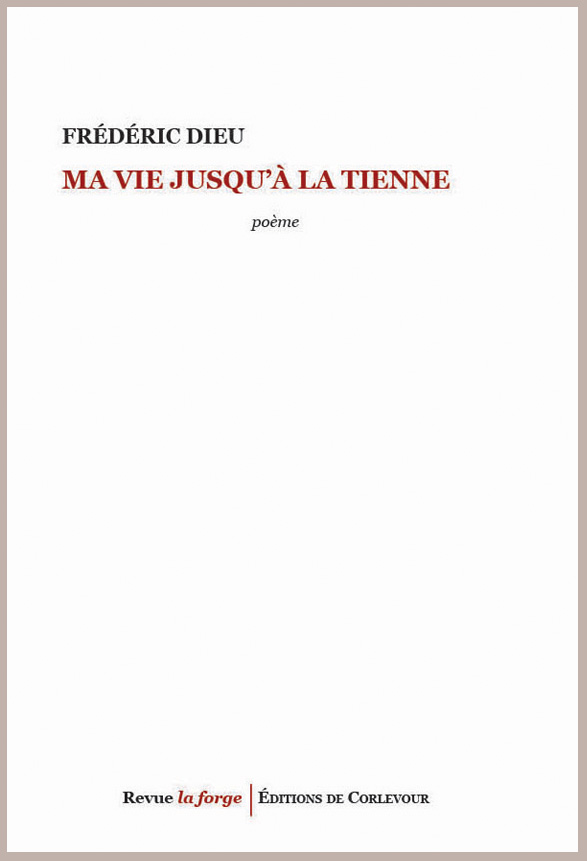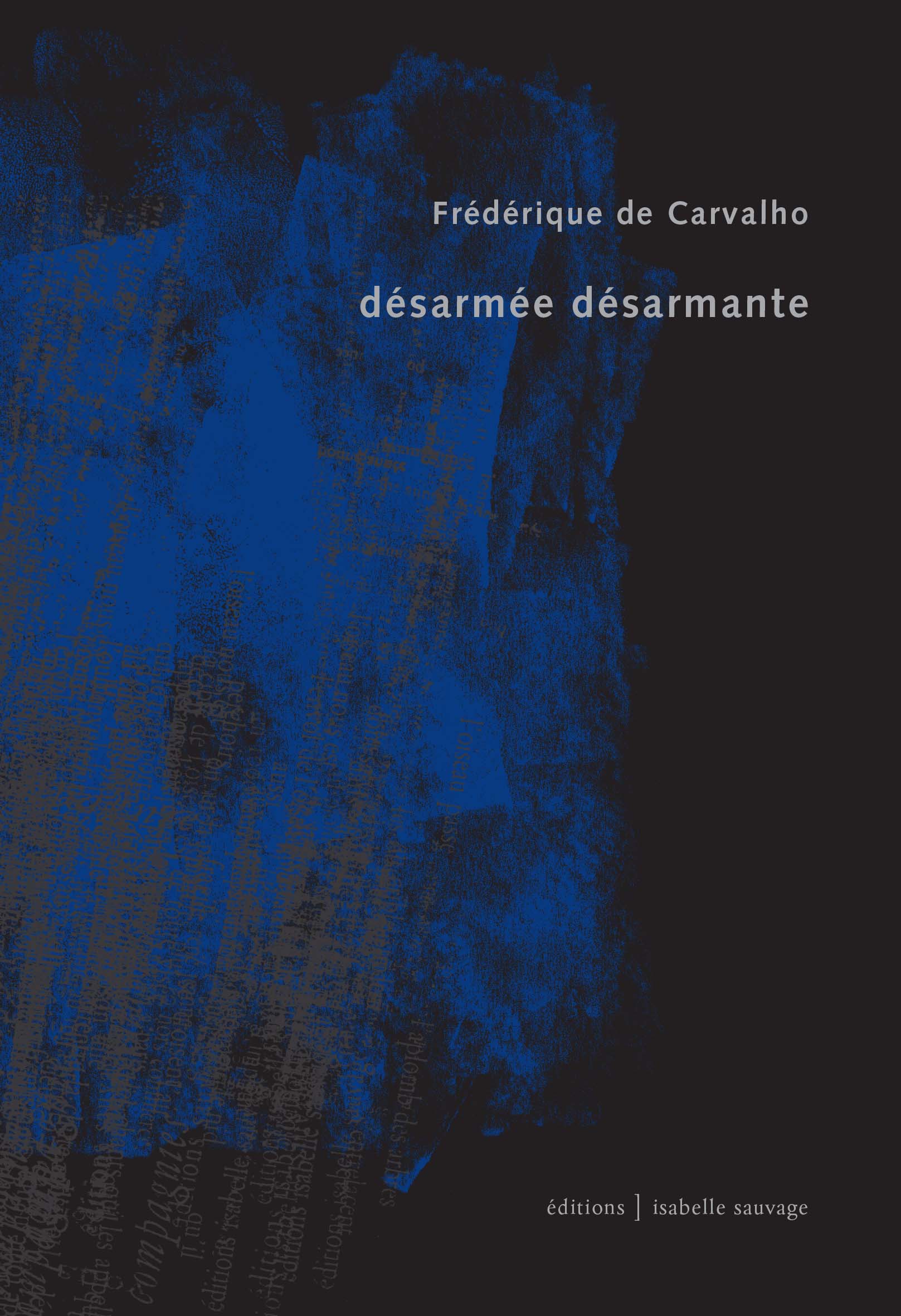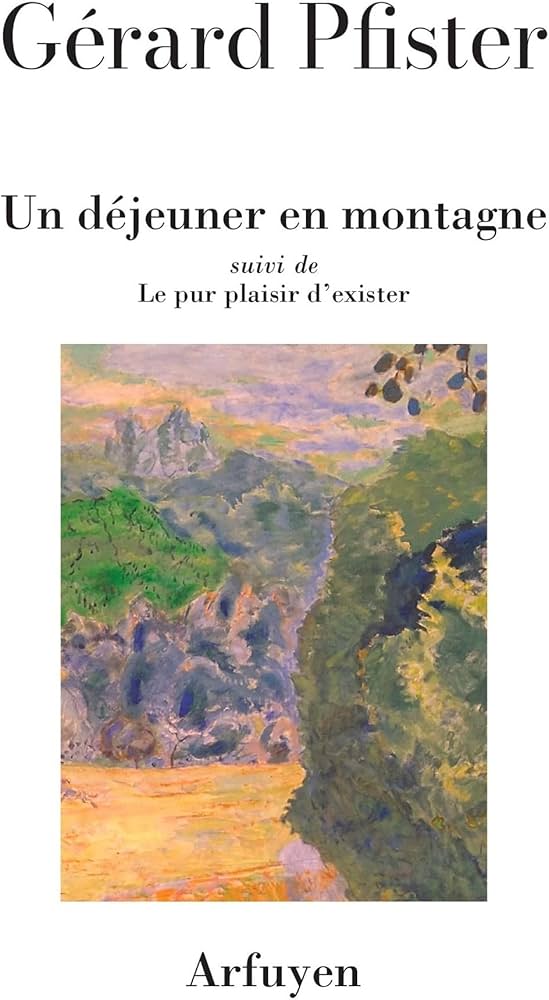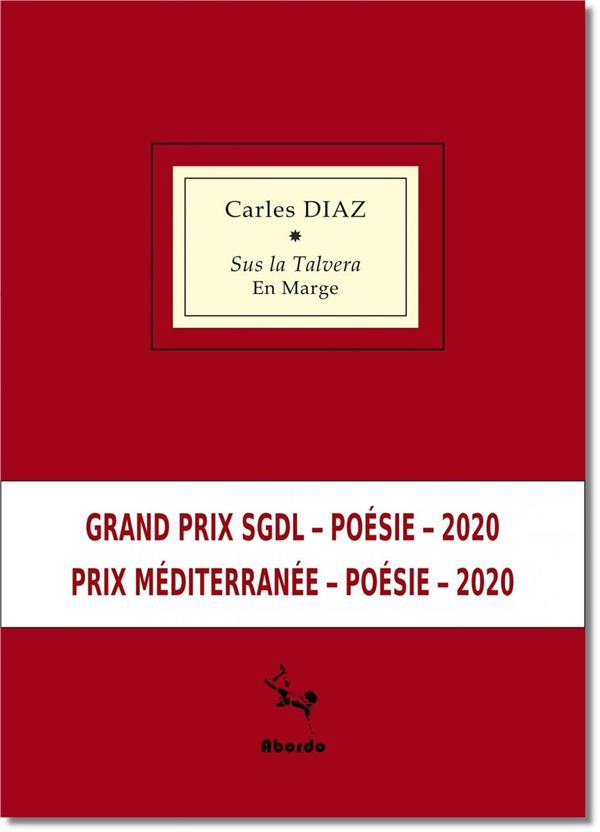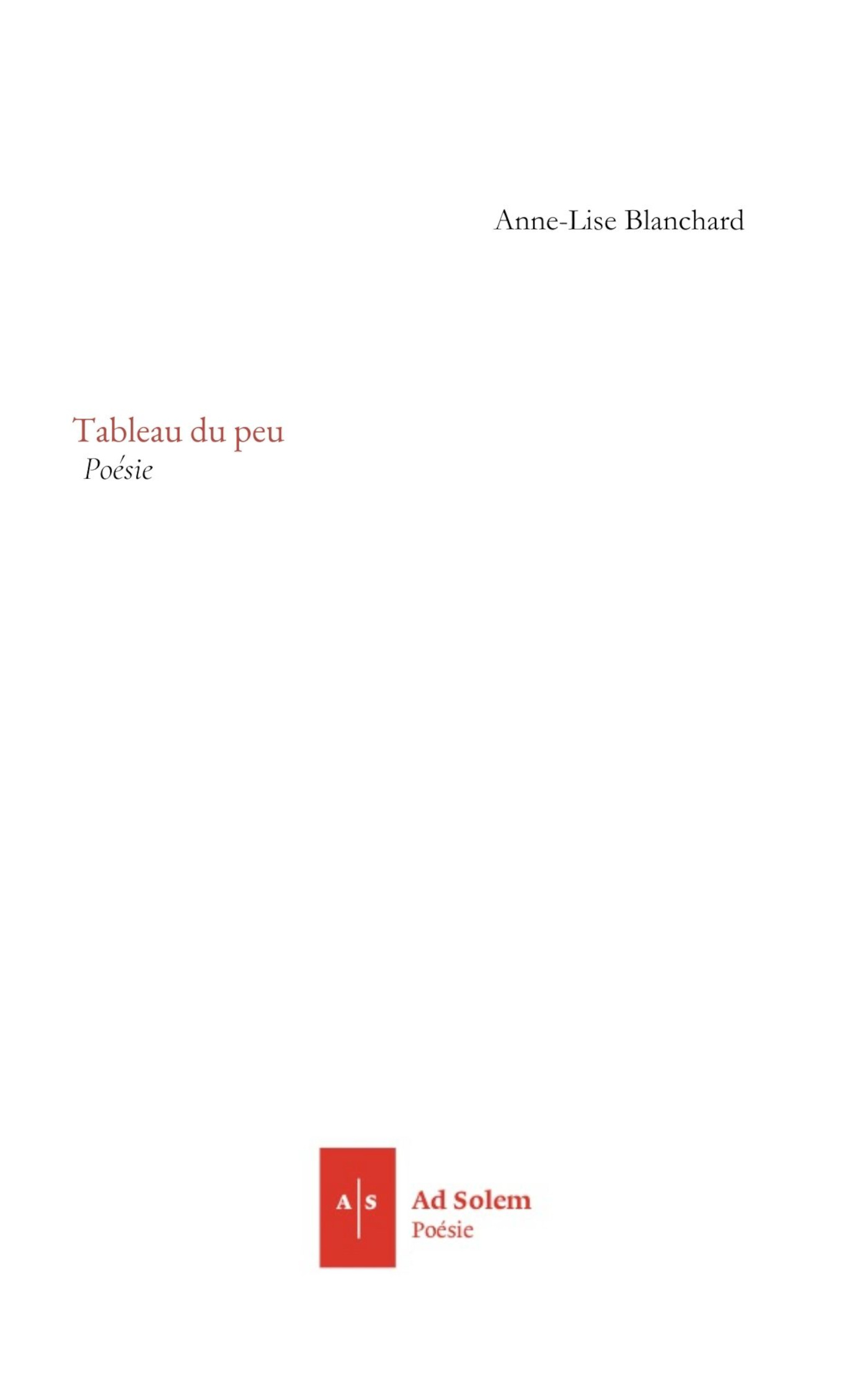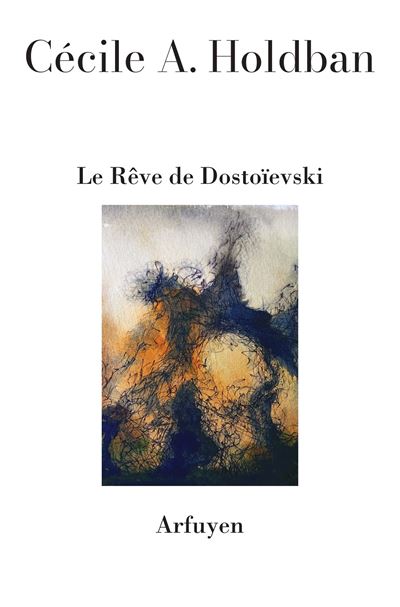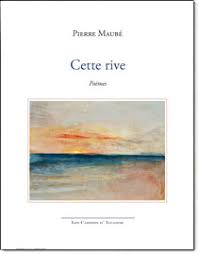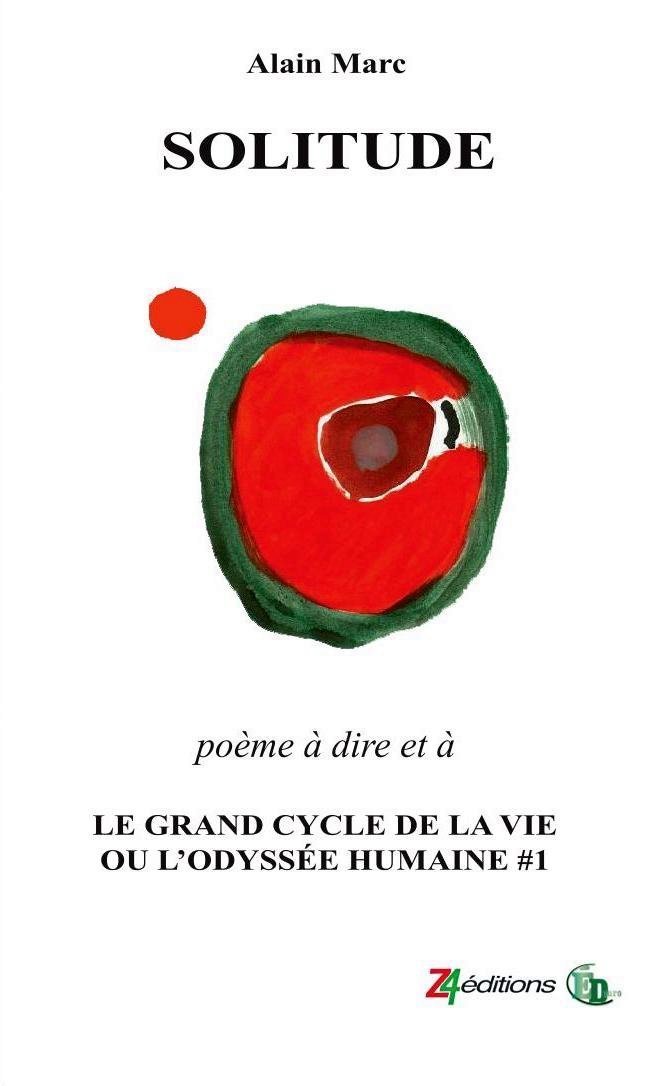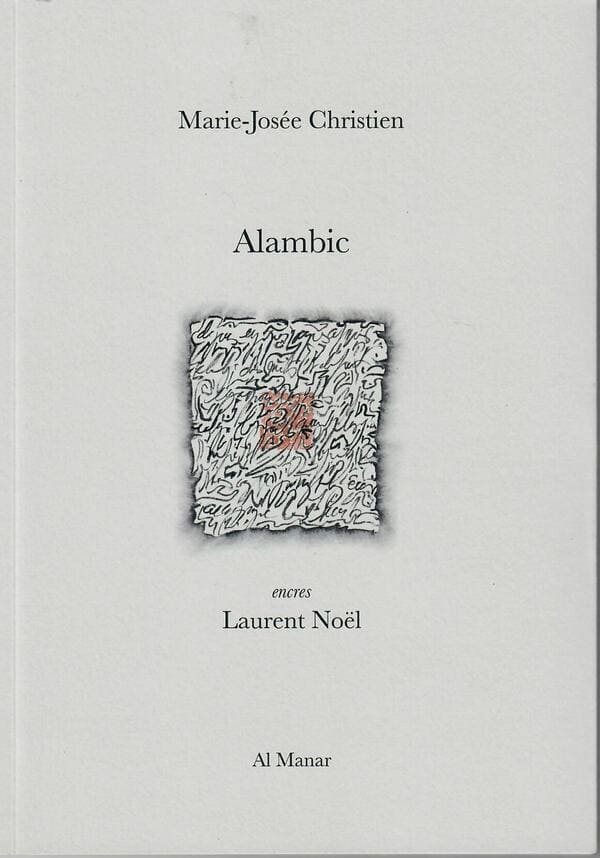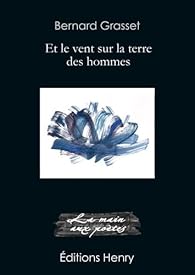l’éros des étoiles s’éteint dans la peur •
et les puits de l’inconscient se dressent
avec leur perplexité pleine de bitume •
Ce nouvel ouvrage d’Ara Shishmanian est en réalité une sélection mise à la disposition des lecteurs francophones dans une traduction de Dana Shishmanian révisée par l’auteur, des trois recueils en roumain du cycle Onirice entamé en 2022. On y retrouvera les mêmes élans dans l’inconnaissable, les mêmes audaces de langage que dans La Létale de la lune(2024). Si les rêves ou plutôt les « rêveries », ces rêves éveillés, sont en effet un matériau courant pour les écrivains, parfois revendiqué comme chez Rousseau ou Gérard de Nerval, il est des poètes – Rimbaud, Lautréamont, les Surréalistes – capables de s’affranchir de toute logique et de transcender la réalité (celle suivant laquelle, par exemple, un chat miaule et n’aboie jamais).
L’exercice est bien sûr difficile, le risque de tomber dans l’abscons, dans l’absurde, le pur non-sens est lui, bien réel, mais quand il est réussi comme chez les auteurs précités leurs écrits obligent le lecteur à sortir de sa routine, accepter un univers où tout est perverti : ce n’est pas seulement en effet, comme dans la littérature fantastique, qu’on y raconte des histoires certes incroyables mais conservant une logique interne, c’est qu’il n’y a même plus d’histoire ni de logique, seulement des images qui défient le sens commun et qui néanmoins – si l’exercice est réussi – « font sens ». Ara Shishmanian, qui préfère pour sa part à « rêverie » les néologismes « arrêve » ou « urrêve », est orfèvre en la matière.
Verbatim :
-
et à nouveau ces regards semblables à des cordes qui nouent mes chevilles • mon index me brûle – et la glace fait fondre le hurlement que j’essaie de montrer • et le couteau se transforme en sourire • et ma grotte attire tous les fruits qui me répugnent • et le vide me guide tel un mort reconnaissant • car le monde n’est que l’entrepôt où se fut empilé tout ce qui m’est dû – tous les objets volés et les vies que je n’ai pu vivre • ou ce zéro-miroir où sont rassemblés tous mes malheurs • et ce chien non négociable dont le fidèle désastre m’a toujours accompagné •

Ara Alexandre Shishmanian, Oniriques, traduction du roumain par Dana Shishmanian et Ara Alexandre Shishmanian, Paris, PHOS (ΦΩΣ), 2025, 156 p., 12 €.
Le texte se présente ainsi, comme une suite de quatre-vingt-dix paragraphes titrés et numérotés scandés par des « • », sans majuscules, avec de nombreux « – », construisant un long poème de vers libres (où l’on préférera peut-être voir plutôt de la prose poétique). Un homme que l’on devine âgé dresse une sorte de bilan de sa vie, dans l’attente de la fin : • oh ! mort, tu me hanterais comme un arbre invisible •
Une telle déréliction s’accompagne de la conviction chez le poète que, si bien entouré qu’il soit chacun d’entre nous est irrémédiablement pris dans la corde violacée de la solitude, […] écho de l’âme profonde, sachant par ailleurs que son pessimisme radical (je prophétise mon angoisse perdue dans le bordel des oublis) englobe l’humanité entière (• toute cette frange toxique de l’autre •) et que l’amour y tient peu de place.
voici la fille absurde avec ses seins blêmes • peut-être morte déjà – émergeant d’un miroir étranger • avec ses seins blêmes et durs – des prunes bizarres que l’on peut mâcher sans fin • et dans l’éclat obscur – le néant brisé où l’oubli avec son mirage trouble semblait me raconter son obscénité timide comme le reste d’un fantasme • et peut-être un soldat – ou deux ou trois – sortaient d’elle avec leurs uniformes rouges de sang • telles des croûtes de pain mâchées par une ultime guerre • des croûtes de pain ou des tablettes de chocolat déflorées •
De rares entractes, d’autant plus précieux, viennent éclairer un univers si sombre :
-
une barque passait à travers ma fenêtre en battant lentement des ailes – qu’elle était douce cette folie d’un sourire • plus douce – bien plus douce qu’un pot de confiture •
On admire, au passage, la trivialité inattendue de la métaphore « pot de confiture » qui clôt le paragraphe 47 (« le chapeau plein les yeux »), à la mi-temps du livre.
Le poète, il est vrai, n’a pas peur des mots et ne recule pas devant les mots crus (bordel, ci dessus), les images directement sexuelles (la fellation des ténèbres ; l’érection de la mer ; la masturbation féministe des tombeaux ; des rivages de sperme ; mon éjaculation, sperme atomique ou enfer échoué ; les hospices m’envoient des folles en robe blanche pour les baiser), les précisions anatomiques (eurydice [sans majuscule] au vagin de lys blanc). Mais il ne s’agit là que de rares notations destinées à prouver que rien n’est interdit pour qui entend brûler la poésie avec des vers.
Si une telle poésie est par essence source d’infinies énigmes, certaines formulations se réfèrent à la science la plus actuelle, telle : • voici une route déchiquetée d’où émergent les franges d’une femme quantique • ou les traces équivoques du chat de Schrödinger • À cet égard, on se référera utilement à la préface de Dana Shishmanian qui révèle la philosophie sous-jacente du recueil, une « méontologie » témoignant d’un monde où rien n’embrasse le commencement de nulle part sur le coussin nostalgique de jamais.
Le lecteur de La Létale de la lune retrouvera ici des obsessions chères au poète, ce titre réapparaissant d’ailleurs au passage : • la fixité de cristal de la panique – de l’étrangère – la létale de la lune qui me regarde avec des yeux de sibylle saccagée • Le mot « lune » revient à maintes reprises, jusqu’à la fin : • hostile s’effondre la lune longuement attendue en féroce solitude •
De même l’adjectif « létal » ou le substantif correspondant : – un mensonge à la létalité gelée • Cependant, comme dans l’ouvrage précédent, c’est le qualificatif « bleu » qui revient avec le plus d’insistance, au détriment des autres couleurs. Je suis malade de solitaire et de bleu […] • et à nouveau le bleu pleure sur mon visage. Il serait sans nul doute intéressant de percer le mystère d’une telle fascination pour le bleu (qui n’est pas que le bleu de l’âme), si cher à Jean-Michel Maulpoix (Une histoire de bleu, L’Instinct de ciel).
Et toi poète, sculpteur de cernes, héraut des dés, pantin onirique […] qui aspire notre chair des mystères, si tu crains peut-être le néant, c’est que tu ne fais pas suffisamment confiance aux livres qui ne sont pas, comme tu le crois, des sources asséchées où nous ne pourrions plus boire que les épis de la sécheresse •
-
le mannequin du poète veille sur l’agonie des syllabes •
Présentation de l’auteur
- Ara Alexandre Shishmanian, Oniriques - 6 novembre 2025
- Jérémie Tholomé, Le Grand Nord - 6 septembre 2025
- Giuliano Ladolfi, Le Journal de Didon / Jurnalul Didonei, traduction Sonia Elvireranu - 6 mars 2025
- Pornographie : le cri de Cédric Demangeot - 20 novembre 2024
- Joël Gayraud et Virginia Tentindo, Les Tentations de la matière, Ocelles - 6 février 2024
- Traductions croisées : Sonia Elvireanu et Giuliano Ladolfi - 21 décembre 2023
- Claude Minière : L’Année 2.0 - 20 octobre 2023
- Jean-Denis Bonan, Et que chaque lame me soit un cri - 6 octobre 2023
- Olivier Larizza, La Condition solitaire - 19 mars 2023
- Sonia Elvireanu, Ensoleillement au cœur du silence - 29 décembre 2022
- Néant rose, Le manifeste poétique de Dana Shishmanian - 29 août 2022