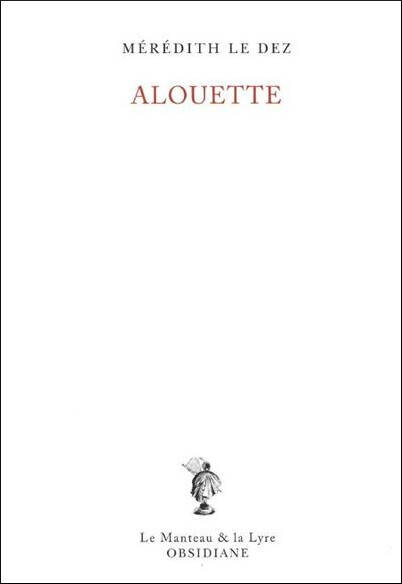Magnifique « petit » livre de Mérédith Le Dez, avec des encres de FloFa qui ne le sont pas moins. Lyrisme on y trouve, mais paradoxalement pour mieux en dégager la pudeur des sentiments. L’auteure invoque la mémoire, elle l’enjoint par ce « souviens-moi », leitmotiv dès l’entrée en matière et toile de fond aux trois autres sections formant le livre. La « Fierté faite femme libre » revendique son statut identitaire selon désormais une « Fierté seul horizon possible ». « Résistance » et « respect » sonnent ainsi comme des appels à la réaffirmation de l’être devant sa condition genrée par les codes établis.

Mérédith Le Dez, Cavalier seul, Editions Mazette, 2015, 10 €.
On pourrait parler ici de réaffirmation transgenre quand « la fierté (et le respect) n’a pas de sexe » et dès lors que le regard sache embrasser le monde avec ses souffrances, « l’horreur sans nom / (qui) ronge à vif / les hommes hurlants depuis / la grotte de leur bouche / cousue de force sur des rats affamés ». C’est d’abord cette « fierté contre le temps » outil d’exploration de ses multiples galeries, en dépit de sa linéarité, qui fait admettre que le bilan d’une vie consiste à tout prendre. « Ce corridor qu’il faut quitter / de mémoire dessine-le ». Pour cette prouesse, Mérédith use de son ascendance dont la fierté déjà « aide à retrouver la mémoire des origines » (thème au cœur de son œuvre (cf livres Polka et Baltique) « L’horizon / est clair / pour regarder / sans mal / la courbe du temps », donnée (métaphorique) d’une vision enfin ajustée. Ajustée car « équanime », autrement dit rapportée avec sérénité et sagesse. Mais qu’on ne s’y trompe pas, cette écriture au couteau rappelle l’âme qui s’élève avec ses tourments (telle qu’une certaine Madame Dickinson). « Le cheval des heures enfuies » avec « à ses côtés (celui) des lendemains / qui auraient chanté » abstraient ensemble toute mesure temporelle contraignante, ou à contraindre par la sagesse donc, indépendamment de l’événement poétique, jusqu’à se dire : « Ce qui a changé : rien ». Et faire « cavalier seul » est une façon de contredire la peur de se perdre sans cheval en s’y confondant, s’y identifiant, en y faisant un (« et moi faisant corps / avec lui »), une façon d’assumer sa lourde masse de vide et de silence restants, même quand « Il est trop tôt pour la question / suis-je tentée de répondre / sans comprendre » affirme Mérédith ; cette question insoluble qui renvoie au « (…) miroir / cet autre que moi / tout aussi étonné / par l’âge énigmatique (…) ce corps cavalier » insaisissable. Ainsi, le pouvoir de continuer de s’étonner toujours est-il un luxe, une poire pour la soif de cette vie, à rebours d’une certaine Emily qui s’y est brûlée. Et cette soif de vie de ce qui résiste devant la vacuité de ses artifices vaut par le plus riche et le plus beau dénuement de celle qui a gagné son âme : « Je porte indistinctement / en lieu de casaque / le manteau pèlerin / sans éclat / qui se confond / avec l’ardoise / l’eau / le silence. » Mais la voix de Mérédith est aussi l’articulation d’une sensualité, dont l’approche hyperesthésique recrée la résonance de l’espace et l’odeur du temps. Même lorsque la nostalgie dans sa nature introspective s’intitule « Noirétable » (4ème et dernière section du livre), boîte noire où puiser des souvenirs que délimitent cartographie (« monts du Forez ») et datation (« 2005 ») pour raviver d’autant mieux des ambiances, des senteurs, des sensations à cru que la poésie aide à traduire rétrospectivement en expérience : « J’ai composé sur le pare-brise / sans le savoir / le poème à venir ». L’éloignement ici, n’écrase pas comme à l’accoutumée les perspectives de la mémoire, dans le geste indomptable d’écriture, au contraire : « Tout dans ma boîte crânienne / remonte comme une marée / d’équinoxe brasse le sel ». Noirétable est mot-valise, quoi de mieux pour un tel voyage. Nostalgie selon sa particularité enrichissante, bilan existentiel avec ses zones d’ombres éclairantes, rêve salutaire devant la haute muraille des questionnements, mémoire originelle entretenant le mythe personnel, telles sont les étapes traversées par la fougue tranquille de Mérédith Le Dez, cavalière seule, tandis qu’elle trace des quatre fers « sur la mappemonde qui tapisse / l’envers de (son) crâne / l’itinéraire familier ».
- Florence Trocmé, P’tit bonhomme de chemin - 31 octobre 2021
- Jean-Claude Leroy, ÇA contre ÇA - 25 septembre 2019
- Marie Cosnay, Eléphantesque, Benoît Reiss, Svetlana - 1 avril 2019
- Les carnets d’Eucharis (portraits de poètes vol. 2) - 5 novembre 2018
- Mérédith Le Dez,Cavalier Seul - 5 mai 2018
- Géraldine GEAY, Les Immaudits - 26 avril 2017