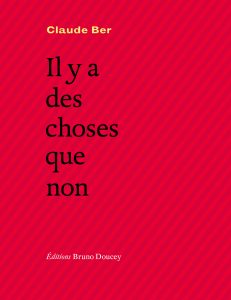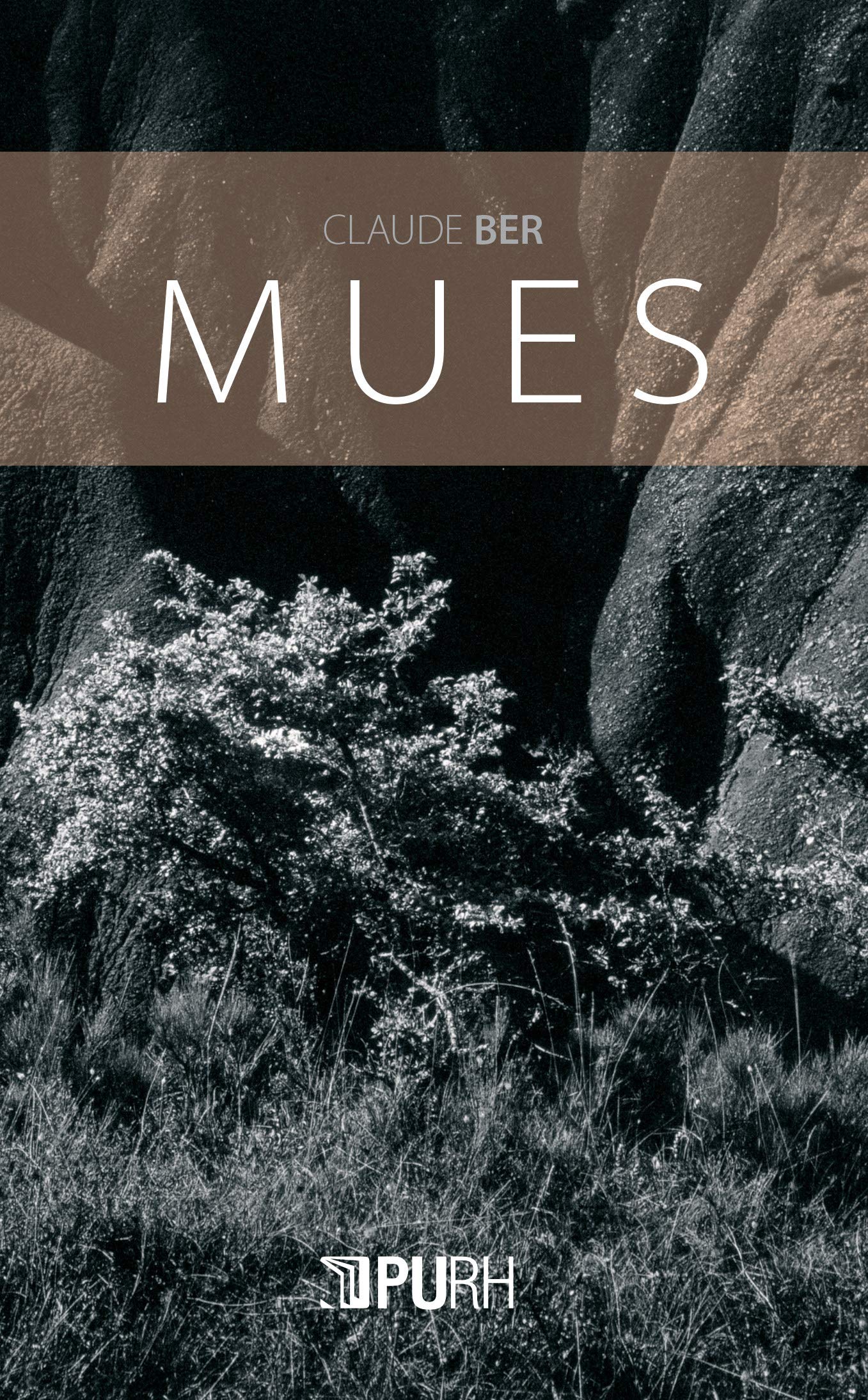Ce recueil, c’est d’abord un titre : « Il y a des choses que non ». Déconcertant, heurté. Comme si la claudication de la phrase venait dire la claudication de ces temps où il est minuit dans le siècle. C’est Louise qui parle, la grand-mère de Claude Ber, paysanne, engagée dans la Résistance FFI et rebelle à tout ce qui humilie. Ce legs qui remonte à l’enfance de l’écrivain dessine une certaine façon d’être au monde, exacerbée aujourd’hui, les raisons de dire non à l’inacceptable s’étant démultipliées.
L’étonnante injonction grand-maternelle cinq fois renouvelée plane sur tout le recueil qui devient caisse de résonance d’autres voix :
du col de la Cayolle aux gorges du Loup
dans ces vallées dont les torrents finissent en bouches
dans la mer
poème se fait d’échos
et de paroles perdues
— comme on dresse la table avec la place du mort
Sept parties en ce recueil, qui mêlent les poèmes en prose, les vers, le narratif selon des tonalités très diverses. Mais toujours une même énergie flamboyante.
C’est d’abord un livre de reconnaissance ; en témoigne l’ouverture, « Le livre la table la lampe » qui fait revivre les hommes de la Résistance à travers les figures en miroir des deux « René », René Char et René Issaurat, le père de la poète, cités dans l’exergue. Magnifique tombeau qui oscille entre tendresse et souffle épique.
Vient ensuite « Célébration de l’espèce », où l’anaphore véhémente, paroxystique nous colle sous les yeux ce que l’homme fait à l’homme. Eros et Thanatos, un combat insupportablement perdu, c’est cap au pire, entre Beckett et Kafka.
« Je ne sais l’Algérie que d’oreille » porte le regard innocent sur cette guerre de l’enfant qu’elle était : les murs barbouillés de slogans, la découverte de la « maisondesarabes », les activités clandestines de ses parents, les exactions devinées par l’enfant.
Dans « L’inachevé de soi », l’ombre de la mort travaille le poème — celle de l’être cher, celle de la nature et de tant d’espèces évoquées. Une opposition entre la joie de jadis et la tristesse face au devenir teinté d’inquiétude ; « l’éternité », souvent évoquée, est impossible à retrouver contrairement à Rimbaud.
« Lisant Lucrèce » trace un compagnonnage avec le poète philosophe du De natura rerum. Résonance contemporaine à son sens de la fragilité universelle, à son recours à la force de l’esprit dans un autre temps de détresse. Désormais, nous dit Claude Ber, l’idée de cosmos est en miettes, dans l’« insensé du sens ».
« Nous tous tant que nous sommes » est le tremblement de voix de la grand-mère avec son accent rude qui n’enlève rien à sa hauteur. Parole rebelle qui engendre, qui communique l’énergie à celle qui s’en souvient quand elle traque les signes de l’obésité mortifère d’aujourd’hui.
« Je marche » pointe dans ce verbe d’action une volonté forte : le monde, certes, nous laisse « apeurés et pensifs » mais la poète refuse une position de surplomb et marche parmi les hommes, dans un mouvement d’empathie profonde.
Nourrie de chacun des imaginaires qui sont familiers à Claude Ber, la vie entre à profusion dans le poème, fécondant sa belle curiosité d’être au monde : le patois de la montagne alpine, troupeaux de chèvres et forêts de mélèzes, Empédocle et la « parole oratoire présocratique », la « cacophonie des écrans » aux milliers de pixels, le moine Citrouille amère et la pensée du Tao, la « rumeur du poème » de Lucrèce et le goût de l’univers mathématique qui fut sa première formation, les vers de René Char, ombre tutélaire de la première partie, Dante récité et transmis par l’aïeule florentine fuyant le fascisme, les slogans pour une Algérie algérienne.
Voix multiples, en situation, qui donnent leur jus nourricier :
il faut un sac à dos pour un bivouac si précaire qu’est vivre. À ce déjeuner sur l’herbe
d’une vie j’ai fait de poésie un plat de résistance
Cet état de refus qui sous-tend le recueil informe au sens fort la parole poétique. Née de l’oralité de la transmission familiale, la parole poétique, chez Claude Ber, s’accomplit dans la voix. Elle est parole vive, poésie à dire, à entendre. Par cette dimension vocale, rythmique, le poème vient du corps, de la gorge, de la voix incarnée dans un souffle et voyage avec ses intonations, ses modulations qui l’animent comme ils scandent l’univers :
Il est dur de dire le simple […]
Mais c’est aussi l’inclinaison abstraite des mains occupées. La transparence du verre sous l’eau bouillante. Le midi mesuré de toute chose à un lever de matin
L’extension du regard hors de la pupille. Et la tête montgolfière qui le suit. Aux nuées. À l’impensable. Au tourbillon des planètes et au clinamen des atomes.
Aux fractals et au ping-pong des neutrinos.
L’éveil l’espace d’une assiette qui goutte sur l’évier. Le satori en lavant la vaisselle.
C’est ici le grain de la voix qui transfigure ce simple geste, faire la vaisselle. Passage à la ligne, fusion du concret, de l’abstrait, audace des associations, voilà, notre perception ordinaire en est changée.
Autre exemple d’originalité de ton : Claude Ber s’élève à la hauteur hardie de la profération : « Célébration de l’espèce », c’est le tragique du chœur antique, revisité par l’ironie romantique. Ici la force du poème tient à la puissance manifeste de son débit, à l’infini recommencement de la litanie :
Comme tous ceux de mon espèce, je voudrais célébrer mon espèce. Car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce.
Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce, la douleur et la jouissance de mon espèce […]
Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce.
Ce qui frappe, c’est que ce recueil se place sous le signe de l’entre-deux. Comme si un flux reliait les réalités, circulait entre les entités qui font monde pour Claude Ber. Entre garrigue lumineuse et paysage urbain, entre écrit et parlé, entre prose et vers, entre hier et aujourd’hui, entre violence et tendresse, entre individu et Histoire, entre corps et pensée, entre énoncé savant et parler populaire, entre philosophie et poésie, pour n’en évoquer que quelques aspects. Il y a là comme un mode d’être qui permet d’approcher cette idée de complexité des choses, transmise par le père et les proches, et de rester fidèle à l’exigence de choix intelligents qu’elle sous-tend :
les miens avaient le sens de la complexité et celui de la nuance […] Fais attention, fillette. Les victimes peuvent aussi devenir bourreaux.
Dans Sinon la transparence, Claude Ber explicite cette tension où s’origine son regard sur les choses : « L’entre-deux est ma résidence favorite ». Comme s’il s’agissait du foyer central autour duquel s’organise l’expérience de vivre.
Claude Ber aime ainsi transgresser les frontières, les cadres, les genres : « l’écart. Faire écart. Au grand écart de la langue. Dans son sillage vertical ». Qu’il soit d’espace, ou de temps, de domaine du savoir, de style, l’écart n’est-elle pas la figure de la liberté prise, du dé-rangement par excellence ?
Il est une figure de style qui revient très souvent dans ce recueil, l’adjectif substantivé, qui illustre justement cet écart :
Je marche dans l’alerte de l’amour et le difficile du temps
La légère hésitation sur le mot, suscitée dans cette tournure de la phrase fait effet de rythme et arrête le lecteur. Soudain, à chacun de ces mots, « l’alerte », « le difficile », quelque chose de concret, d’immédiat, affleure dans une puissance d’apparition. Du coup, l’amour, le temps en prennent une couleur nouvelle. N’est-ce pas la marque même de la création langagière, celle capable de « donner un sens plus pur aux mots de la cité » ?
Claude Ber est tout entière dans cette parole ardemment humaine, ardemment innovante, celle qui nous offre le monde à portée de main pour être découvert.
- Thierry Le Pennec, Le visage du mot : fils - 7 juillet 2024
- Thierry Le Pennec, Le visage du mot : fils - 22 juin 2024
- Pierre Tanguy, Poètes du monde - 6 avril 2024
- Angèle Paoli, Le dernier rêve de Patinir - 30 octobre 2022
- Silvaine Arabo, Capter l’indicible - 5 février 2022
- Jacqueline SAINT-JEAN, Matière ardente - 19 octobre 2021
- Philippe Leuckx, Prendre mot - 5 juin 2021
- Angèle Paoli, Traverses - 5 mars 2021
- Luce Guilbaut, Demain l’instant du large - 30 octobre 2017
- Claude Ber, Il y a des choses que non - 17 février 2017
- Ghislaine Lejard : Si Brève l’Eclaircie - 11 décembre 2015
- Amandine Marembert, Luce Guilbaud, Renouées - 5 janvier 2015
- Nathalie Riera, Paysages d’été - 30 juin 2013
- Pas encore et déjà, de L. Guilbaud - 14 avril 2013
- Paul Morin, Le Jardin de l’orme - 29 mars 2013
- « J’écris dehors », sur Pierre Tanguy - 19 janvier 2013