Préambule persan
Le photographe français Henri Cartier Bresson évoque l’art du portrait comme « le silence intérieur d’une victime consentante ». Sur la photo, cette jeune femme, qui se tient debout au milieu d’une rue de Téhéran, c’est Newsha Tavakolian, dont le nom, à l’instar de celui de sa consœur Shadi Ghadirian, précise, qu’elle est d’origine arménienne. Bien que tchadorisée par le régime politico-religieux, ses gants indiquent qu’il s’agit d’une magnifique combattante, boxant avec Cyrus le Grand, Darius 1er et Xerxès 1er, dans un gant et Tigrane II d’Arménie et David de Sassoun, dans l’autre. Ou encore, Forough Farrokhzâd et Sepideh Gholian dans un gant, Éghiché Tcharents et mon cher Daniel Varoujan dans l’autre : Couleur de sang, me dis-je, — terre rouge, bien sûr, car elle est arménienne ! — Peut-être y frémissent encore des vestiges — de brasiers millénaires… On dénombre, en Iran, depuis le XVIIème siècle du fait des persécutions ottomanes, 202.500 Arméniens chrétiens, auxquels s’ajoutent les 400.000 Arméniens musulmans d’Iran. Les Assyro-chaldéens, l’autre minorité chrétienne d’Iran, ne sont que 25.000. Les Iraniens sont majoritairement musulmans, mais chiites et non pas sunnites à l’instar de 90 % des 1. 575.000 000 musulmans actuels. Et bien sûr des agnostiques et des athées, qui rasent les murs.
Cette jeune femme, c’est aussi Katayoun Afifi, la Perse, dont, en décembre 2013, je reçois un premier message. Pourquoi ? Parce que j’ai publié Ahmad Shamlou, l’une des plus grands poètes iraniens, hélas, méconnu en France, dans la revue Les Hommes sans Épaules. Katayoun a suivi des études de lettres. Elle est férue de littérature, d’écriture et de liberté. Elle me soumet son premier écrit, une nouvelle. Elle écrit le soir, au secret, dans une langue, le français, qui n’est pas sa langue maternelle, aidée d’un dictionnaire. Je suis d’emblée époustouflé par sa détermination et sa performance. Je la lis, la conseille, l’encourage et l’aide de mon mieux. Ses écrits et sa pensée sont très critiques envers la société et le pays dans lequel elle vit. Son courage est grand. Son talent ne l’est pas moins. Je vais l’apprendre en m’intéressant davantage, grâce à Katayoun, à la poésie persane, à l’histoire de l’Iran et à sa culture magistrale : rien n’est plus déterminée, qu’une femme iranienne. Les mollahs et autres ayatollahs, gardiens de la révolution, devraient le comprendre, plutôt que de les oppresser et de les étouffer, à l’instar du pan le plus riche de leur culture, qui ne se limite pas, loin de là, au VIIème siècle, ni à l’année 1979, ni aux contes du Shah perché, pour détourner un titre fameux de Marcel Aymé.

Autoportrait de Newsha Tavakolian in film-documentaire Focus Iran (Arte France, Terra Luna Films, Harbor Films, Avrotros, 2017) de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa.
L’Iran, le pays de Katayoun, est méconnu. Il est souvent réduit à des images fausses ou arrêtées, qui circulent sur son compte. Un poète me dit récemment qu’Hâfez est son poète arabe préféré. Mais, non. Hâfez, n’est pas un poète arabe, mais persan, à l’instar de son peuple et de ses descendants, qui vivent en Iran. Lesquels ne parlent pas l’arabe, mais le farsi, le persan, qui fait partie du groupe indo-iranien de la famille des langues indo-européennes.
Cette langue s’écrit au moyen de l’alphabet arabo-persan, variante de l’alphabet arabe, bien qu’elle n’ait aucune parenté avec la langue arabe, dont elle diffère tant sur le plan de la grammaire, que de la phonologie. L’Iran n’est pas un désert et ne ressemble ni à Abou Dabi, ni à Dubaï, et autres pays des Émirats arabes unis. L’Iran est un pays montagneux, dominé par plusieurs chaînes de montagnes, qui séparent divers bassins et plateaux. Le sommet le plus haut de l’Iran, le mont Damavand, culmine à 5.610 m.
L’Iran n’est pas né en tant que pays le 11 février 1979, lors de la révolution islamique. L’Iran est l’un des plus anciens berceaux civilisationnels du monde, habité par les Élamites dès le IVe millénaire av. J.-C. Unifié par les Mèdes, le territoire constitue l’un des plus vastes empires à avoir jamais existé, s’étendant de l’est de l’Europe à la vallée de l’Indus sous le règne des Achéménides, ainsi que le plus important foyer du monothéisme zoroastrien pendant plus de mille ans. Régnant à partir du IIème siècle de notre ère, les Sassanides érigent l’Empire perse au rang de grande puissance de l’Asie de l’Ouest pendant plus de quatre cents ans. Au IIIème siècle, sous la dynastie sassanide, apparaît le mot Ērān ou Ērānšahr, qui signifie « royaume des Aryens » ou « pays des Iraniens ». Les Iraniens sont des bâtisseurs, comme le furent les Grecs et les Romains. Les pierres de Persépolis sont le symbole de la grandeur de la Perse.
Persépolis (la cité perse), n’est pas seulement une série de romans graphiques (2000 à 2003) et le titre d’un film (des chefs d’œuvre, soit-dit en passant) de Marjane Satrapi. Mais, la grandiose capitale de l’Empire perse achéménide, dont l’édification commence en 521 av. J.-C. sur ordre de Darius 1er. La construction de Persépolis se poursuit pendant plus de deux siècles, jusqu’à la conquête de l’empire et la destruction partielle de la cité par Alexandre le Grand en 331 av. J.-C.
Les femmes sont obligées sur bien des points. Mais pas sur celui de devoir porter la burqa (comme en Afghanistan, sous le joug des Talibans), mais le foulard (hidjab). C’est déjà de trop. Les Iraniennes ne sont pas toutes des « chauves-souris » enroulées dans un tchador noir. La femme iranienne, à défaut d’être libre, est résistante, créative, cultivée, intelligente, sensuelle et élégante. Marjane Satrapi ajoute, pour différencier l’Iran des régimes arabes et aussi de l’Afghanistan (qui n’est pas davantage arabe, que ne l’est l’Iran), en 2015 : « Je ne suis pas fan de la république islamique, et je ne peux même pas retourner dans mon pays. On ne me fera donc pas de procès d’intention. En revanche, il ne faut pas confondre Talibans et Iraniens. En Iran, le régime n’a jamais interdit aux filles d’aller à l’école. Au contraire, même notre prof de religion nous disait que le Prophète voulait que les filles soient éduquées. 60 % des étudiants en Iran sont des filles, et pas uniquement dans le secteur des sciences humaines, mais aussi en ingénierie ou en médecine… Là-bas, j’avais un foulard sur la tête, une clope au bec, et je conduisais une jeep de la Seconde Guerre mondiale. J’ai mis des baffes à des hommes, j’ai écouté les Rolling Stones. Personne ne m’a empêchée de faire ça. Je pense que les États-Unis, certes trop tard, ont enfin compris que les fondements de Daesh se trouvaient en Arabie saoudite. Pour les wahhabites, les plus grands ennemis sont les chiites, qui sont encore plus mal vus que les non-croyants. Finalement, l’ennemi de vos ennemis devient votre ami… En Iran. Vous avez une vraie classe intellectuelle, une culture. Et il y a des femmes chauffeurs de bus. Ça n’a jamais été interdit. »
À ne parler, à propos de l’Iran, comme nous le faisons trop souvent en Europe, que des mollahs et des « chauves-souris » de Téhéran, qui ne décollent jamais du sol… Nous passons à côté de l’autre réalité de ce pays, qui n’est pas entièrement voilé de noir, puisqu’il se dévoile (comme de nombreuses femmes et jeunes femmes y aspirent, à l’instar de Katayoun) dans le rouge odorant du parfum des roses de Shiraz. Cet Iran-là, n’a rien d’un mollah. Il est dans la prose et le sourire de Katayoun. Dans la poésie d’Hâfez, de Khayyam, de Nima et de Shamlou. Dans la peinture de Farideh Lashai, Behjat Sadr et Marjane Satrapi. Les images de Newsha Tavakolian et de Shadi Ghadirian. L’Iran, c’est la lèpre de la maison noire, qu’embrasse les lèvres couleur carmin de la sublime Forough Farrokhzâd. C’est Sepideh Gholian, vingt-sept ans, féministe et défenseuses des droits du travail, debout, dans une prison dont elle défonce les murs… Bref, l’Iran dépasse le cadre de la propagande étatsunienne ou des gardiens de la révolution islamique : c’est un monde, une civilisation et une pléthore de poètes, de femmes, du Xème siècle à nos jours.
Cette jeune femme, qui se tient debout, au milieu d’une rue de Téhéran. C’est Katayoun. C’est la femme iranienne. C’est la photographe Newsha Tavakolian. L’une des plus brillantes photographes iraniennes, avec Shadi Ghadirian (née en 1974) etTahmineh Monzavi (née en 1988). Leur travail est centré sur les femmes iraniennes de leur génération. Newsha Tavakolian (née en 1981) nous dit : « Les artistes évoluent sur un terrain miné. L’impact que peut avoir une photo documentaire sur une société telle que l’Iran est immense. » La photographe Tahmineh Monzavi, arrêtée et emprisonnée pendant un mois en 2012, ajoute : « Dans la société iranienne, si on s’arrête aux apparences l’essentiel nous échappe ; il faut creuser pour comprendre les choses. » La photographie, comme la poésie, démocratise les possibilités d’expression mais son utilisation est parfois entravée par la censure étatique.
La série « Like everyday » (Comme chaque jour), de Shadi Ghadirian, a été réalisée en 2001–2002. Elle est consacrée au tchador, qu’elle photographie, isolé, non porté, avec, à l’emplacement du visage, des objets fonctionnels domestiques (balai, fer à repasser, théière, etc.) Dans cette série de portraits, Shadi Ghadirian évoque le travail quotidien des femmes, et leur asservissement, comme un sujet social : « Les hommes les critiquaient ces photos. Longtemps, on m’a fait le reproche d’avoir offensé les femmes. C’était curieux, ce jugement venait de la part des hommes, ceux qui ne s’étaient jamais inquiétés des affronts faits aux femmes. Ils ont peut-être été dérangés par le regard masculin sur les femmes, que contenaient ces photos… J’ai subi tant d’injures, à cause de ces photos, qu’aujourd’hui plus rien ne me trouble. C’était d’ailleurs la seule série, qui a fait tant de bruit. Elle était l’enjeu d’un conflit. Les féministes l’applaudissaient vivement… J’ai rencontré de nombreuses activistes des droits des femmes, qui sont parmi les plus célèbres et travaillent aux quatre coins du monde.

Shadi Ghadirian : Série Like Everyday (Comme chaque jour), 2000–2001.
Quand je photographiais cette série, je pensais être en train de parler de moi-même. Mais plus tard, j’ai compris qu’une fois exposées, ces photos apparaissaient comme une tribune et permettaient de parler, par exemple, des droits de la femme… Quand je rencontre la maltraitance à l’égard des femmes ou lorsque ma propre existence connaît des vicissitudes j’ai envie de faire des photos. »
Citons encore, leur aînée, Shirin Neshat (née en 1957 et vivant en exil aux USA). En 1974, Shirin Neshat part aux États-Unis afin d’y accomplir des études d’art. En 1990, lors d’un retour en Iran, elle est impressionnée par les effets de la révolution islamique de 1979 sur la condition féminine. Shirin Neshat commence par réaliser des séries photographiques : « Unveiling » (dévoilement), en 1993 ; « Women of Allah », en 1994. Dans ses portraits ou autoportraits, toutes les femmes portent un tchador. Tracés directement sur les tirages, des textes énigmatiques en calligraphie farsi recouvrent invariablement les parties visibles de ces femmes voilées.
Les roses de Shiraz
À Shiraz la Magnifique, on peut encore vivre. Mieux que dans le reste du pays, me dit Katayoun. La mentalité est différente. L’oppression, réelle, l’est moins qu’ailleurs. Il y a aussi davantage de brassage. Le devons-nous aux roses ? Katayoun ajoute que c’est à Shiraz, que l’on trouve les plus belles femmes d’Iran ! Mais, comment une shirazi pourrait-elle dire (humour) autre chose ? Katayoun Afifi est originaire de Shiraz, au Sud-Ouest de l’Iran, la ville du grand poète persan du XIVème siècle, Hâfez. Khâjé Hâfez Shirâzi est né (en 1325) et mort (en 1389), à Shiraz, à l’âge de 64 ans, au terme d’une vie dont nous ne savons, que peu de choses. Il mène une vie sédentaire et ne quitte Shiraz, qu’à deux reprises. Son mausolée est un lieu de « pèlerinage poétique. » Ici à Shiraz bat aussi le cœur de Saadi (1210–1292), poète et conteur persan, l’auteur du Golestan (« Jardin de roses »), du Boustan (« Jardin de fruits ») et du Livre des conseils.
Ici à Shiraz bat le cœur d’Hâfez et de la rose, symbole d’Ishtar, divinité de la beauté et de l’amour. La rose de Shiraz connaît une renommée mondiale à travers la poésie, la tapisserie ou le parfum. Hâfez, lui-même, voit la rose « comme investie d’une âme, comme fiancée aimante, et il pénètre en esprit profondément dans l’âme de la rose ».
Ici à Shiraz bat le cœur l’Iran, puisque la ville remonte aux Élamites, vers 2.000 avant J.-C. Persépolis, le plus important site archéologique d’Iran, est situé à 50 kilomètres.
Ici à Shiraz, bat le cœur de celle, que nous appellerons par le pseudonyme de son choix : Katayoun Afifi. Ses actions, sa pensée et ses écrits la mettent en danger dans le pays dans lequel elle vit. La poésie, comme le dit le poète et traducteur Reza Afchar Naderi, dès qu’elle touche des privilèges, des dogmes, des valeurs établies, devient une menace pour son auteur. Il suffit qu’un poème « balance » un nom ou un statut, synonymes d’abus ou d’injustice, pour que le poète se retrouve dans la ligne de mire des détenteurs du pouvoir. Je ne peux donc dire, que le minimum, à son sujet.

Shirin Neshat : Offered Eyes (1993) contains lines from the poet Forough Farrokhzad.
Katayoun a trente-cinq ans, née en 1986, dans une famille moderne, ouverte et tolérante. Katayoun vit dans un pays où laLoi en vigueur, depuis la révolution islamique de 1979, impose aux femmes, qu’elles soient iraniennes ou étrangères, et quelle que soit leur religion ou croyance, de sortir la tête voilée et le corps couvert d’un vêtement ample plus ou moins long. Katayoun Afifi risque de subir de graves conséquences, si elle ne respecte cette « Loi ». Dès qu’elle quitte son domicile, son corps et ses vêtements sont jaugés. Elle doit se soumettre à des « contrôles de moralité » : des agents de l’État jugent si sa tenue est conforme ou non au code vestimentaire, qui s’applique aux femmes. Si ce n’est pas le cas, elle risque d’être arrêtée, voire torturée et condamnée à une peine d’emprisonnement ou de flagellation, comme en témoigne Amnesty International (in La législation abusive imposant le port du voile régit la vie des femmes, 2019). Cette réalité n’est pas seulement celle de Katayoun Afifi, mais celle de millions de femmes et de jeunes filles en Iran. L’État exerce un contrôle fort sur leurs corps. Les femmes et les jeunes filles – dès l’âge de sept ans – sont obligées de couvrir leurs cheveux d’un foulard. Celles qui ne le font pas sont traitées comme des criminelles. La police des mœurs surveille l’ensemble de la population féminine, soit 40 millions de femmes et de jeunes filles, de ce pays de 80 millions d’habitants. Les agents parcourent la ville en voiture pour examiner la tenue des femmes : ils évaluent le nombre de mèches de cheveux qu’elles laissent apparaître, la longueur de leur pantalon, de leur manteau et la quantité de maquillage qu’elles ont appliquée.
Alors, chaque jour, avant de sortir de chez elle, une jeune femme comme Katayoun Afifi doit décider des risques, qu’elle est prête à prendre. Exercer sa liberté et porter ce qu’elle veut, ou faire le choix de la « sécurité », pour éviter d’être arrêtée, agressée ou interdite d’entrée sur son lieu de travail ou à l’université. Le fait d’être vue en public sans foulard peut entraîner diverses sanctions : arrestation, peine d’emprisonnement, flagellation ou amende, au seul motif, que l’intéressée a exercé son droit de choisir comment s’habiller. Même lorsqu’elles couvrent leurs cheveux d’un foulard, les femmes peuvent encore être considérées comme en infraction à la législation sur le voile obligatoire, si quelques mèches dépassent ou si leurs vêtements sont jugés trop colorés ou trop près du corps. Il existe d’innombrables récits de femmes giflées par la police des mœurs ou rouées de coups de matraque et jetées dans des fourgons, en raison de leur tenue. Mais il y a pire : la législation discriminatoire et dégradante, qui impose le port du voile, permet non seulement aux agents de l’État, mais aussi aux malfrats et aux membres de groupes d’auto-défense, de harceler et d’agresser les femmes en public. Ainsi, les femmes et les jeunes filles sont confrontées quotidiennement à des étrangers (des hommes et des femmes), qui les battent ou les aspergent de gaz poivre, les traitent de « putes » et les obligent à baisser complètement leur foulard, pour que leur chevelure soit couverte.
Mais, à compter du 27 décembre 2017, une jeune femme, Vida Movahed, est photographiée, juchée sur une armoire électrique, son foulard blanc accroché au bout d’un bâton. La tête nue, visible de tous, sur une grande avenue de la capitale, elle est aussitôt arrêtée et libérée un mois plus tard. La contestation inédite est lancée. Les photos se multiplient sur les réseaux sociaux. Un mouvement grandissant contre le port obligatoire du voile a émergé en Iran. Debout dans des lieux publics, des femmes agitent silencieusement leur foulard au bout d’un bâton. Elles diffusent des vidéos où on les voit dans la rue, la tête découverte. Des hommes ont aussi rejoint le mouvement, ainsi que des femmes, qui portent le hijab par choix. Katayoun Afifi appartient à cette génération de jeunes femmes insoumises. La force de ce mouvement terrifie les autorités iraniennes, réagissent en lançant une répression sans merci : arrestations, parodies de procès, tortures et condamnations à des peines d’emprisonnement ou de flagellation.
Nasrin Sotoudeh, avocate spécialiste des droits humains, a été déclarée coupable, en mars 2019, à l’issue de deux procès manifestement iniques. Elle est condamnée au total à 38 ans et six mois de prison, ainsi qu’à 148 coups de fouet. Opposée au port obligatoire du voile, même en prison, Nasrin Sotoudeh retire son foulard. Le contrôle exercé sur le corps et la vie des femmes en Iran ne se limite pas aux choix vestimentaires. C’est l’aspect le plus visible et l’un des plus choquants de l’oppression plus générale, dont les femmes sont victimes, et il attise les violences à leur égard. La poète iranienne Maryam Haidari (née en 1984), qui vit entre Téhéran et Beyrouth, témoigne (in Les Inrockuptibles, 2019) : « Je viens d’Ahvaz, une petite ville dans le sud du pays. Les valeurs traditionnelles y sont toujours très présentes : une femme se doit d’être vertueuse et de rester à la maison. Moi, j’ai toujours refusé cela. J’ai toujours essayé d’être forte face à ce que les hommes disaient ou ce qu’on attendait de moi. Mais, c’est très difficile car tout homme, connu ou inconnu, a le droit d’avoir un avis sur le comportement des femmes, même dans la rue. Concrètement, ce pays est une grande « famille », qui surveille constamment nos faits et gestes. Ce sont nos oncles, nos frères, qui nous disent ce qu’on a le droit ou non de faire. Ils peuvent nous interpeller à tout instant, pour nous critiquer et dicter notre conduite. » Les femmes se heurtent, en Iran, à une discrimination solidement ancrée dans la législation, notamment en ce qui concerne le mariage, le divorce, l’emploi, la succession et l’accès aux fonctions politiques.

Shirin Neshat : Rebellious Silence (1994).
Les religieux conservateurs estiment que le travail des femmes à l’extérieur du foyer ne doit être autorisé, que s’il s’avère nécessaire pour la survie de la famille et à condition d’être au service exclusif de la population féminine. La violence domestique, le viol conjugal, le mariage forcé ou précoce et autres formes de violences faites aux femmes et aux jeunes filles, ne sont pas passibles de sanctions pénales et restent répandus. L’âge minimum légal du mariage, pour les filles, nous renseigne encore Amnesty international, est fixé à 13 ans. En outre, un père ou un grand-père peut obtenir du tribunal l’autorisation de marier sa fille ou petite-fille encore plus jeune. Selon des chiffres officiels, quelque 30.000 jeunes filles âgées de moins de quatorze ans sont mariées chaque année. La peine de mort reste une pratique courante, avec notamment 246 personnes exécutées en 2020. Elle est par ailleurs de plus en plus utilisée comme instrument de répression politique contre les manifestants, les dissidents et les membres de minorités.
31 juillet 2011 : La jeune Iranienne Ameneh Bahrami, 30 ans, aveuglée et défigurée à l’acide, a pardonné à son agresseur et renoncé à l’application de la loi du talion, prévue par la charia (loi islamique), en vigueur en Iran. Majid Movahedi a été condamné en 2008 à être aveuglé par le versement de gouttes d’acide dans les yeux, pour avoir défiguré et aveuglé en 2004 Ameneh Bahrami, qui refusait ses demandes en mariage. La peine d’aveuglement de Majid Movahedi a été confirmée en 2009 par la Cour suprême, qui a également confirmé en décembre 2010 une condamnation similaire d’un homme reconnu coupable d’avoir aveuglé à l’acide l’amant de sa femme. Plusieurs attaques à l’acide ont été signalées ces dernières années en Iran, et la presse a soutenu Ameneh Bahrami en publiant notamment des photos de son visage avant et après, qu’elle soit défigurée. Ce « châtiment cruel et inhumain équivalent à un acte de torture », a été dénoncé par Amnesty International. La loi du talion est le plus souvent appliquée en Iran pour des affaires de meurtres. La famille de la victime doit demander expressément son application, qui est ensuite laissée à l’appréciation du juge. Ameneh Bahrami a expliqué à l’agence Isna qu’elle avait « lutté pendant sept ans pour obtenir ce verdict », mais a décidé d’accorder son pardon à la dernière minute parce que le verset du Coran sur le talion « dit qu’il faut pardonner. Je l’ai aussi fait pour le calme de ma famille, et également pour mon pays car apparemment tous les autres pays regardaient ce que nous faisions. » Ameneh Bahrami, qui vit en Espagne où elle a subi de nombreuses opérations, a affirmé, que les autorités judiciaires iraniennes avaient fait pression sur elle, pour qu’elle renonce à l’application de cette peine.
Novembre 2018 : les travailleurs de la société Haft Tappeh Sugar Cane, entament une grève pour réclamer le paiement de mois de salaires impayés. Sepideh Gholian (militante pour les droits du travail et les droits civils), Esmail Bakhshi et Mohammad Khanifar, respectivement porte-parole et membre du syndicat indépendant des travailleurs, sont arrêtés pour « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale » (article 610 du code pénal islamique). Le 14 décembre 2019, la cour d’appel de Téhéran confirme la condamnation de Sepideh Gholian, Esmail Bakhshi et Mohammad Khanifar et les condamne à cinq ans de prison chacun. En prison, Sepideh Gholian, pour laquelle Katayoun Afifi a beaucoup d’admiration, à juste titre, dénonce les mauvais traitements infligés aux détenues : « La prison est un endroit proche de la fin du monde où les femmes sont traitées inhumainement et forcées de faire des choses déshonorantes. »
13 septembre 2019 : Sahar Khodayari, trente ans, est passionnée de football. Mais en Iran, les stades sont interdits aux femmes. Et ce, selon les responsables religieux, pour les protéger de « l’atmosphère masculine et de la vue d’hommes à moitié dévêtus ». Alors, elle s’est habillée en garçon pour assister au match d’Esteghlal, son équipe favorite et elle a été arrêtée. Craignant une longue peine de prison, elle s’immole devant le tribunal et succombe à ses blessures.
8 février 2022 : Soupçonnée d’adultère, Mona Heidari, dix-sept ans, mariée de force à douze ans, mère d’un fils de trois ans, a été assassinée et décapitée, dimanche 6 février, par son mari et son beau-frère à Ahvaz, dans le sud-ouest de l’Iran, indique l’agence de presse Isna. La vidéo de l’époux, paradant dans la rue sourire aux lèvres avec la tête de sa femme, est apparue peu de temps après sur le net iranien, bouleversant le pays. Lundi 7 févier, les deux hommes ont été arrêtés par la police. Réagissant au drame, plusieurs défenseurs des droits humains ont exhorté les autorités à réformer la loi sur la protection des femmes contre la violence conjugale et à augmenter l’âge minimum du mariage pour les filles, fixé actuellement à treize ans.
Voilà à quoi est exposée Katayoun Afifi. La dénonciation de l’oppression et l’appel à la liberté, sont au cœur de ses écrits. Des centaines de personnes sont détenues arbitrairement en Iran pour avoir écrit ou exercé pacifiquement leurs droits humains. Il s’agit notamment de militants des droits, de journalistes, d’opposants politiques, d’artistes, d’écrivains et de poètes, donc de notre Katayoun Afifi, dont, en janvier 2022, je reçois un message, qui me touche beaucoup : « Il y a presque huit ans je vous ai envoyé un email avec un texte qui contenait une nouvelle. Vous avez lu le texte et corrigé toutes ses fautes en m’encourageant à continuer à écrire. Ce n’était pas facile du tout d’écrire dans une langue qui n’était pas ma langue maternelle et pouvoir trouver un éditeur, qui accepte de publier un recueil de nouvelles d’une autrice inconnue, qui habite très loin du Canada à ses frais. Finalement c’est arrivé et le livre a été publié au Canada l’année dernière sous le titre de Les Gōsāns de la triste patrie, par Katayoun Afifi, édition Bayeux arts. Katayoun n’est pas mon vrai nom. Mais je dois rester inconnue tant que je suis en Iran, qui est la prison des écrivains. Je voulais vous offrir une copie du livre, mais en raison des circonstances politiques, j’ai demandé à mon éditeur de ne pas m’envoyer quelques copies en Iran. J’espère que ce livre pourra m’ouvrir une porte afin de sortir d’Iran ; afin de pouvoir continuer mon travail librement. On est en train de réfléchir à ce que l’on peut faire pour faciliter un peu les choses. Grace à votre encouragement j’ai pris l’écriture au sérieux et après avoir parcouru un long chemin, le premier recueil est sorti… » Katayoun Afifi s’est accrochée et elle a pris le risque, dans un pays où la culture relève du ministère de l’Orientation islamique. Créer constitue un défi. La peintre et dessinatrice Atena Farghadani (née en 1987) a été condamnée, en 2015, à douze ans de prison pour « rassemblement et collusion en vue de nuire à la sûreté de l’État, diffusion de propagande contre le régime, insulte envers les membres du Parlement par le biais de peintures, outrage au guide suprême et envers les fonctionnaires chargés de son interrogatoire. » N’en jetez-plus ! La cour est pleine ! Ces accusations sont directement liées à son exposition Parandegan‑e Khak (Oiseaux de la Terre), tenue en hommage aux victimes de la répression du mouvement vert de 2009, et à la publication d’une caricature représentant des députés iraniens sous l’apparence d’animaux. Ce dessin visait à dénoncer deux projets de loi pénalisant la contraception et la stérilisation volontaire, et renforçant les droits du mari dans les procédures de divorce. Toute production artistique, qu’elle soit d’ordre théâtrale, cinématographique ou une exposition publique, doit obtenir les accords des institutions gouvernementales avant d’être présentée au public. En ce qui concerne la musique, toute représentation musicale à la télé ou en public est interdite. C’est donc l’autorité gouvernementale, qui décide de ce qui est bien ou mal en imposant une censure étatique, religieuse, politique et morale. Le régime justifie ses recours à la censure par la mise en place de règles de conduites moralisatrices au sein de la société. L’Iran est un pays constitué par une société clanique, avec une caste dominante, qui refuse de perdre ses privilèges et institue ces règles de moralités pour ne pas les perdre. Par conséquent, les œuvres remettant en cause cet ordre établi et proposant un nouvel ordre, sont jugées menaçantes et censurées. Mais, la censure est présentée par le régime comme bénéfique, pour protéger contre les dangers d’une image ou d’une œuvre.
Les sujets sensibles à éviter ? La religion, la politique et le corps féminin. Katayoun ne contourne pas les sujets dits sensibles et c’est bien pour cela, que son premier livre de nouvelles, à paru à l’étranger, au Canada, et avec un pseudonyme. Katayoun est parvenue à sortir de sa « prison » iranienne, grâce à ses mots et à son imaginaire, qui ne font pas fi de la réalité de la femme et de la société iranienne, menées à la « baguette » par les gardiens de la révolution. Les nouvelles de Katayoun révèlent aussi un talent littéraire en devenir, à l’instar de sa grande aînée Forough Farrokhzâd, qui a consacré sa vie à lutter non seulement pour sa propre dignité de femme et de poète, mais aussi, pour la liberté et l’égalité sociale en Iran : « Je souhaite, de tout mon cœur la liberté des femmes iraniennes et l’égalité entre les femmes et les hommes de mon pays. Je sais bien ce qu’elles subissent à cause de l’injustice sociale et je consacre une moitié de mon art à incarner leur peine et leur douleur. » Cinéaste et grande voix féminine de la poésie iranienne contemporaine, Forough Farrokhzâd est une figure de proue du féminisme iranien. Et Katayoun, suit ses traces, mais avec ses propres acquis.
Les Gōsāns de la triste patrie, de Katayoun Afifi
Les Gōsāns de la triste patrie, le premier livre de nouvelles de Katayoun Afifi, a paru chez un éditeur canadien, Bayeux Arts. Car, aucune des six nouvelles, qui composent ce livre, ne pourraient paraître en Iran, sans attirer les pires ennuis à son auteur. Selon Amnesty International, au moins 7.000 artistes, militants, journalistes, ont été arrêtés, rien qu’en 2018. La sixième et dernière nouvelle, « Femme dans le miroir », est peut-être la plus dangereuse, puisqu’elle traite directement et sans filtre du désir féminin et de la réappropriation de son corps par une jeune femme iranienne. Or, en Iran, nous rappelle Hanieh Ziaei (cf. La voix des artistes iraniens entre engagement, dissidence et censure in implications-philosophiques.org, 2017), tout ce qui touche à la reproduction de la nudité et à la sexualité est interdit. Le corps féminin est soumis à la domination sociale masculine et l’homme dispose même du contrôle du pouvoir de procréation de la femme. La censure sur les questions de sexualité constitue un geste politique et idéologique. La pratique de la sexualité devient alors un terrain politique. La censure frappe les milieux artistiques puisque les artistes, plus que d’autres acteurs sociaux, se consacrent à l’expression personnelle et sociale de leur sexualité, se retrouvant à briser les tabous et les normes de la société, franchissant ainsi la ligne de démarcation de ce qui est permis culturellement et socialement acceptable. En Iran, les femmes artistes se voient interdire toute performance en danse ou en chant dans un espace public, une représentation de la féminité ou de la sensualité féminine étant considérée comme symbole de débauche et immoralité.
Dans un pays comme l’Iran, dont l’idéologie est religieuse, les débats de société portant sur des questions liées à l’homosexualité, à la sexualité, au corps, à la religion ou à la femme ne sont généralement jamais tolérés ni permis. Il ne faut surtout pas qu’un index accusateur pointe les autorités et la responsabilité de l’État face à la société ou interroge la réalité sociale existante. La République islamique d’Iran a rapidement établi, dès son arrivée au pouvoir, la ligne de démarcation entre les notions du bien et du mal, du normal et de l’anormal, du sain et du pathogène, du légal et du criminel, en deux mots : ce qui est permis et ce qui est interdit. Cette classification vaut pour les domaines artistiques, littéraires et culturels où le régime établit à nouveau une frontière entre : l’art officiel (permissible) et l’art inacceptable (immoral ou décadent).
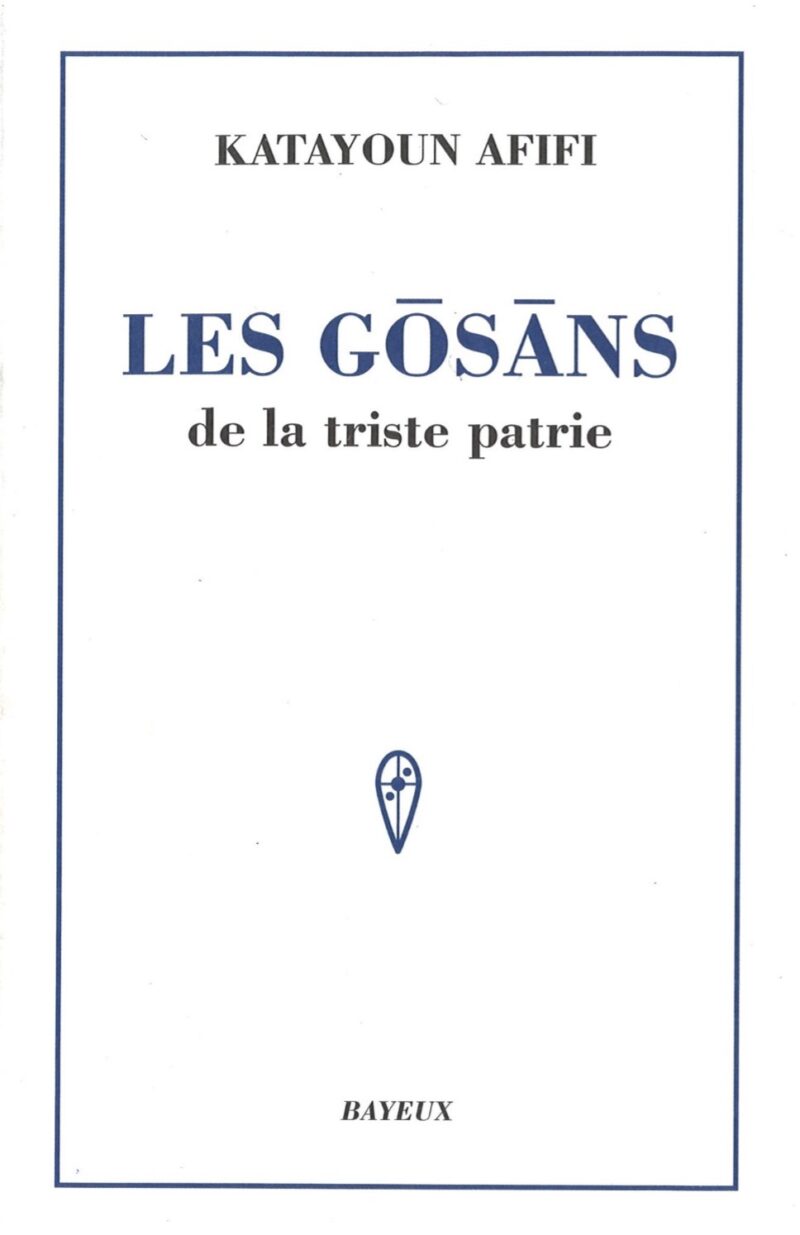
Katayoun Afifi, Les Gōsāns de la triste patrie, 104 pages, 19,95 $, Bayeux Arts, 2021. www.bayeux.com.
Mais, cela n’entrave pas la lecture et n’altère en rien l’œuvre. Rappelons, encore une fois, que ces nouvelles ne sont pas traduites du fârsî, mais qu’elles ont été écrites en Iran par une jeune femme persane, Katayoun Afifi, directement en français. Et que le rendu est impressionnant.
Les nouvelles, qui composent le premier livre de Katayoun Afifi, Les Gōsāns de La triste patrie, sont toutes en relation avec le totalitarisme de la société iranienne et dédiées à des personnes ayant eu à subir les foudres du régime, avec des conséquences souvent tragiques. Ces foudres, tous les personnages de Katayoun, des femmes, principalement, mais pas seulement, les subissent. Toutes et tous s’y opposent, agissent contre et se révoltentAu fond du ciel vide se trouvent les décombres d’un mur — Et ton cri errant — N’aura point d’écho pour te revenir, écrit le grand Ahmad Shamlou, sans pour autant renoncer à l’espoir : Non je n’ai jamais cru la nuit – Car — Au fond de son vestibule — J’espère trouver toujours — Une fenêtre. La narratrice de la nouvelle « Celle qui fabriquait des baignoires… », nous le dit : « Le nouveau régime se considérait maintenant comme le propriétaire de tout et avait promis de former une société sans aucune classe sociale, sur la base de la religion. La richesse du pays et toutes les ressources étaient dans les mains des extrémistes, qui n’acceptaient aucune opposition. La situation économique des gens était affreuse. La superstition religieuse, le dogmatisme, l’espoir de fausses promesses du « Grand Leader » du nouveau régime, avaient aveuglé beaucoup de gens et même les intellectuels… »
Qu’est-ce qu’un Gōsān ? Un mot Parthe, à l’origine, qui qualifie un poète, un ménestrel. Le mot a été remarqué pour la première fois par son utilisation dans un texte persan classique du XIe siècle, Vis o Rāmin de Faḵr-al-Din Asʿad Gorgāni. La Triste patrie, c’est la malheureuse et pourtant grandiose et plus que millénaire Iran, qui est passée en 1979, de la Savak, la police politique du Shah, à la police religieuse de l’ayatollah Khomeini. Les Gōsāns, ce sont Katayoun, ses ami(e)s, ses aîné(e)s, poètes et écrivains, à l’instar d’Ahmad Shamlou ou Forough Farrokhzâd. Et d’une manière plus large, toutes celles et tous ceux, qui n’abdiquent pas devant le despotisme du régime islamique. Toutes celles et tous ceux, qui, faisant face au fanatisme et à l’oppression, ne renoncent pas à la liberté et à l’Amour la Poésie, à l’instar de la magnifique Forough Farrokhzâd. Forough, qui nous dit en 1954 (elle est alors âgée de dix-neuf ans) : « Je pense qu’un poème est une flamme de sentiments et qu’il est la seule chose, qui puisse me transporter vers un monde de rêve et de beauté. Un poème est beau lorsque le poète y projette toutes les vibrations et les ferveurs de son âme. Je crois qu’il faut exprimer ses sentiments sans aucune restriction. En principe, on ne peut fixer de limite pour l’art, sinon il perd son esprit essentiel. C’est en suivant ce principe, que j’écris des poèmes. J’ai beaucoup de mal, en tant que femme, à garder le moral dans cette ambiance malsaine. J’ai consacré ma vie à l’art et je peux même dire que je l’ai sacrifiée pour l’art. Je veux vivre pour mon art. Je sais, que le chemin que je suis a fait beaucoup de bruit à présent et dans la société actuelle et je me suis fait beaucoup d’adversaires. Mais je crois qu’il faut enfin briser les barrières. Il fallait que quelqu’un emprunte ce chemin et comme j’ai eu le courage et le dévouement nécessaires, j’en ai pris l’initiative. La seule force, qui me donne toujours de l’espoir, c’est l’encouragement des véritables intellectuels et artistes de ce pays. Je déteste les gens, qui font tout ce qu’ils veulent et pourtant parlent tout le temps de la purification des mœurs de la société… Je sais, que beaucoup de gens interprètent mal mes poèmes et pour me diffamer inventent des répliques à mes poèmes afin de démontrer aux gens, que j’écris à l’intention d’une certaine personne. Pourtant, je ne recule devant rien et je ne baisse pas les bras. Comme je l’ai déjà fait dans le passé, je supporte tout avec beaucoup de calme… »
Tout est dit du combat de la poète et de la femme. C’est dans cette veine, que s’inscrit Katayoun. Non pas à l’heure du Shah, mais à celle des ayatollahs. Sa radioscopie de la société iranienne contemporaine à ceci d’inédit, qu’elle est réalisée par une jeune femme, qui vit en Iran, et non pas dans la diaspora. La trame ne repose pas sur la seule peinture réaliste de la société iranienne. Elle part du réel pour rejoindre l’imaginaire et l’onirisme, dont sont imbibés ses personnages, mais aussi le pays, ses villes et ses paysages. Même menée à l’abattoir, c’est souvent le cas, la rose de Shiraz parvient toujours à s’élever. On appelle cela l’Espoir.
La première nouvelle, « Les bossus comme moi », est l’histoire d’un homme, Monsieur Bossu, qui n’a jamais désiré qu’une seule chose : « Vivre de la manière qu’il désirait, libre et soulagé du superflu » M. Bossu est allumeur de réverbères : « Il a la responsabilité d’éclairer la voie publique dans six quartiers de la ville d’Apollo ». M. Bossu a pour compagnon imaginaire, un peintre nommé Vincent, fasciné par la couleur jaune. On aura reconnu Vincent Van Gogh. Mais, un jour, un évènement terrible vient bouleverser la vie de M. Bossu, « le jour du désastre » : « Ce jour-là, M. Bossu entendit soudain des bruits bizarres qui venaient du dehors : « Attention, attention ! Au nom de la splendide autorité d’Apollo, à partir de maintenant, le mot « pourquoi » sous toutes ses formes linguistiques est supprimé de la langue écrite et orale. Sa Majesté et seul pouvoir royal d’Apollo, désire que les gens participent à cette campagne pour faire taire le « Pourquoi ». La conséquence sera terrible pour ceux, qui ne respectent pas cet ordre divin. » En une semaine, le « Pourquoi » avait totalement disparu. Tous les livres furent regroupés pour être contrôlés. On fît une grande quantité de pâte à papier avec les anciens livres et journaux, qui comportaient ce mot… Le lendemain du silence du « Pourquoi », M. Bossu s’assit à six heures pile sur le lit avec le dos déformé par une bosse. C’était en effet la conséquence de l’insoumission… Dès ce jour-là, le mot « Pourquoi » échappait à n’importe qui, il (elle) sentait une démangeaison sur le dos, puis il (elle) était le témoin du fleurissement d’une bosse… »
Madame Roshanak, l’héroïne de « Celle qui fabriquait des baignoires… », est une femme d’affaires, issue d’une longue dynastie de fabricants de baignoires, qui a repris l’activité de son grand-père et de son père. Du fait de son statut, sans aucune forme de procès, Madame Roshanak est apparentée à la bourgeoisie de l’ancien régime : « Son grand-père avait pu s’enrichir en fabriquant des baignoires argentées de très bonnes qualités pour des riches, des politiciens et des artistes connus… Tout le monde désirait en installer une dans sa salle de bain… ». Madame Roshanak est traitée de parasite et est accusée d’espionnage, par le nouveau pouvoir islamique, sur fond de guerre Iran/Irak (1980–88). Un groupe de miliciens, « un groupe de voyous et de mercenaires… », vient perquisitionner chez elle. Ils ne trouvent rien de compromettant, mais l’arrêtent tout de même. Les interrogatoires se suivent, sans interruption. : « Douze heures d’interrogatoire par jour… La nuit, le bruit des bottes des officiers l’empêchent de dormir… Après le soixante-deuxième interrogatoire, elle était prête à avouer et à accepter ce qui lui était reproché… » Alors l’officier du régime lui dresse la liste de ses crimes : « Ne pas aider les pauvres et ne pas partager sa richesse avec eux. Fabriquer des baignoires en argent à la place des baignoires en céramique et gaspiller les ressources précieuses du pays. Placer des documents ultra confidentiels dans les baignoires et les porter jusqu’aux maisons des politiciens du régime précédent. Collaborer avec des pays ennemis sous le précédent d’exporter des baignoires. » À l’écoute, Roshanak ne sait si elle doit en rire ou en pleurer. La suite ? Le procès et ce qui va en découler…
La nouvelle « Voie à sens unique », traite de la femme, de son statut dans la société islamique, de son corps, de sa sexualité (« Je ne sais pas si je suis le produit de l’orgasme d’une personne ou de deux »), de sa condamnation à reproduire, à être mère, à être contrôlée dès son enfance et à subir, sans jamais pouvoir décider de rien. L’héroïne, est la quatrième enfant d’une famille de sept personnes. La mère, « après chaque accouchement, sa taille rétrécissait comme un tissu après lavage ! Je me disais : « Bientôt ma mère aura disparu. » J’attendais que ma mère disparaisse. » La mère meurt avec son huitième bébé, en couche. Le père travaille avec ses deux fils dans une société de bâtiment. Comme une fille « ne peut travailler comme un garçon », le père s’en débarrasse. Il vend sa fille aînée contre une enveloppe et une boite de pâtisserie, à un voisin. À l’âge de quinze ans, vient le tour de l’héroïne, d’être vendue, à un homme de quarante ans : « Mon père lui a donné ma carte d’identité et je suis partie avec lui. Mon mari a fait sortir une enveloppe de sa poche et l’a donnée à mon père. À partir de ce jour-là, je n’ai plus jamais revu ma famille. » Deux mois passent, sans que le mari ne la touche. Puis, un soir, il vient la trouver et lui dit : « Allonge-toi sur le matelas ! » Notre héroïne-narratrice dit : « J’ai dû tolérer le corps dont j’avais peu à peu l’habitude de l’odeur, deux fois par semaine. » Résultat : un garçon, en sus des deux filles de son mari. Mais, un jour d’été, notre héroïne, endors les enfants, prend sa carte d’identité, son tchador noir et s’enfuit. Dans la rue, elle est abordée par une femme, qui l’invite à monter dans sa voiture. Madame Mouloude, femme aisée et élégante, habite une grande maison, qui possède une vaste cour avec des arbres fruitiers, un palais, dans le cœur de Téhéran. Six filles vivent sous son toit. Notre héroïne devient la septième, à quelques conditions : « Tu dois être honnête, fidèle et savoir garder un secret. Tu dois savoir garder ta langue. Tout le monde a ses propres secrets dans cette maison. Si je vois la moindre faute de ta part, je te mets dehors et tu n’auras pas de deuxième chance. Je crois que j’ai été assez claire… » De quels types de services et de secrets, parle Madame Mouloude ? Qui est-elle ? Que fait-elle dans la vie ? La suite de la nouvelle réserve bien des surprises et des rebondissements. Sans les dévoiler, disons, qu’il est question de trafic d’opium, de la police autant politique que religieuse, d’arrestation. Nous sommes à Téhéran, en Iran et comme le dit un colonel de la police : « Tout est interdit. Il faut isoler et contrôler les relations hors des limites du mariage et de la religion. »
Le titre de la nouvelle « N’écrivez plus en persan », ne peut, pour un poète français, que le renvoyer à notre Montesquieu et à son roman épistolaire fameux Les Lettres persanes (1721), qui rassemble la correspondance fictive échangée entre deux voyageurs persans, Usbek et Rica, et leurs amis respectifs restés en Perse. Leur séjour à l’étranger (dont huit ans à Paris, de 1712 à 1720), dure neuf ans. Montesquieu, par prudence, n’avoue pas qu’il en est l’auteur. Le livre est anonyme. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, tout ouvrage doit obtenir, en France, le privilège royal pour être publié. L’Église peut mettre à l’index certaines œuvres qui nuisent à la doctrine catholique. Ces interdictions entrainent la circulation d’œuvres clandestines et la publication anonyme ou depuis l’étranger. Montesquieu critique à foison la société française de l’époque sans risquer la censure. À Paris, les Perses s’expriment sur une grande variété de sujets allant des institutions gouvernementales (réflexion politique et satire de la monarchie absolue de droits divins, les querelles et les interdits dogmatiques sont présentés comme absurdes) aux caricatures de salon. Les Lettres persanes connaissent un succès immédiat, jamais démenti. Les Lettres persanes sont emblématiques des Lumières, mouvement, qui incarne le combat de la raison contre l’obscurantisme. Des philosophes tels, Voltaire, Diderot, d’Alembert ou Rousseau, prônent de nouvelles valeurs : l’éducation et les connaissances doivent éclairer les hommes. En 1721, La France connaît le régime politique de la Régence, instauré à la mort de Louis XIV, en 1715, à cause du trop jeune âge de son héritier désigné, Louis XV, qui n’a que cinq ans. Les Lettres persanes jouent un rôle essentiel en participant à la contestation des abus de pouvoir et à la volonté de fonder une société plus juste. L’éloignement perse (et dans la mode orientaliste, très en vogue en ce début de siècle) est le parfait outil de dénonciation des mœurs françaises. Montesquieu écrit ce passage mémorable : « Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie, sans qu’on m’eût regardé, et qu’on m’eût mis en occasion d’ouvrir la bouche ; mais, si quelqu’un, par hasard, apprenait à la compagnie que j’étais Persan, j’entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement : « Ah ! ah ! monsieur est Persan ? C’est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? »
La nouvelle de Katayoun Afifi, non dénuée d’humour ni de mordant, sur un sujet grave, emboîte bien sûr le pas satirique de Montesquieu, et à son « Comment peut-on être Persan ? » répond : « N’écrivez plus en persan ». Il est question ici de la liberté d’expression, de création, de censure, d’auto-censure et de la difficulté d’être publié, pour un écrivain, dans la société islamique d’Iran. Le personnage principal est un célèbre écrivain, Méhrdad Afifi, auteur de nombreuses nouvelles et de deux romans à succès, de retour à l’écriture et en Iran, après huit années de silence (tiens, huit ans ! tout comme le séjour à Paris des Perses de Montesquieu, Usbek et Rica), passées à l’étranger chez sa fille, à laquelle est dédié son dernier livre Mon nom est personne. À qui sera dédié le suivant ? À la seule vraie femme de sa vie : Katayoun Afifi. Non pas, une femme de chair et de sang, mais une femme, compagne et muse, imaginaire. Pourtant, Méhrdad Afifi, lui, la voit, depuis toujours, et converse avec elle. Il souhaite publier son dernier livre de nouvelles aux éditions Alizadéh. Encore faut-il obtenir l’autorisation du Bureau de la Culture. Autrement dit, la censure du régime. Méhrdad Afifi est convoqué par le Bureau. L’entretien ne se passe pas bien. On lui demande de retirer nombre de passages. Le chef du Bureau, M. Taban, lui dit : « Pourquoi mettez-vous en question la liberté des hommes et des femmes si insolemment ? Nous vivons dans un pays libre où tout le monde a le choix de vivre à la manière qu’il désire ! Qu’est-ce que vous savez de la sociologie ? Aussi, vous soutenez des femmes perverses, qui se présentent comme des victimes ! Il faut, que vous vous rendiez au tribunal pour toutes ces réclamations insensées !… Corrigez votre exemplaire et contactez-moi…
L’avant dernière nouvelle, « Madame Simine », traite de la femme iranienne, tiraillée entre ce que l’on attend d’elle (le mari, les frères, la religion) et ses aspirations profondes à la liberté et au désir. C’est la première nouvelle, que m’a adressé Katayoun Afifi, il y a huit ans. Madame Simine réside dans une vaste maison, avec cour intérieur fleurie et des arbres fruitiers, du vieux Téhéran. C’est une figure historique et respectée du quartier. Une femme généreuse, attentive et souriante, de vingt-sept ans. Une mère dévouée, qui élève seule (son mari, de dix ans son aîné, est mort au combat durant la guerre Iran/Irak, qui bat son plein), ses deux filles, de cinq et sept ans. Un exemple de respectabilité et de dévotion. On ne lui connaît aucun excès, ni écart, ni déboire. Les jeunes filles l’appellent « Sœur Simine » : « Les problèmes familiaux, les disputes conjugales, la coquetterie des filles, tout est sujet de consultations gratuites auprès cette dame pudique. » Elle est rigoureuse, orthodoxe. À une femme, qui lui parle des premières règles de sa fille âgée de douze ans. Simine, qui arbore un tchador blanc à fleurs, répond : « Vous devez la former d’une manière conforme à la morale. Oui, elle a tout juste douze ans. Laissez de côté cette compassion maternelle ! Les premiers écarts commencent dès cet âge… » Mariée tôt, alors qu’elle était lycéenne, Simine est en fait une femme résignée, soumise à l’autorité de son mari, puis, de ses frères, sans jamais protester : « Elle pense que personne ne peut lutter contre son destin. Qu’il faut l’accepter et s’en accommoder… On lui a montré un chemin en lui disant : — Voilà, c’est ta route. Avance et ne proteste pas… Elle n’attendait plus rien de la vie. Avait-elle déjà attendu quelque chose ? Pour elle, la vie s’était toujours résumée à un cadre strict : celui de la tradition et de la religion… C’était là son cocon » et sa prison. Et pourtant, un matin, Madame Simine disparait avec ses deux filles…
De retour chez lui, Méhrdad retrouvent tous ses personnages, à commencer par Katayoun, et Monsieur Bossu, qui a peine à respirer. Anahita, femme qui a été attaquée à l’acide au visage, dans la rue, pour sa tenue vestimentaire non conforme, dit : « Les bosses appuient sur les poumons et elles bloquent les voies respiratoires. » Madame Hekmat rétorque : « Méhrdad, tu nous as tués. Raconte ce qui s’est passé au bureau de la culture. Quelles parties du livre dois-tu supprimer pour pouvoir nous publier ? » Méhrdad répond dans un soliloque : « Il faut que j’efface tous les personnages. Le problème d’après eux, c’est la totalité du contenu. » Anahita reprend la parole : « Ces histoires sont nos identités. Elles sont des évènements de nos vies. Nous ne pouvons pas dire des mensonges et nous cacher ou faire semblant d’être une autre personne. Nous sommes comme un miroir cassé, fragmenté, avec beaucoup de contradictions… On est épuisés… J’espérais pouvoir m’exprimer dans ton livre. Hélas ! » Méhrdad Afifi est en butte à son imaginaire, à ses personnages révoltés, dont le réel réclame, qu’ils soient purement et simplement effacés. Méhrdad Afifi va-t-il obtempérer ? N’est-il pas le double de Katayoun Afifi ? Non pas l’héroïne de la nouvelle, mais l’auteur des Gōsāns de la triste patrie, qui met en scène tout ce que doit affronter un écrivain, en Iran.

Shadi Ghadirian : Trois photos de la série Qajar (1998).
La dernière nouvelle des Gōsāns, est la plus sensuelle, la plus charnelle et la plus érotique. Katayoun nous invite à partager la journée d’Hana, une Téhéranaise de trente ans, qui a rendez-vous avec et chez son petit-ami et s’interroge : c’est quoi le désir ? « Les picotements sensuels et exquis, que l’on ressent quand on touche l’autre, l’envie de lui dire : « c’est moi ! » Je cache mes parts d’ombre, vois-tu les points lumineux de mon être ? Comment tu m’imagines ? Suis-je assez bien pour toi ? Dans l’attente de son rendez-vous, elle se rend dans son café favori, le Café… Shiraz (forcément !), où « les cheveux ondulants et colorés des filles sortent des foulards, alors qu’un maquillage luisant cache leur vrai visage… Elles parlent avec les minces garçons qui portent des jeans déchirés, d’une société en train de se désintégrer… Je peux facilement m’imaginer à leur place. Je pense que nous avons tous une douleur commune. Nous sommes tous perdus… Qu’est-ce qui va nous arriver ? Personne ne le sait. J’ai lu quelque part, que l’Iran est le berceau de la civilisation, mais je crois, que c’est le berceau de l’incertitude ! Je souris à cette connerie et je laisse les jeunes seuls. »
Hana est ensuite intriguée par la photo d’une femme de l’époque Qajar (d’après la dynastie turkmène, qui régna sur la Perse de 1789 à 1925), sur un mur du café. Cette femme l’amène à s’interroger (comme le fait la photographe Shadi Ghadirian dans sa série « Qajar », en 1998), sur cette époque et la sienne. Hana et la Qajar deviennent « femme dans le miroir » de l’une et de l’autre. Mais le miroir, qui attend Hana, tout à l’heure, est encore plus coquin. Et que nous dit Shadi Ghadirian, de ses « femmes Qajar » à elle ? Un peu ce que dit Hana à sa « vieille amie » Qajar : « Comment voyons-nous la femme d’aujourd’hui, celle d’hier et celle de demain ? Où sont les frontières temporelles ? Et où nous situons nous par rapport à ces frontières ? Voici des visages de femmes du passé, les femmes de l’ère Qajar (1785–1925), de l’ère constitutionnelle (1905–1907), quand est apparu un nouveau style de vie. Mais où les frontières se situent-elles ? L’art est-il censé les ignorer, les transgresser ? Dans mon imaginaire, cette géographie temporelle est sens dessus dessous. Pour moi, une femme iranienne, comme moi, est à la croisée de toutes ces frontières inconnues, qui séparent la tradition de la modernité. Ces frontières se déplacent dans le temps. Je porte les vêtements d’hier, et la femme Qajar côtoie les objets contemporains. Pour moi, la réalité, ce n’est pas ce qui se passe dans le monde extérieur. La réalité, cela peut être l’image que je me suis fabriquée de moi-même et des femmes. »
Quinze minutes plus tard, Hana se trouve dans l’appartement de son compagnon : « J’évite toute dispute avec lui, même sur les sujets, qui me paraissent importants. À ce moment-là, j’ai seulement besoin de tranquillité, de la chaleur d’un corps pour lequel j’ai tant d’ardeur. » La chose faite (il semble, que, plus que les sentiments, ce soit ce qui les réunissent tous les deux, le sexe), qu’Hana, ne censure pas, il s’agit de retourner chez soi, dans le petit appartement d’une jeune femme seule « qui cherche l’amour et la paix désespérément, dans les bras d’hommes avec lesquels elle n’a aucun lien. »
Malgré le couvercle sous lequel il faut vivre. Malgré le sentiment de claustrophobie, que lui ont imposé des siècles de domination, la population iranienne fait toujours preuve d’un incroyable courage, d’une force vive, d’un esprit créatif, revendiquant la liberté. Katayoun, à la suite de Forough Farrokhzâd, en est l’un des étendards, une voix, lorsque Newsha Tavakolian et Shadi Ghadirian en sont les images. Fidèle à cette volonté, que lui insufflent ses racines, Katayoun Afifi nous entraîne à travers les personnages de ses nouvelles, dans l’Iran d’aujourd’hui, déchiré entre son désir de modernité, de liberté et l’idéologie islamique dont il est imbibé. Elle pourrait en cela reprendre les propos de son aînée, la photographe Newsha Tavakolian, qui s’inscrit, tout comme Katayoun, dans la lignée des artistes persans, qui contournent les interdits pour créer : « Comme photographe, j’ai toujours lutté contre la perception de la société dans laquelle je vis, la complexité et ses malentendus. J’ai décidé de continuer l’album de famille de ma génération. Pour ajouter les photos jamais prises de leur vie d’adulte, telle qu’elle est aujourd’hui. Ce qui m’intéresse est de pouvoir communiquer, à travers ce travail, les sentiments de certaines personnes, qui vivent en Iran. Ce que je souhaite, c’est représenter une génération marginalisée par ceux, qui parlent en son nom. » La photographie est un art silencieux. Pourtant les photos de Newsha Tavakolian et de Shadi Ghadirian, charrient des mots, des sons, comme les nouvelles de Katayoun Afifi.
- ALAIN DELON, HENRI RODE & LES HOMMES SANS ÉPAULES - 6 novembre 2024
- Nimrod : Lettre à Christophe Dauphin à propos de Totem normand pour un soleil noir - 7 juillet 2024
- Nimrod : Lettre à Christophe Dauphin à propos de Totem normand pour un soleil noir - 1 novembre 2022
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO - 1 juillet 2022
- LES GŌSĀNS DE LA GRANDIOSE ET TRISTE PATRIE IRANIENNE DE KATAYOUN AFIFI - 3 mai 2022
- JEAN-PAUL BELMONDO ET RIMBAUD, L’AN 1969 DE « POÉSIE 1 - 21 septembre 2021
- Jacques Simonomis - 5 juillet 2021
- Portrait du poète en comédien : Hommage à Yves GASC - 4 janvier 2019
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO - 5 juillet 2018
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (3) : CHANTAL T. SPITZ - 5 juillet 2018
- Un poète à Mayotte : William Souny - 5 juillet 2018
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (2) : FLORA AURIMA DEVATINE - 5 juillet 2018
- La revue des revues de Christophe Dauphin - 15 février 2013
- Un chèque en blanc - 4 janvier 2013
- Sur deux livres récents de Roland Nadaus - 27 décembre 2012
- Stanilslas Rodanski dans les métamorphoses de l’écho - 19 juillet 2012
- Jacques Bertin, Les Traces des combats - 16 juin 2012
- Revue des revues de Christophe Dauphin - 16 juin 2012
- Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen, La Mort, c’est nous… - 10 juin 2012
- Grzegorz Przemyk, poète assassiné - 1 juin 2012
















