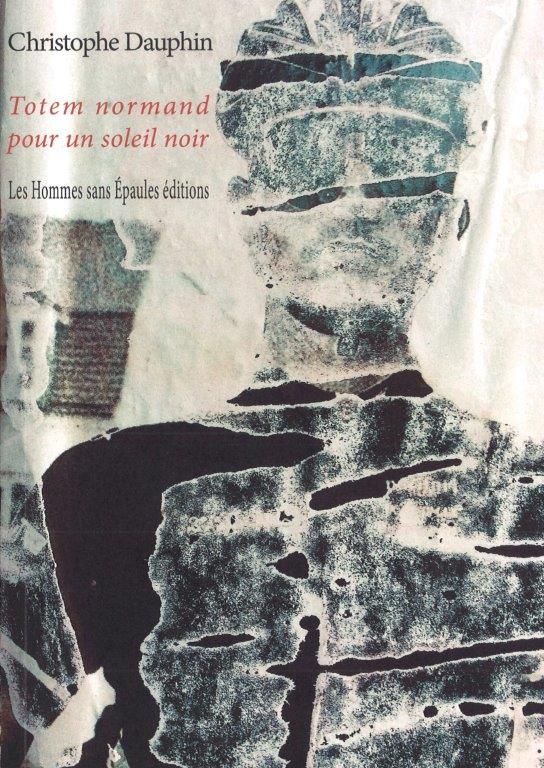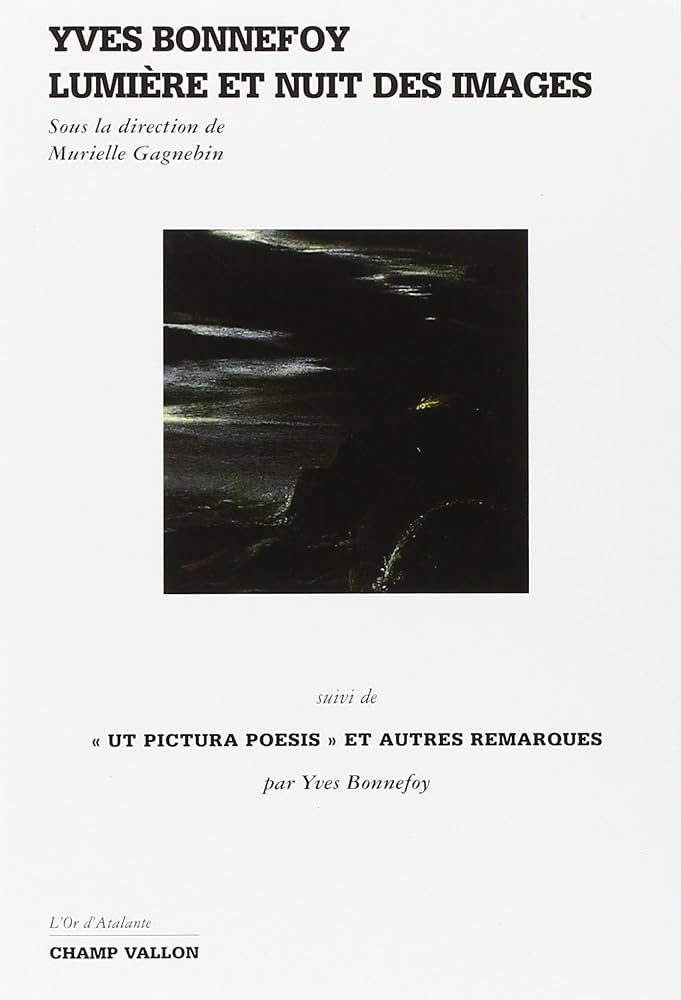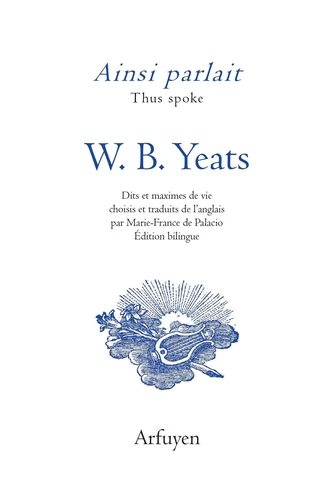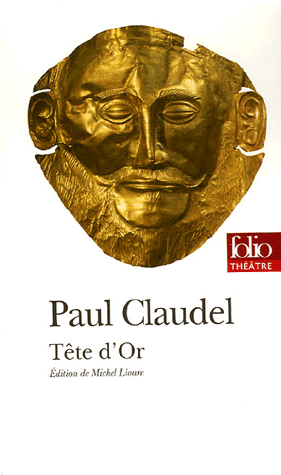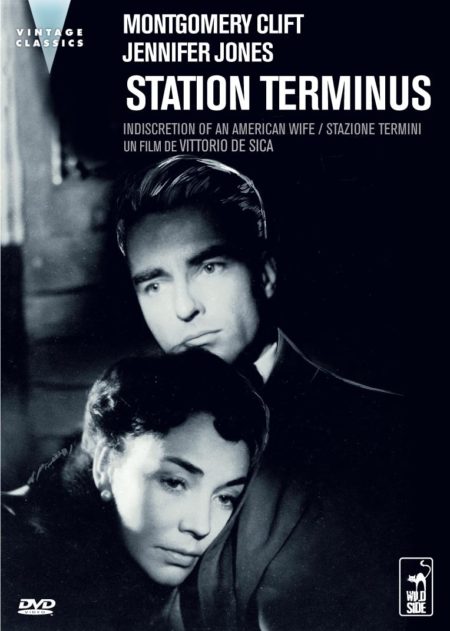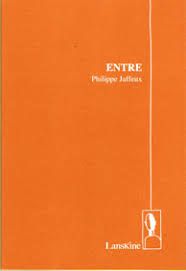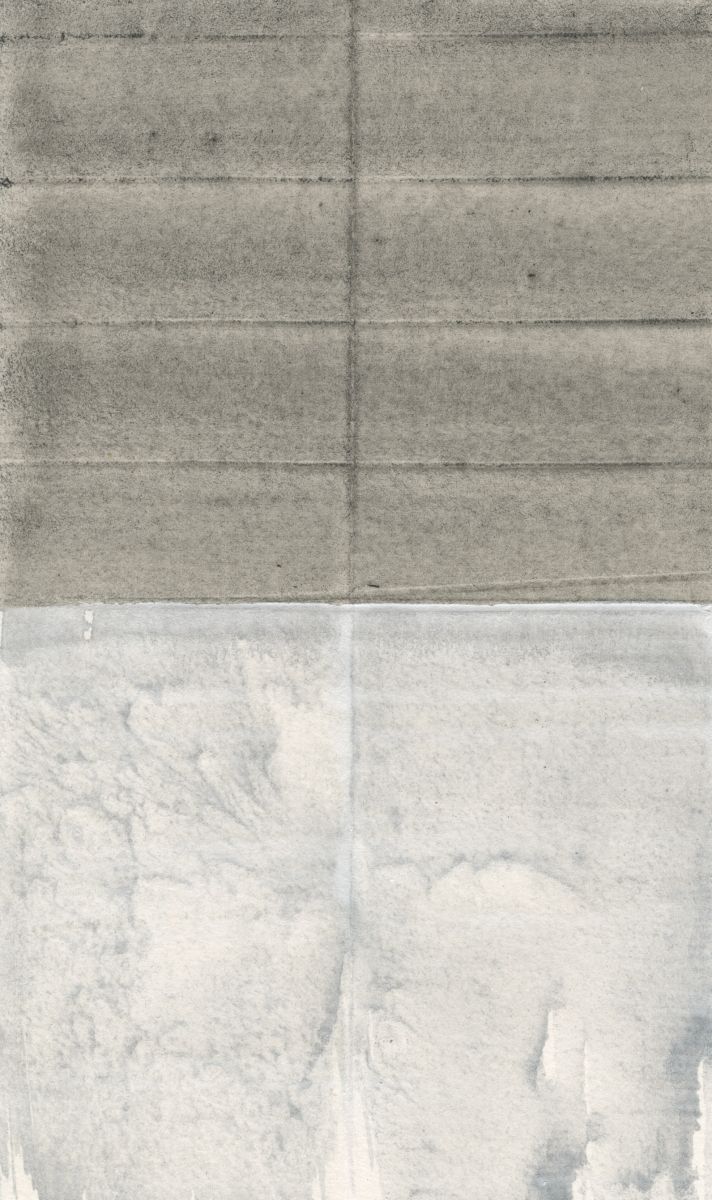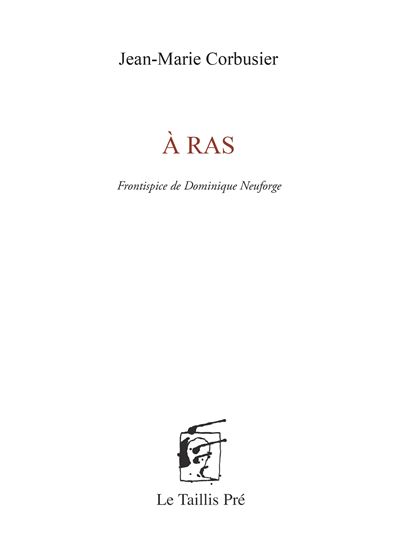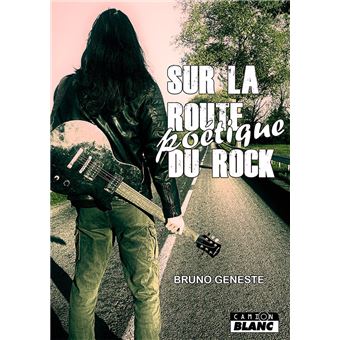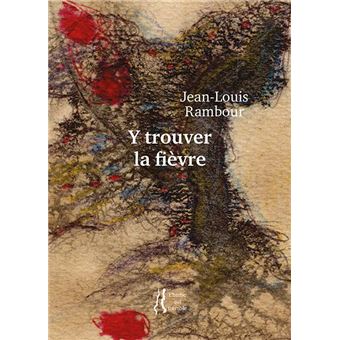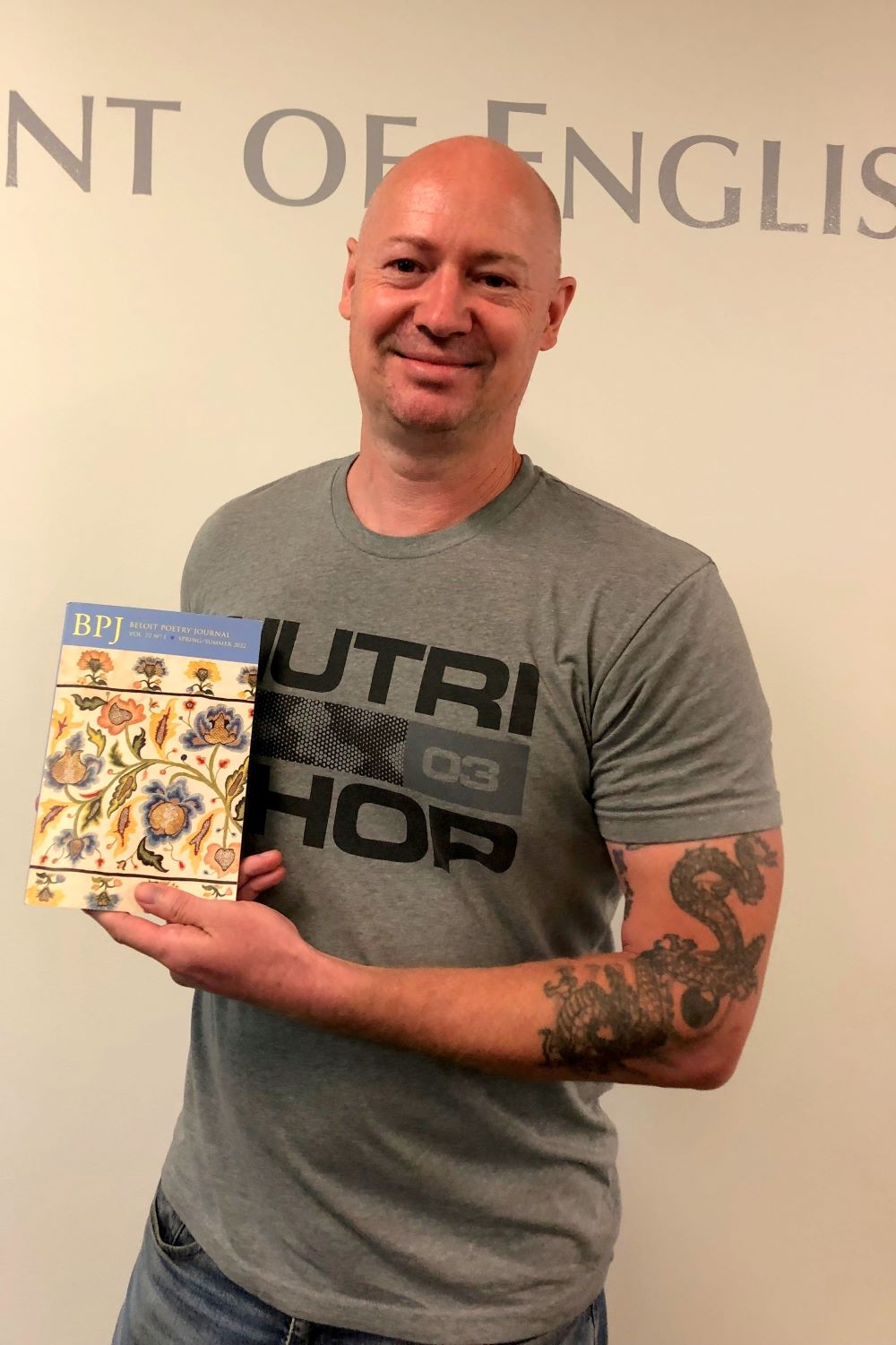STANISLAS RODANSKI DANS LES METAMORPHOSES DE L’ECHO
ENTRE OUBLI ET SOMMEIL
En écrivant dans son journal à l’âge de dix-sept ans : « Il semble que le feu ait pris aux poudres », Stanislas Rodanski a déjà tout dit. Jamais par la suite, il ne considérera la poésie comme un moyen d’expression, mais comme un mode de connaissance. « Tout acte n’est valable qu’en fonction du SENSIBLE qu’il implique et qu’il projette », a‑t-il écrit dans la mythique revue surréaliste Néon.
En 1947, après avoir contacté André Breton, à qui il écrivit : « J’ai dix-neuf ans, je refuse ma solitude morale et je refuse l’amitié des imbéciles… Je ne suis pas encore fou », Stanislas Rodanski signa le manifeste collectif Rupture inaugurale, intégra le mouvement surréaliste et la revue Néon, dont il avait trouvé le titre. Sa collaboration à l’activité collective fut de courte durée et il s’éloigna du groupe en 1948. Fasciné par les grands dandys de l’aube du surréalisme, Arthur Cravan, Jacques Rigaut et surtout Jacques Vaché, auquel il lui arriva de s’identifier, Stanislas Rodanski était surréaliste dans la solitude, comme l’a écrit Jean-Michel Goutier, avant de devenir surréaliste dans le silence. Ivan, le personnage énigmatique du roman à clé d’Alain Jouffroy, Le Temps d’un livre, n’est autre que Stanislas Rodanski. Il rêvait de visiter l’Inde et s’engagea pour l’Indochine. Porté déserteur, c’est de la Section spéciale où il fut interné que parviendront au Soleil Noir ses réponses à La Révolte en question et au Temps des assassins. Rodanski choisit, en 1954, de faire sauter de l’intérieur les réseaux de communication et de se retrancher volontairement dans le silence d’une maison de santé de Lyon. En 1975 (« La mort est une distraction passagère »), il accepte néanmoins l’idée de la publication de La Victoire à l’ombre des ailes. « Quand je l’ai connu en 1947 à Paris au sein du groupe surréaliste qui venait de se reconstituer autour d’André Breton, a écrit Sarane Alexandrian (in Les Hommes sans Epaules n°23/24, 2007), Rodanski préparait un livre qu’il avait intitulé Cours de la Liberté, en fonction d’une rue de Lyon où il avait fait, je crois, une rencontre mémorable. Les fragments qu’il me lut de ce livre en tête à tête me firent penser, par leur verbe crispé, déchiré, traversé d’images tragiques, qu’il se situait dans la lignée d’Antonin Artaud et de Roger Gilbert-Lecomte, et qu’il pourrait bien avoir un jour sa place aux côtés de ces prédécesseurs qui ont pratiqué l’écriture des abîmes. Nous avions projeté à plusieurs de faire une revue, avec des moyens de fortune, ayant la forme d’un Journal de rêve, dédié à l’aventure poétique et à la révolution de l’imaginaire. Typographie bizarre, textes calligraphiés, dessins fantastiques, comptes-rendus signés par les emblèmes du Zodiaque, devaient la caractériser. Le problème était d’en trouver le titre, et pour cela, nous nous réunîmes chez le peintre Victor Brauner, qui habitait à Montparnasse l’ancien atelier du douanier Rousseau, et nous nous lançâmes à la tête toutes sortes d’appellations selon la technique des associations libres. Nous n’étions pas satisfaits de nos trouvailles lorsque Rodanski, jusqu’alors distrait et évasif, dit soudain avec une certaine insistance : Néon. Nous adoptâmes aussitôt avec enthousiasme ce titre, qui symbolisait la lumière de la modernité. Il revient donc à Rodanski le mérite d’avoir donné son nom au premier organe surréaliste d’après-guerre, Néon, dont l’apparition souleva quelques polémiques à l’époque, parce qu’il opposait le mythe à la réalité quotidienne, la magie à la politique, l’érotisme à la religion, et le mystère de la vie à l’épaisse grossièreté du monde. Rétrospectivement, sachant quel fut son destin, il me semble que Rodanski en s’écriant « Néon » révélait ce jour-là la clé de sa personnalité. Son inconscient, sollicité par nos improvisations, l’amenait à se définir en jouant sur un mot, comme nous aimions tous à le faire en des recherches sémantiques allant jusqu’au calembour. Il parlait bien d’une lumière nouvelle, certes, mais il pensait sans doute en même temps « Je suis né On », comme Rimbaud avait dit « Je est un autre ». Il était né On, ce qui paraît impossible. Tout le monde est Je pour soi-même, Tu ou Il pour quelqu’un, Nous avec ses proches. Lui, il ne tenait pas à soi-même et il ne se souciait pas d’être un autre: il n’était pas Lancelot, chevalier du Lac, mais chevalier du On. Avant de s’enfermer dans la solitude et le refus de l’expression, Rodanski s’est encore apparenté au groupe des surréalistes dissidents qui ont rompu avec l’Officialité du mouvement, pour des raisons de convenance personnelle. Il n’y a pas eu d’exclus en cette affaire, mal connue des historiens et des critiques : nous sommes partis volontairement, et même sur un éclat, d’une communauté agitée de contradictions passagères. Cette légende de l’exclusion a été entretenue par un communiqué que publièrent dans Néon ceux qui le reprirent avec nous, et qui rédigèrent quelques années plus tard une note excluant Max Ernst. Ces querelles de famille spirituelle sont sans importance pour juger des destinées poétiques, et Rodanski reste, malgré sa longue retraite, un représentant de la révolte très particulière de quelques-uns au lendemain de la Libération, comme il apparaît aujourd’hui, à travers sa biographie et ses écrits, l’exemple même de l’individualité inclassable, indéfinissable et finalement exceptionnelle. »
Lire Rodanski, à l’instar de Lautréamont, c’est définitivement rompre avec la littérature comme avec le réel, ses mesquineries, sa médiocrité et ses bassesses. Lire Rodanski, c’est lire la vie comme elle n’a jamais été vécue et écrite auparavant ; la vie qui s’incarne dans un magma d’images, une éruption de métaphores, qui n’en rappellent aucunes autres et ne laissent pas indemnes qui s’y frottent. Lire Rodanski, c’est aborder de plein fouet et sans complaisance aucune, les « terres fortunées du songe », chères à son ami Sarane Alexandrian. Dans sa vie, dans ses écrits, Rodanski a incarné authentiquement le surréel : « Il est, seul au bord des dernières flammes, entre oubli et sommeil, là où solitude et destinée se confondent dans l’aube infuse d’un brouillard d’homme, hésitant au bord de lui-même et pourtant près de se trouver. Il brûle et dans la brume de son être noyé de lait, ses yeux vont éclore », (in Prométhée).
Mais de qui parle-t-on ? Qui était vraiment Stanislas Rodanski, né Bernard Glücksmann ? Il est né le 30 janvier en 1927, à Lyon. 27 ans plus tard, après avoir été raflé en novembre 1944 et déporté en Allemagne par les nazis ; après moult incartades (six arrestations par la police entre 1947 et 1949), qui l’ont mené aux extrêmes ; après avoir participé durant une année au mouvement surréaliste et notamment à la création de Néon, l’organe des jeunes novateurs du groupe, aux côtés de ses amis Sarane Alexandrian, Claude Tarnaud, Victor Brauner ou Alain Jouffroy ; novateurs qui entendaient situer le surréalisme au-delà des idées, par opposition aux orthodoxes marxisants ; après s’être engagé dans l’armée pour voir du pays pour se porter déserteur ; après avoir donné quelques publications dans des revues confidentielles et publier un seul livre, absolument magique, qui passera totalement inaperçu, La Victoire à l’ombre des ailes, et encore, sur la demande insistante de l’éditeur François Di Dio; Rodanski, après trois années passées au centre psychiatrique de Villejuif, de 1949 à 1952, entre volontairement à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu (290, route de Vienne, Lyon 8e), dans la périphérie de Lyon, pour n’en ressortir que mort, vingt-sept ans plus tard, dans la nuit du 22 au 23 juillet 1981.
Qui était vraiment Stanislas Rodanski ? Bernard Glücksmann ? Le chiffre 27 ? « Celui qui était surréaliste dans la solitude avant de le devenir dans le silence », à répondu Jean-Michel Goutier.
« Personne », à répondu Alain Jouffroy : « Son identité était imaginaire. » « Le prophète à la voix blanche dont les révélations sont hors du temps… L’exemple même de l’individualité inclassable, indéfinissable et finalement exemplaire », à répondu Sarane Alexandrian. Rodanski répondra, quant à lui : « Qui suis-je ? Toujours le même revenant, ce qui revient à dire encore un autre. » C’est que, hanté par les héros de La Table Ronde comme par certains faits divers, frère de Rimbaud, de Nerval, de Nietzsche, de Cravan, de Rigaut, de Vaché et d’Artaud, et persuadé, comme Novalis, que la poésie est « le réel absolu », Rodanski poursuivit toute sa vie un Graal qui avait des allures de Paradis perdu. Mobilisant toutes ses forces, cette quête le confronta très vite à de sérieux problèmes d’identité. Car, quand il se prend pour Lancelot ou Tristan, ou quand il choisit Astu (le dernier mot du dernier écrit par Nietzsche, avant de basculer dans la folie), comme mot de passe, il s’agit bien moins de brouiller les pistes, que d’un véritable sentiment de réincarnation, d’une mise en question radicale de soi. Rodanski, dans A perte de vue, écrit : « Fanal de Maldoror, où guides-tu nos pas ? ». Il errera toute sa vie entre le « Je est un autre » de Rimbaud, et le « Je suis l’autre » de Nerval. Ce qui va de soi ne l’intéresse pas. Seule l’inaccessible, le Merveilleux, la beauté convulsive ; tout ce qui rôde aux extrêmes confins du désir et du temps, de la rupture, lui semble digne d’attention. Toujours aux aguets, constamment dans un « état d’âme dont l’âme est absente », il devient l’autre. Rodanski devient le spectateur de sa propre aventure : « Au souvenir des évènements de ma vie, j’éprouve le sentiment qu’il s’agit d’une fiction où il me serait impossible de démêler la chimère de la vérité », écrit-il dans En mettant au point ces récits. L’amour, le rêve d’amour, les mobiles privilégiés de sa quête, s’incarnent dans un mythe, où l’ombre et la proie finissent par se confondre. « Je suis prisonnier des liens de la lumière, roué vif sur le cercle de l’évolution d’êtres qui se réincarnent », écrit-il dans Des proies aux chimères. Mêlant sans cesse le vécu à l’imaginaire, visionnaire, Rodanski joue sa vie sur le hasard objectif, des signes, des intuitions, des rencontres : « J’ai toujours attendu le coup de grâce, l’évènement fondant comme la foudre lors des stations que je prolonge dans les bars en dehors des heures d’affluence », nous dit-il dans Des proies aux chimères. Se situant toujours entre déséquilibre et incarnation, apparition et disparition, Rodanski a choisi l’asile comme lieu de survie. Dans ce voyage sans retour, Rodanski a très vite compris qu’il n’avait d’autre navire que celui de son moi désancré, dérivant au gré des émotions et des images ; d’où sa fascination pour l’inconnu et pour la mise en vie, puis la mise en mots du surréel, du désir forcément inachevé. Rodanski à donné une âme au rêve ; un rêve qui, comme la révolte, n’a pas de fin : « Le souffle qui traverse un poème, son envolée, c’est toujours le passage de ce grand aigle blessé dans l’œil augural des visionnaires », (Fragment du liminaire in Cours de la liberté).
Nous ne saurions enfin omettre de signaler l’un des évènements majeurs du premier semestre 2012 : « Les Horizons perdus de Stanislas Rodanski », soit un ensemble d’exposition (du 26 avril au 7 juillet 2012, à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, à Lyon) et d’évènements superbes (rencontres-lectures, colloque, installations, projection de films, à toujours à Lyon), proposés et produits par l’Association Stanislas Rodanski (stanislas-rodanski.blogspot.fr).
- Nimrod : Lettre à Christophe Dauphin à propos de Totem normand pour un soleil noir - 7 juillet 2024
- Nimrod : Lettre à Christophe Dauphin à propos de Totem normand pour un soleil noir - 1 novembre 2022
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO - 1 juillet 2022
- LES GŌSĀNS DE LA GRANDIOSE ET TRISTE PATRIE IRANIENNE DE KATAYOUN AFIFI - 3 mai 2022
- JEAN-PAUL BELMONDO ET RIMBAUD, L’AN 1969 DE « POÉSIE 1 - 21 septembre 2021
- Jacques Simonomis - 5 juillet 2021
- Portrait du poète en comédien : Hommage à Yves GASC - 4 janvier 2019
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO - 5 juillet 2018
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (3) : CHANTAL T. SPITZ - 5 juillet 2018
- Un poète à Mayotte : William Souny - 5 juillet 2018
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (2) : FLORA AURIMA DEVATINE - 5 juillet 2018
- La revue des revues de Christophe Dauphin - 15 février 2013
- Un chèque en blanc - 4 janvier 2013
- Sur deux livres récents de Roland Nadaus - 27 décembre 2012
- Stanilslas Rodanski dans les métamorphoses de l’écho - 19 juillet 2012
- Jacques Bertin, Les Traces des combats - 16 juin 2012
- Revue des revues de Christophe Dauphin - 16 juin 2012
- Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen, La Mort, c’est nous… - 10 juin 2012
- Grzegorz Przemyk, poète assassiné - 1 juin 2012