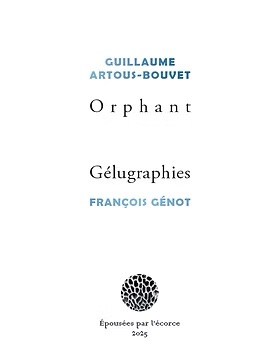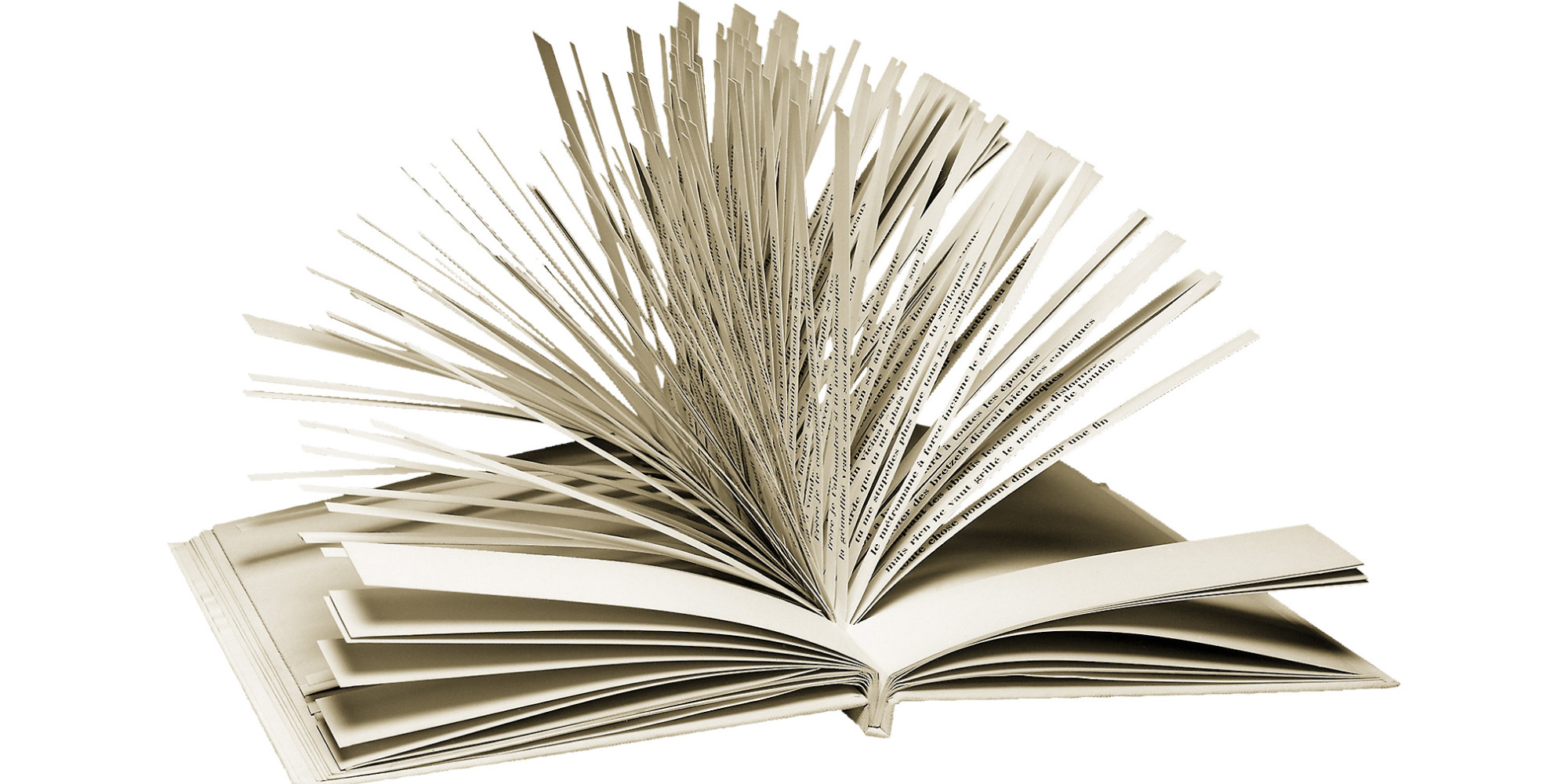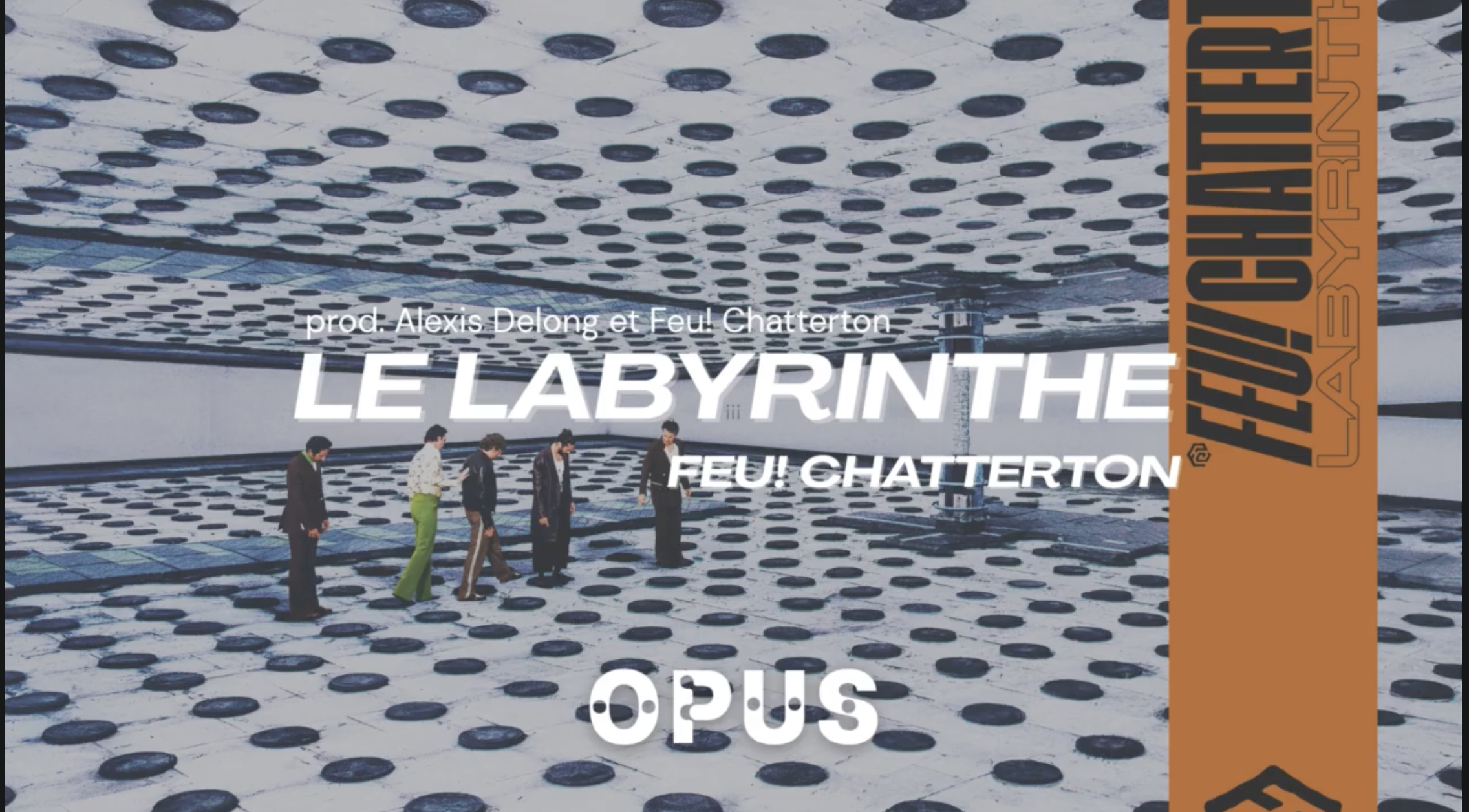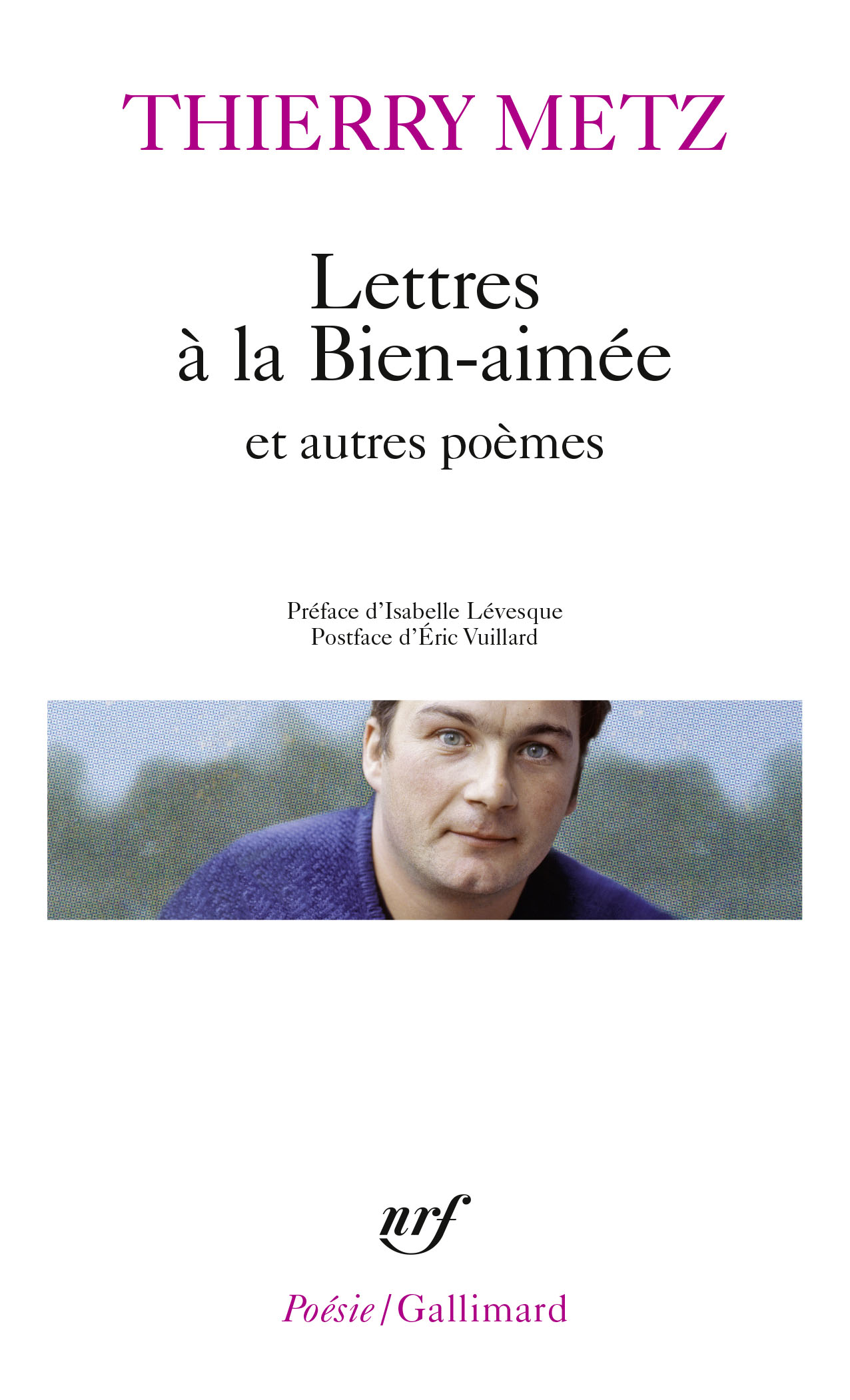CHANTAL T. SPITZ, POÈTE DES RÊVES ÉCRASÉS
Chantal T. Spitz est née le 18 novembre 1954 à Pape’ete (Tahiti). Elle est élevée à « l’occidentale » dans une famille bourgeoise, formant partie de l’aristocratie « demie » issue des unions entre les descendants des premiers colons et les filles des notables autochtones. Elle se détourne rapidement des auteurs français que lui impose le lycée pour découvrir les écrivains océaniens, sud-américains et plus largement toutes les littératures issues des ex-colonies, avec lesquelles elle se sent une parenté : elle tire de ses lectures l’impression de faire corps avec un corps de douleurs historiques : « Je ne me sens pas liée aux pensants français sous prétexte de langue commune. Je me sens délibérément liée à tous les pensants colonisés à tous les sentant meurtris parce que leur histoire est la mienne leur déchirure est la mienne. »
Dès l’obtention de son baccalauréat, elle part dans les années 70 à la rencontre de son peuple et de sa culture, dans le Pacifique sud. Elle s’engage sur le front culturel, indépendantiste, et participe également au mouvement anti-nucléaire (né après les premiers essais français de 1966), avant de devenir, tour à tour, institutrice, conseillère pédagogique et conseillère technique au Ministère de la Culture, militant contre le néo-colonialisme, la réécriture de l’histoire qui perpétue un mythe et fige les Tahitiens dans une caricature de bon sauvage : « Une image. C’est à ça qu’est réduit mon pays. À une image, sur laquelle sont plaquées d’autres images : la vahine avec tous les phantasmes qui lui sont attachés. Depuis quelques années, la rejoint le täne tatoué, lui aussi porteur des phantasmes féminins et sous cette image de carte postale paradisiaque, se battent des humains, englués dans des misères sans fond. Ces invisibles, ces insonores, ne sont pas le côté sombre d’un pays rêvé. Ils sont le sel et le terreau d’une société tenue par une classe, qui s’étourdit de vanités de superficialités et érige des murs, afin de les invisibiliser les insonoriser un peu plus chaque jour. J’ai pour elles, pour eux, une tendresse particulière qui me les rendent bien plus aimables, dans le sens littéral du terme, que tous celles tous ceux, qui s’efforcent de prendre place sur l’image paradisiaque. »

Sa première publication, L’île des rêves écrasés, premier roman tahitien, davantage une épopée, narrative, mêlant prose et poésie, imprégné de tradition orale, publié en 1991, est salué en Polynésie française, comme le seront nombre de ses publications, comme un évènement et un scandale, allant des félicitations les plus élogieuses aux condamnations les plus frénétiques.
Saga familiale, avec l’amour en fil conducteur, dans une Polynésie nucléarisée et plongée dans un « malaise omniprésent », L’île des rêves écrasé, qui est également le premier roman tahitien traduit en anglais, résonne comme un cri, dont les mots jaillissent pour combattre le cliché de la vahiné, des cocotiers sur les plages paisibles, symboles d’une colonisation, faite en douceur. Ce livre est écrit avec l’encre noire de la révolte : véritable boulet propulsé dans le paradis des lagons artificiels des clichés
L’auteure y raconte le destin d’une famille polynésienne, mâtinée de Papa’a (étranger, blanc), sur trois générations comme autant de points de vue sur l’histoire de son peuple. Cri d’alarme pour une identité en perdition, révolte contre les déséquilibres établis, chant d’amour pour ces hommes et ces femmes colonisés ; l’auteure déconstruit le mythe du bon sauvage, décliné depuis Bougainville par tant d’Européens, écrivains, peintres ou photographes, venus en Polynésie chargés de leurs fantasmes et de leurs rêveries édéniques.
Ses bêtes noires ? Pierre Loti et son livre Le mariage de Loti (1880), dont les belles vahinés se prélassent au bord des lagons. Gauguin, dont les « sempiternelles mauvaises reproductions » s’étalent dans les échoppes pour touristes et dont le nom omniprésent, « se confond avec les Marquises. » Enfin, toute « la litanie colonialement correcte », de ceux qui se sont substitués aux noms de ses ancêtres.
C’est donc, en toute logique, qu’en 2001, Chantal Spitz participe à la belle aventure de la revue littéraire Littérama’ohi, crée en 2001, à l’initiative de la poète Flora Devatine et dont elle a pris la tête en 2007, pour attester de l’existence d’une littérature autochtone et en faire connaître la richesse et la spécificité. Mais, n’allons pas trop vite ; pour Chantal Spitz, la littérature n’a pas à être étiquetée, cloisonnée, classifiée, elle est. Littérature : « Je ne rentre pas dans ce genre de débat qui à mon sens n’a, finalement, d’autre but que de refuser à la littérature écrite en langue française dans les actuelles colonies ou anciennes colonies françaises l’existence en tant que littérature. Elle a sa place dans la littérature mondiale et en étant qualifiée elle est disqualifiée. »
Ajoutons, bien évidemment, que la situation de la femme préoccupe Chantal Spitz tout autant. Lorsque qu’un journaliste (in outremers 360°) lui demande : « À l’époque pré-européenne, la femme avait une place plus prépondérante, pourquoi est-ce que cela a changé ? » Chantal Spitz répond : « Les grands bouleversements sociaux, politiques, et économiques, dans notre pays, sont le résultat de la christianisation et de la colonisation. Il n’est qu’à regarder comment étaient considérées les femmes européennes au XVIII° siècle, pour comprendre pourquoi il était essentiel aux mâles européens de reproduire la même organisation sociale chez nous. Aujourd’hui, les femmes de la Polynésie française ont le même statut que les femmes du pays colonisateur chrétien. Inférieur à celui de l’homme »

Chantal SPITZ, L’Ile des rêves écrasés, Les Éditions
de la plage, 1991. Rééd. Au Vent des Îles, 2003.
Il y a, à juste titre, que le mythe de la vahiné révolte Chantal Spitz au plus haut point : « Une grande partie de mon travail s’attèle à la déconstruction de ce mythe, qui tétanise les femmes de mon pays dans un carcan fabriqué par l’Occident… Nous avons troqué notre identité contre un mythe dont nous avons fait notre nouvelle identité. Il n’est qu’à écouter certains discours autochtones, pour entendre le gouffre entre la perception de nous-mêmes, fondée sur le mythe auquel nous nous efforçons de correspondre et la nostalgie de nous-mêmes, amputés d’une identité qui perdure malgré tout… Je ne suis pas sûre que le statut de la femme en Polynésie française soit lié au mythe. Il s’agit plutôt d’une organisation sociale et politique, orchestrée par les mâles au pouvoir depuis notre colonisation. Il n’y a aucune différence entre le statut de la femme en France et celui de la femme chez nous. »
Aujourd’hui retraitée de l’enseignement, mais non pas du combat, mère de trois garçons, Chantal Spitz, voix majeure de la vie artistique et intellectuelle polynésienne, vit à Huahine (Îles sous le vent) sur le motu Maeva, où elle poursuit son œuvre, qui exprime la douleur d’un peuple aux prises avec une histoire coloniale et en reconquête de son identité.
Son propos est aux antipodes d’une sublimation aveugle, qui placerait l’avenir du peuple polynésien dans un retour à des temps mythiques. Consciente du risque de succomber au mythe inverse, de racines imaginaires, de « substituer à la mythologie forgée par le colonisateur une contre-mythologie », Chantal Spitz mène une réflexion plus ambitieuse sur l’identité océanienne.
C’est ainsi, que dans un discours, prononcé le 26 juin 2008, devant l’Assemblée de Polynésie, elle put dénoncer, avec une conviction affermie : « Le risque de tourner le mépris de nous-mêmes en conflits fratricides. Le risque de succomber à la mythisation des origines la célébration de racines imaginaires l’exaltation sectaire de la culture traditionnelle. Le risque de substituer à la mythologie forgée par le colonisateur une contre-mythologie « un mythe positif de [nous]-mêmes », nous engageant à notre tour sur le chemin d’une nouvelle désidentification. Nous sommes là pour un espoir une histoire une mémoire. Nous sommes là pour deux mots, qui posent notre historicité avèrent notre temporalité nous mettent en sonorité : résistance, résignation, ni l’un ni l’autre, et pourtant l’un et l’autre. »
À lire : L’Ile des rêves écrasés (Les Éditions de la plage, 1991. Rééd. Au Vent des Îles, 2003), Hombo, transcription d’une biographie (éditions Te Ite, 2002), Pensées insolentes et inutiles (Éditions Te Ite, 2006), Elles, terre d’enfance, roman à deux encres (Au Vent des Îles, 2011), Cartes postales (Au Vent des îles, 2015).
Ces hommes pâles, au corps différent, à la peau blanche, ont posé leur regard sur nos femmes.
Vahine7 mā’òhi 8 à la peau dorée
Fille du soleil
Fille de la lune
Longs cheveux noirs déroulés
Comme les cascades dévalant les montagnes
Grands yeux sombres
Comme la mer aux profondeurs infinies
Vahine mā’òhi
Rayon de soleil
Poussière d’étoile
Éclat de lune
Mystérieuse le jour
Magique la nuit
Créée d’amour pour l’amour
Belle parmi toutes les femmes
Rêve de l’homme blanc
Toujours désirée
Parfois aimée
Vahine mā’òhi
Jalousée de la femme blanche
Chantal SPITZ
(Extrait de L’Ile des rêves écrasés, Les Éditions de la plage, 1991. Rééd. Au Vent des Îles, 2003).
- ALAIN DELON, HENRI RODE & LES HOMMES SANS ÉPAULES - 6 novembre 2024
- Nimrod : Lettre à Christophe Dauphin à propos de Totem normand pour un soleil noir - 7 juillet 2024
- Nimrod : Lettre à Christophe Dauphin à propos de Totem normand pour un soleil noir - 1 novembre 2022
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO - 1 juillet 2022
- LES GŌSĀNS DE LA GRANDIOSE ET TRISTE PATRIE IRANIENNE DE KATAYOUN AFIFI - 3 mai 2022
- JEAN-PAUL BELMONDO ET RIMBAUD, L’AN 1969 DE « POÉSIE 1 - 21 septembre 2021
- Jacques Simonomis - 5 juillet 2021
- Portrait du poète en comédien : Hommage à Yves GASC - 4 janvier 2019
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO - 5 juillet 2018
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (3) : CHANTAL T. SPITZ - 5 juillet 2018
- Un poète à Mayotte : William Souny - 5 juillet 2018
- TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (2) : FLORA AURIMA DEVATINE - 5 juillet 2018
- La revue des revues de Christophe Dauphin - 15 février 2013
- Un chèque en blanc - 4 janvier 2013
- Sur deux livres récents de Roland Nadaus - 27 décembre 2012
- Stanilslas Rodanski dans les métamorphoses de l’écho - 19 juillet 2012
- Jacques Bertin, Les Traces des combats - 16 juin 2012
- Revue des revues de Christophe Dauphin - 16 juin 2012
- Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen, La Mort, c’est nous… - 10 juin 2012
- Grzegorz Przemyk, poète assassiné - 1 juin 2012