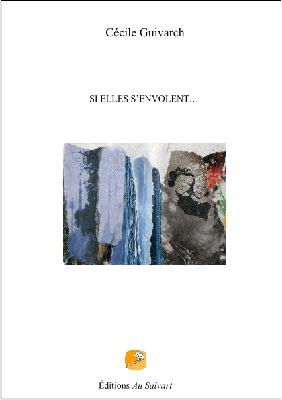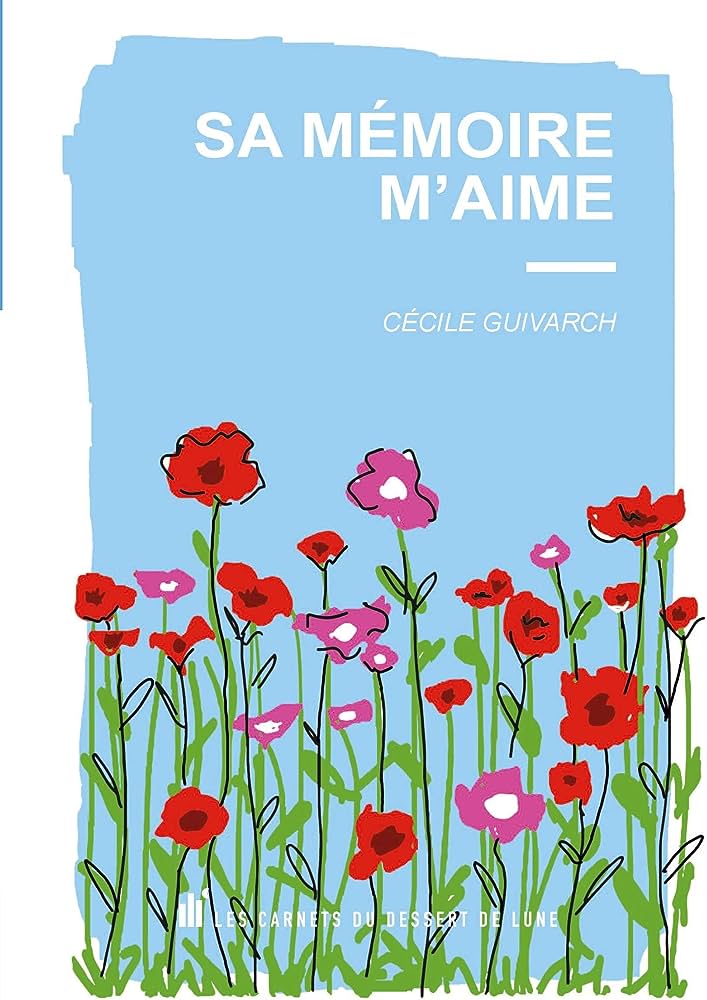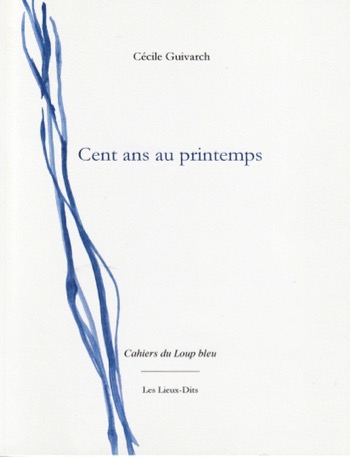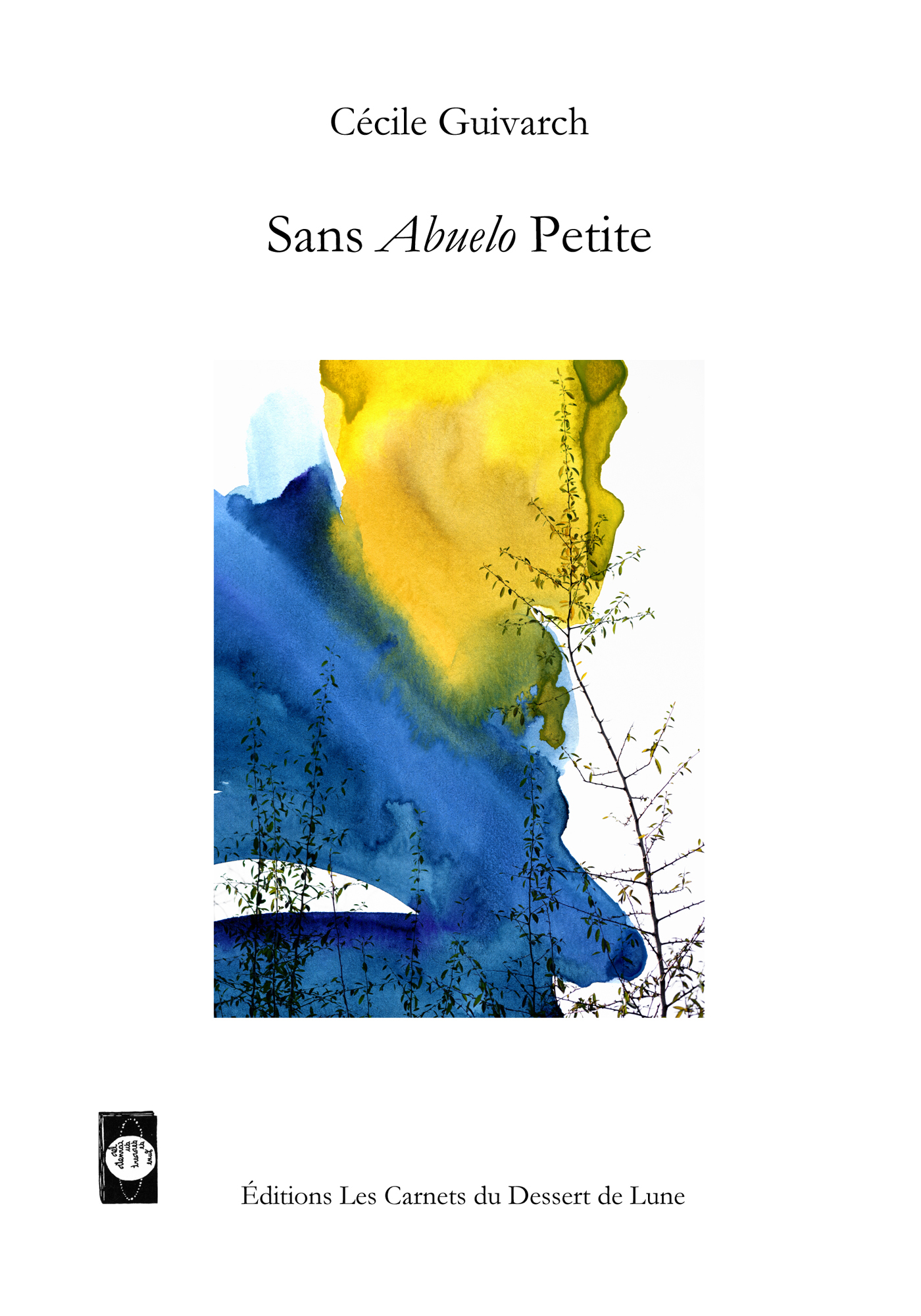« Renée, mon aïeule », ce sont les premiers mots du récit bouleversant que nous livre Cécile Guivarch et déjà avec ce titre Renée, en elle, toute la présence puissante de cette aïeule dans le corps de l’auteur. C’est une aïeule, c’est toute une généalogie qui est rappelée avec elle, avec dates et lieux, celle d’un début XIXe siècle, « une époque où l’on mourrait facilement de maladie, de dysenterie, de froid ou de faim » et où la mort, sur laquelle on ne devait pas s’attarder, était banalisé.
Depuis les visites nocturnes répétitives de son aïeule, Cécile Guivarch va recomposer les plaintes, les murmures, les sanglots, la vie de cette aïeule qui pourrait être aussi la nôtre.
« De sa bouche s’écoule la rivière de son corps, de ses peines, de ses souffrances ».
Renée lui parle dans son patois breton que Cécile ne connait pas, toutes les nuits elle l’exhorte de s’appuyer sur sa langue à elle, le français et de l’aider à déchiffrer ce qu’elle a à dire.
Elle va refaire le chemin jusqu’à elle, reconstruire, réinventer une vie au plus près de celle qu’a du être celle de Renée, lui donner l’épaisseur qu’elle n’a pas eu, et que du fond des âges elle est venue réclamer.
Peu à peu dans l’ombre vont se dessiner toutes les « couleurs de Renée », du rose qui lui colorait les joues, au rouge et noir du sang qu’elle a sacrifié, à chacune de ces naissances.
Plusieurs enfants sont nés de Renée, beaucoup n’ont pas eu cette chance, et « ont dévalé les rivières de son sang ». Inscrits au régistre « Anonyme G ». Dans cette époque où se sont succèdées les naissances, d’un enfant à l’autre, parfois portant le même prénom pour « remplacer » celui qui n’avait eu le temps de voir le jour, il fallait oublier et si possible oublier vite, ces enfants morts-nés qui n’avaient pas même droit au registre civil. (Faut-il rappeler que c’était encore valable jusqu’en 2001!)
Les femmes ont toujours perdu des enfants, les femmes ont toujours eu peur de perdre leurs enfants.
Cécile Guivarch décrit ici la douleur de ces pertes dont les mères restent inconsolables. « Je me souviens de ces visites où elle ne me parlait que de la page « funérailles » du journal local. Je ne comprenais pas pourquoi ma grand-mère parlait uniquement de ceux qui étaient morts ou de de ceux qui se mourraient. »
Les mères restent inconsolables, c’est surtout parce qu’en banalisant ces morts à peine nés, en forçant à oublier, oublier ces morts, et qu’on nous apprenne à oublier, en ne donnant pas une légitimité à ces naissances, les mères savent, elles, que les hommes qui ont accompli de tels actes, niaient jusqu’au sacré de la vie.
Cécile Guivarch va donner au lecteur dans un récit halluciné et détaillé, la douleur de ces naissances avortées : « C’est sa couche d’un rouge vif que j’entrevois parfois. Elle contraste avec l’ombre de sa demeure. Cela fait un peu comme un film en noir et blanc où le rouge est la seule couleur ».
Renée en elle, c’est l’histoire de toutes les femmes qui ont traversé le temps, des femmes dures au labeur et courageuses dans leurs maternités multiples, encore plus quand elles étaient vouées à donner la mort plutôt que la vie.
Renée en elle, c’est toute la tendresse de l’auteur pour cette aïeule qui sanglote la nuit dans son sommeil, blottie tout contre elle.
Renée en elle, c’est un envoûtement, et une volonté de ne pas mourir, un désir de croire que quelqu’un quelque part un jour vous fera exister à nouveau.
Ces fragments de mémoire posés sur la page disent chacun un bout de l’histoire de Renée, cette aïeule qui habite toujours le cœur de Cécile Guivarch.
« Ce qu’il y a avec Renée c’es qu’elle me vient toute en morceaux, tessons de mosaïques »
et ce qui est troublant dans cette mosaïque reconstituée par petits bouts d’humanité déchiquetée, c’est le regard de la jeune femme sur celle qui devient une figure héroïque. Quand elle la décrit, penchée sur elle au milieu de la nuit ou « de dos, qui se soulève au milieu des sanglots ». « D’où je suis je ne vois que son dos » précise Cécile et ces images superposées sont d’une réalité prégnante et très émouvante.
On s’attache à la figure de cette mater dolorosa qui « passait ses nuits à se cogner la tête contre le mur, à la fin son front était devenu dur comme de la pierre », dur comme ce ventre qui donnait la vie et la mort une fois sur deux.
Cécile fait revivre son aïeule dans le corps du texte et toutes ces larmes qu’elle ne peut plus retenir à la perte de l’unique fille morte dans son berceau « elle dit que c’est elle qui aurait dû mourir et pas l’enfant ».
A deux siècles de distance, elle est la fille de cette aïeule qui a pleuré toute sa vie la perte de ses enfants et est devenue folle de chagrin à la perte de son unique fille, dans le berceau.
Le deuil est une réparation quand il ouvre sur une rédemption, Renée a vécu en criminelle ses pertes, elle a cherché une justice parmi les hommes, qui ne l’ont pas cru quand elle a dit qu’elle n’avait pas volé et l’ont jeté en prison, elle a tellement absorbé sa culpabilité que les hommes se sont chargés de l’accuser à tort.
Les toutes dernières pages, Cécile a ce trait de génie de faire parler son aïeule, elle lui rend sa voix deux fois, celle-ci au bout de sa quête est devenue audible. Ces pages diront tout le drame terrible de sa vie et ce qu’elle a laissé derrière elle comme souffrance transmise de génération en génération. Dans la violence des dernières pages nous restons comme tétanisés face à tant d’accablement.
Le texte de Cécile Guivarch devient le suaire de ce corps douloureux, un endroit où inscrire celle qu’on a voulu oublier.
- Deux heures avec Edgar Hilsenrath - 3 mars 2019
- Fil de lecture MJ Desvignes : Lyonel Trouillot, Emmanelle Imhauser, Michaël Glück - 30 novembre 2015
- REVUE INTRANQU’ÎLLITÉS, Hors-série 1&2 - 20 octobre 2015
- Fil de lecture de M‑J Desvignes sur : S.Marot, JB Pedini, L Raoul - 29 septembre 2015
- FIL DE LECTURES DE M‑J DESVIGNES : Diab, Fenzy, Salzarulo, Furci, Motard-Avargues - 31 août 2015
- Maël Guesdon, Voire - 24 août 2015
- Raymond-Jean Lenoble, Mémoires de l’oubli - 26 avril 2015
- Attila Jozsef, Le mendiant de la beauté - 17 avril 2015
- Cécile Guivarch, Renée en elle - 29 mars 2015
- Fabrice Farre La figure des choses - 5 janvier 2015
- Claude Chambard, Carnets des morts - 28 décembre 2014
- Fabrice Farre, Le chasseur immobile - 9 novembre 2014
- Angèle Paoli, le sel de la mer, le fracas des mots - 29 juin 2014
- Un grand vent s’est levé de Danny Marc - 6 avril 2014