LISIANTHUS
Sylvie MAROT
Editions de la Crypte – 2015 – 70p – 12 euros
Sous-titré « Fragments », Lysianthus, publié aux Editions de la Crypte est le premier recueil de Sylvie Marot. Un recueil en forme de fragments poétiques disposés sur la page en haut et en bas laissant place à un grand vide au milieu comme celui qui emplit le cœur de la narratrice et que raconte cette histoire de « désunion ».
Un vide que creuse l’absence avec son désir douloureux non de remplir le creux mais bien de s’y engloutir.
Ce qui frappe dès les premiers mots, et avec ce titre recherché, c’est la richesse de vocabulaire, la beauté de la langue, l’amour du mot juste et coloré. Comme dans l’écriture où l’élagage se fait par suppression successif, de collage en juxtaposition, le corps épouse cette nécessité. « Il allait falloir effectivement amputer, couper, enlever, retrancher, sectionner, supprimer, trancher ».
Au fil des jours et des nuits, au milieu des mots et des maux, tenter de s’abstraire de cette souffrance que provoque toute rupture, par tous les moyens jusqu’à l’obsession.
« Elle veut colorier tout le vide quitte à dépasser les bords ».
Le style décalé émeut par la sincérité du propos qui, au début fait sourire : « Elle plonge la tête dans le tambour de la machine à laver. La ressort. Rien ».
Il y a une douceur dans l’évocation de tout ce silence qui se fait autour de la narratrice qui nous entraîne dans son observation du monde comme si elle-même était hors de ce corps qui souffre.
« Dans le jardin un hérisson vagabonde. La lumière de la ville découpe ses doux piquants ». Le hérisson est métaphore de ce qui pique, gratte à l’intérieur du cœur. Tout pique, tout gratte, tout est froid et inconfortable. La présence de ce corps au milieu des autres est éclatée, c’est un éparpillement, une dispersion dans l’espace. Elle n’est pas en dehors de son corps, c’est son corps qui est éparpillé dans l’espace, se retrouve dans les piquants du hérisson, sur le rebord des rails, qu’elle imagine jonchés de débris si…
Les nuits sont les fantômes des jours. « Nocturne/adossée à un arbre/du lierre m’enserre/mon cœur se comprime/ma peau devient écorce//diurne/adossée à toi/ ton bras m’enserrait/le cœur argenté/ta main droite se posait sur mon épaule gauche. »
S’installer dans ce rêve de suicide, attendre et explorer chaque possible, sous les rails, ou par le poison, ou bien encore « attendre que quelqu’un veuille bien la suicider. Et que les tortures cessent. »
Le vocabulaire lié au corps se fond dans celui de la biologie végétale partout présente. Lisianthus c’est « une fleur à couper de la famille des gentianacées », une description nous en est donnée sur le revers de la quatrième de couverture. « Son bouquet rappelle le souvenir ou la promesse d’un tendre baiser, il livre également un message de gratitude ».
La narratrice précise cet état de déhiscence qui la contient. En biologie végétale, nous explique-t-elle, c’est l’explosion ou la dissémination des graines. En biologie humaine, la médecine parle d’ouverture ou rupture anormale d’un muscle, d’une cicatrise en cours de cicatrisation. Quelle plus juste image que celle de la déhiscence pour dire l’impossible guérison du cœur.
« Oui il l’aimait. Mais il ne voyait plus en elle, le réceptacle de ses rêves ».
Dans le silence des déplacements, il y a toujours le corps des autres, compatissants et un temps ça apaise quand s’exprime cette gratitude de la compassion fraternelle. Mais la déliquescence de l’amour est celle des corps. On perd d’abord le corps de l’autre, puis on se perd en perdant l’amour et le corps ne sait plus se diriger. Le rouge est alors la couleur de cet incendie que l’amour a d’abord allumé, puis celui du corps supplicié. Toutes les nuances du rouge se crée alors dans l’énumération progressive et langagée, dans l’éclatement des veines, dans l’éparpillement des mots dans toute leur brutalité martiale.
Les errances se ternissent de rouge, « en touchant le vermillon on se salit de rouge », peut-être celui de la folie où conduit la passion. Ce n’est pas elle qui se tue de cet amour perdu, c’est lui qui « se tient là à chaque coin de rue pour cogner son âme. Il est là à chaque angle pour l’étrangler. »
Il y a dans ce récit-poème, toute une recherche dans l’évocation d’images. Ainsi par exemple, la géographie des lieux laisse une place majoritaire à la capitale. Elle traverse Paris au rythme de son cœur vagabond, vide, vidé, qui se fatigue de tant de silence mais Paris traverse le récit plaquant comme un motif récurrent, le visage de l’amant.
Et par exemple, l’émotion du souvenir se lit dans l’image de la Tour Eiffel et du Sacré cœur qui « s’ombrent et s’embrasent… juste avant que tout s’embrase et sombre ».
L’animal comme la fleur ou l’arbre a sa place privilégiée dans le récit, la nature est partout présente au milieu des « belles choses » qu’il faut savoir trouver et regarder. Le corps épouserait volontiers une autre forme pour s’extraire de cet envahissement de la douleur. « Si elle était un animal, elle serai un okapi » ou encore « elle serait un zèbroïde. Un croisement entre un zèbre et une jument. Elle serait zhorse ».
Après le rouge, le noir, on passe ainsi de la colère à la dépression, du noir « pennage du corbeau, noir animal » à « l’oxyde de fer, la suie ». L’énumération chromatique de la souffrance n’en finit pas de colorer ses jours et les pages.
Et puis le temps a passé, remontent alors les souvenirs, peut-être ceux de l’enfance, pêle-mêle. Elle fait le décompte de ce qu’elle aimait chez lui, « elle désirait qu’il l’épanouisse et imaginait son ventre arrondi ».
S’égrainent encore et encore les couleurs, le rouge, mais aussi le vert, le jaune, le bleu, le noir omniprésent dans les mots, mais finalement le blanc aussi, ce blanc solaire « celui de la neige, du coton, du lait, de sa peau », mais aussi celui du silence.
« …son œil se fixe sur cette résistance lumineuse d’un objet amoureux qui n’existe plus ».
Dévisser. Se laisser glisser. Attendre « quelqu’un qui ne viendra pas », en s’abreuvant à la fraîcheur des fruits, note de couleur et de saveur qui envahit le texte par la grâce d’une sensualité omniprésente. Et dans le flux de la vie, se laisser emporter par la vitesse, le mouvement du train.
On est embarqué dans ce corps immobile qui respire, qui souffle, qui lâche prise par moment, s’oubliant dans la douleur mais qui s’absente surtout à lui-même et absorbe le monde autour.
Promettre l’oubli, promettre d’aller mieux, remonter encore dans les souvenirs de lui, ceux que la joie a inscrit en creux dans sa rétine, dans ce va et viens du bonheur et du malheur, de l’objet conquis puis perdu. Toujours et encore se prêter aux jolies choses, s’accrocher au réel.
« Elle rêve de ses baisers brasiers », elle n’est plus qu’un rêve, une ombre portée du désir. Sa fragilité se lit sur ses traits diaphanes, mais elle ne sait qu’une chose : « elle a perdu sa gourmandise ».
Pourtant, alors qu’elle perd son éclat, que son teint s’affadit, se déploie dans le poème la multitude kaléidoscopique des couleurs, celles que son regard capte, et qui illumine le texte, ce texte qui s’écrit quand le texte du corps s’éteint et se fond dans le silence. « Se taire. » Difficile. « Comment imposer le silence à la douleur intérieure ? »
« Dans la chambre sourde, sa solitude se cogne mollement contre les mousses triangulaires ».
Le Japon est cet autre lieu du désir, contenu dans le déploiement métaphorique de la fleur, dans le kaléidoscope du malheur, dans cette fleur, le« lisianthus » nommée aussi « rose japonaise en mémoire du pays de ses premières hybridations ». Lisianthus, c’est donc bien cette fleur à la grâce intemporelle qui domine le récit. Alors que la douleur est omniprésente, la douceur de la pluie, la caresse du vent, les odeurs de cake aux épices ou les senteurs des jardins envahissent l’espace de ces fragments à la recherche de la joie. L’ombre s’allie à la lumière de la vie partout recommencée et bientôt le silence assourdissant du corps se métamorphosera. « Sans s’en rendre compte, l’amour se terrera comme une note sourde ».
Ce récit extrêmement dense d’une dissolution, d’une fracture du cœur, de l’âme et du corps que les mots recomposent dans un kaléidoscope de rouge, de noir et de blanc est une tentative de recréer de la vie, de rematérialiser l’espace de l’absence à l’autre qui demeurera toujours, en suspension, comme une blessure qui ne se referme pas.
Sylvie Marot est née en 1976. Elle vit et travaille à Paris. Lisianthus est son premier recueil.
***
Pistes noires
Jean-Baptiste Pedini
Editions Henry – oct 2014 – 8 euros – 30 p
C’est un hors-monde plein de lumière, celui de la poésie, plus exactement d’un poème en prose que Jean-Baptiste Pedini, dans ces Pistes noires, nous propose.
Immobile, dans une observation muette et silencieuse du monde, dans « les bruits sourds de minuit », « on » se poste quelque part à l’écoute du temps, « on » le laisse passer « sans se soucier des braises ».
« On est vidé » sous la description fine et distanciée, des bruissements du monde que la neige étouffe, pourtant on est à fleur de peau, « on découvre des glaçons contre la peau, des nuits comme prises au dépourvu ».
Tout bouge, tout frémit, là perceptible à « quelques degrés à peine ». Le froid gagne.
Rejoindre où il fait chaud, la maison.
C’est une lumière aveuglante qui rejoint l’obscurité dans cette écriture aux franges du réel et du rêve… une obscure clarté…
A l’écoute, en agonie de soi, à l’écoute, les « voix nouées entre elles, comme un écho qui pousse à l’intérieur », à l’écoute des saisons qui avancent, à l’écoute toujours. Quand tout se réchauffe un peu, on se sent « moins friable peut-être ». Partout on grelotte. Dedans. « Dehors, ce n’est pas mieux ».
Dans tout ce silence et toute cette neige, les pistes noires ne sont peut-être pas celles que l’on croit. Les sens en éveil, on capte les objets immuables, l’odeur du chocolat chaud, la nature paisible, le mouvement de l’air qui épouse celui des saisons et celui de la rue. On tente de fixer quelque chose, tracer des pistes (noires) par ce simple regard immobile, peut-être à l’encre de nos vies.
Mais d’un hiver à l’autre, la neige fond, la lumière aussi passe, ses quelques éclats non plus, on ne les retrouvera pas. On n’est rien. Pas même des traces de pas noires sur la neige. « On voit à peine une silhouette, la fumée d’un soupir. C’est déjà trop ».
On croit qu’on y échappera mais « la mort nous suit depuis le premier jour ».
Ça aurait pu s’appeler « Neige » mais ça aurait renvoyé trop immédiatement à la blancheur, à la pureté, à la lumière. Ça s’appelle «Pistes noires» peut-être parce qu’il y a plus de noir que de blanc dans tout ce silence et aussi parce que le blanc, la neige s’efface toujours, disparaît, ne laissant que des traces noires, et la solitude. « L’isolement ce n’est que ça. Un ciel en friche, un instant contre soi ».
Une poésie d’un seul souffle aux phrases simples, sans fioritures, qui disent l’essentiel. Quel regard poser sur nos vies ? Où fait-il encore chaud quelque part ?
« Quand l’angoisse est trop vive. Trop blanche. Saisonnière ».
Jean-Baptiste Pedini est né en 1984 à Rodez. Vit et travaille en région toulousaine. Publications dans de nombreuses revues dont Décharge, Voix d’encre, Arpa., N4728.. Des livrets publiés chez Encres Vives, Clapàs, – 36° édition et La Porte. Recueils parus: Prendre part à la nuit (Polder, 2012), Passant l’été (Cheyne éditeur, Prix de la vocation, 2012) et Pistes noires (éditions Henry, 2014).
***
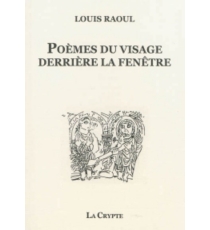
Louis Raoul – Poèmes du visage derrière la fenêtre
Editions de la Crypte –
collection : Les voix de la Crypte – 2013
Dans les Poèmes du visage derrière la fenêtre de Louis Raoul domine l’élément eau, eau du ciel et des pluies de printemps, eau mouvante, transformatrice « eau qui meurt/avec le souvenir d’une pierre d’enfance/ou d’une grenouille de Bashô »
La fenêtre ou la vitre, motif récurrent dans chaque poème, comme autant de reflets dans l’eau de ce visage en attente, celui du poète qui contemple depuis l’autre côté de la vitre, au matin ou le soir, d’une saison l’autre, perdu dans la chanson de l’air, dans l’attente, la solitude des jardins :
« D’ici
Je vous devine
Femme à venir
vous n’avez d’enfant
que la parole
je vous devine
cachée sous l’orage »
« J’ai des choses à vous dire »nous annonce le poète dès le début, mais ce sont les jours qu’il apostrophe « ces jours à venir », tout autant que cette mémoire qu’il convoque à chaque recueil, lui qui oublie tout et si souvent. Il semble justement qu’il soit question de ne pas oublier, le poète s’exerçant par l’écriture à fixer le temps, la mémoire et les paysages si nombreux et si différents. Il ne faut rien oublier…
« Il ne faut pas oublier les portes
Celle qu’on entr’ouvre
Pour faire respirer la chambre
Et cette autre où le dehors s’inquiète
De ne pas nous voir sortir
Et pousse du vent
Fraisant craquer le bois
comme un souvenir d’arbre balancé.… »
Dans la fragilité du soir et des jours recommencés, Louis Raoul nous rappelle notre vulnérabilité, et nous installe dans sa rêverie, nous transporte dans ses eaux. L’être voué à l’eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute, dit Bachelard. L’un et l’autre poètes, savent combien nos vies sont pénétrées de cet élément.
Les fenêtres du soir sont les plus silencieuses mais quand sa mémoire se fait sensorielle, passant du je au tu pour se donner le change, et mieux éprouver sa solitude, alors le poète se souvient :
« Alors tu tiens le bol
comme d’un visage
ses deux joues
et se rompt à tes lèvres
le silence du lait
s’efface le blanc
dans ta gorge »
Le besoin de se souvenir se mêle à la nécessité de retenir ces petits bonheurs si fragiles et fuyants qui traversent nos vie, renvoie à ces pertes dont on ne peut se remettre…
« Il ne me reste plus
Qu’à quitter la fenêtre
Et aller m’asseoir parmi les morts
Dans les cimetières
Les bancs n’ont pas la même façon
De nous accueillir
Ils savent ce surplus de poids
Du manque
Et il y aura ce grand silence
Dans l’automne
Jusqu’à sentir le jour peser
Sur les feuilles de l’allée »
On pense alors à Bachelard, qui dit que la peine de l’eau est infinie*(L’eau et les rêves), le rêveur silencieux près de sa fenêtre observe le dehors, replié en son dedans, perdu dans ses songes d’eau.
C’est d’une écriture concise, ciselée, où chaque mot trouve sa place dans la sobriété et le dépouillement, que le poète convoque l’enfance, la solitude, la femme, la maison des souvenirs, tout derrière la fenêtre remonte dans la lueur du soir, dans « l’air léger », « dans le rectangle d’un paysage », « dans la nuit d’une chambre à venir » ou « dans le plein jour d’un midi/passant sur les vitres. »
Biographie de Louis Raoul
Louis Raoul est né en 1953 à Paris où il réside toujours.
Il a publié une vingtaine de recueils et a obtenu en 2008 le Prix de la Librairie Olympique pour son livre Logistique du regard publié chez N&B/Pleine Page.
Depuis peu, vous pouvez découvrir son nouveau recueil qui s’intitule ; Poèmes du visage derrière la fenêtre, publié aux Éditions de La Crypte.
Bibliographie :
|
L’ombre heureuse |
1992 |
Encres Vives |
|
Le lieu où le soir a versé |
1993 |
Encre Vives |
|
Les prénoms de la mémoire |
1997 |
La Bartavelle |
|
Un front rêvant sa neige |
1998 |
La Bartavelle |
|
Au plus court |
1998 |
Encre Vives |
|
Par peur de l’équilibre |
2000 |
L’Harmattan |
|
Le sens éclaté |
2005 |
L’Harmattan |
|
Préface aux confins |
2006 |
Opales/Pleine Page |
|
L’accompagnant |
2007 |
Le Manuscrit |
|
Logistique du Regard |
2008 |
N&B/Pleine Page |
|
Reconnaître le corps |
2008 |
Clapàs |
|
La robe passante |
2009 |
Chloé des Lys |
|
Sources du manque |
2010 |
Ex Aequo |
|
Des rues sous la mer |
2011 |
Le chasseur abstrait |
|
Démantèlement du jour |
2011 |
Eclats d’encre |
|
Feuille de l’air |
2011 |
Editions de l’Atlantique |
|
Triptyque du veilleur |
2012 |
Cardère |
|
Les beaux suivants |
2012 |
Editions de l’Atlantique |
|
Le bleu des veines |
2012 |
Citael Road Editions |
|
Le bleu où je suis |
2013 |
Editions de la matière noire |
|
Poème du visage derrière la fenêtre |
2014 |
Editions de La Crypte |
On peut aussi lire Louis Raoul chez Recours au Poème éditeurs :
Echantillons de parole nov 2014 Recours au poème Editeurs
- Deux heures avec Edgar Hilsenrath - 3 mars 2019
- Fil de lecture MJ Desvignes : Lyonel Trouillot, Emmanelle Imhauser, Michaël Glück - 30 novembre 2015
- REVUE INTRANQU’ÎLLITÉS, Hors-série 1&2 - 20 octobre 2015
- Fil de lecture de M‑J Desvignes sur : S.Marot, JB Pedini, L Raoul - 29 septembre 2015
- FIL DE LECTURES DE M‑J DESVIGNES : Diab, Fenzy, Salzarulo, Furci, Motard-Avargues - 31 août 2015
- Maël Guesdon, Voire - 24 août 2015
- Raymond-Jean Lenoble, Mémoires de l’oubli - 26 avril 2015
- Attila Jozsef, Le mendiant de la beauté - 17 avril 2015
- Cécile Guivarch, Renée en elle - 29 mars 2015
- Fabrice Farre La figure des choses - 5 janvier 2015
- Claude Chambard, Carnets des morts - 28 décembre 2014
- Fabrice Farre, Le chasseur immobile - 9 novembre 2014
- Angèle Paoli, le sel de la mer, le fracas des mots - 29 juin 2014
- Un grand vent s’est levé de Danny Marc - 6 avril 2014
















