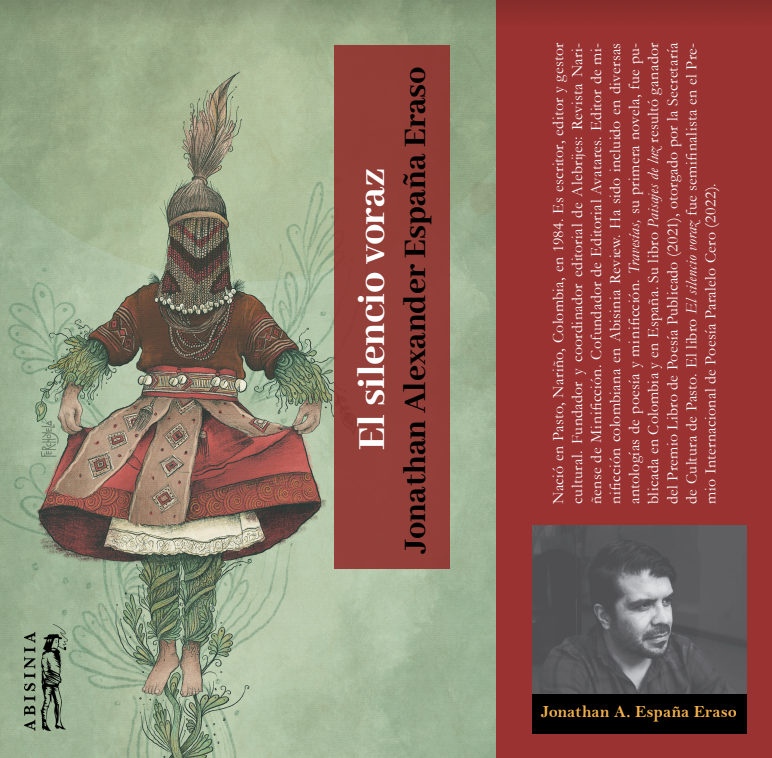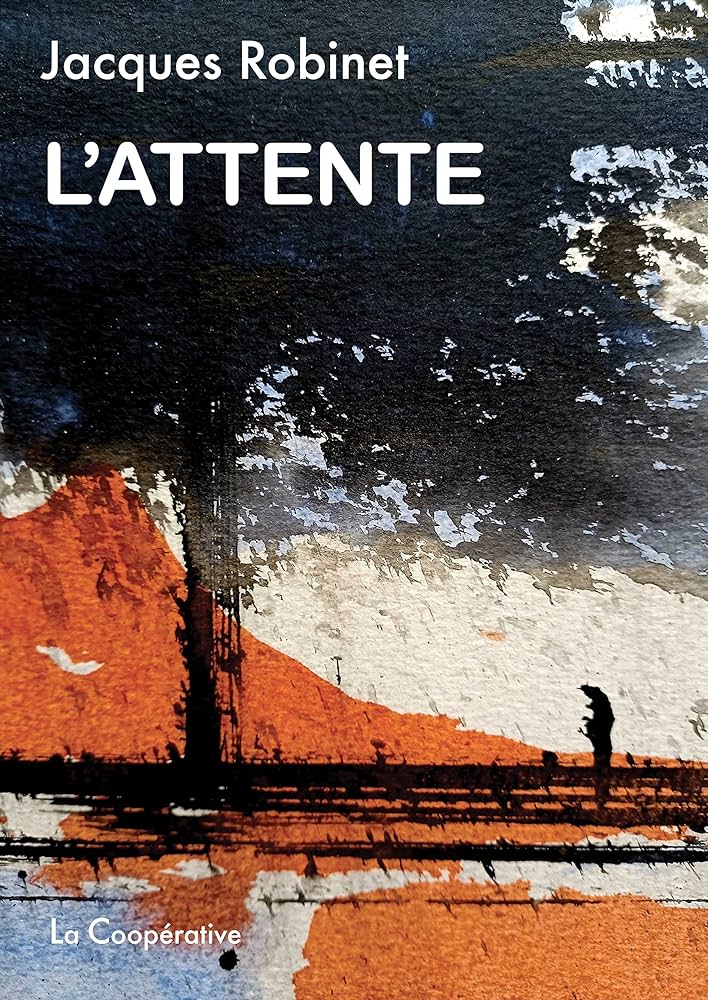Le poète mauricien Hassam Wachill est surtout connu pour son recueil Jour après jour, édité chez Gallimard en 1988 et couronné par le Grand prix de poésie de l’Académie française. Eloge de l’ombre, imprimé à compte d’auteur à Maurice huit ans auparavant, est resté quasiment inconnu du public, que ce soit à Maurice, où Hassam Wachill est né en 1939, ou en France, où il vit depuis 1968.
Ce recueil mérite d’être tiré de son injuste anonymat en raison de sa haute facture et de son univers singulier, caractérisé par une forte préoccupation ontologique associée à une poétique de la salissure et de la ténèbre. Ecrit dans une période dominée à Maurice par la vague des surréalistes tels que René Char, Malcom de Chazal et autre Jean Fanchette, l’Eloge de l’ombre du très discret Hassam Wachill se distingue radicalement, avec une écriture relevant moins de l’imaginaire que de l’« imaginal », au sens soufi du terme – c’est-à-dire d’un mode de perception possédant sa fonction cognitive propre, donnant accès à d’autres régions de l’Etre, à un inter-monde connecté avec le Sacré.
Regroupant une soixantaine de poèmes, le recueil est découpé en cinq temps qui scandent la plongée dans le drame : à un « Cycle de l’ange » succèdent des « Chroniques de l’île submergée », l’« Histoire d’une solitude », des « Débris » et enfin, « Les mots de l’adieu ».
La poésie d’Eloge de l’ombre agit par imprégnation. On s’y enfonce doucement, dans une ambiance de décadence, de perte, de déchirure subreptice. Le recueil s’ouvre sur la réminiscence d’un état précédent, d’un cycle révolu :
sur ton corps des traces de lanières
ou de verges, mais aucun vestige
de nos règnes précédents (p. 13)
Quelque chose reste en suspens dans un temps indéfini, résolument nocturne, marqué contrastant avec ce cycle révolu, et en un lieu indécis dont on sent qu’il est marqué par l’île, une île « submergée » et dont le pourtour se fait « plus compliqué ».
L’ombre dont il est fait l’éloge ici est celle de la nuit qui tombe, de « ce qui nous avait enlacés et avait aggravé le soir », « et puisque la nuit a fondu sur nous avec l’âpreté de la fauconne », « il marche sur nous une nuit de poutres éclatées », typifiant ce qu’Hassam Wachill, dans une note en fin d’ouvrage, qualifie lui-même « d’image […] de destruction, de perdition de l’âme ».
la nuit tombe (encore tu me promènes
dans la charrette infamante de ton cœur) (. 20)
C’est au demeurant une poésie peuplée de très peu d’humains, mais plutôt d’animaux, de gnomes, de fées et de dieux à têtes animales. Elle est traversée par trois figures centrales, celle de l’ange, d’une démente et de la femme aimée, dont on ne sait dans quelle mesure exactement elles sont distinctes ou se confondent en une seule.
C’est d’ailleurs un « Cycle de l’ange » qui ouvre le recueil, lié à un temps auroral qui ne peut empêcher la progression de la ténèbre. Aurore « vide » ou « qui se déchire », ce temps liminaire est déjà porteur de déchirures et de déceptions, de blessures et de salissures à venir.
l’aurore se déchire,
lacère les chardons velus
et les yeux d’oiseau de l’archange (p. 73)
C’est ainsi que je te surprends, ange décevant,
dans l’aurore vide (p. 13)
le plus pur de tous,
ange aux ailes repliées sur le visage
le plus souillé de tous (p. 14)
La suite du recueil est traversé par la figure de la démente, « la jeune folle se lissant patiemment la chevelure / dans une glace de mercure écaillée », dont l’empreinte laissée est tantôt celle de l’énonciation, tantôt celle de l’amour carnassier, avant de se retrouver neutralisée par la mort, une mort qui relève plus l’enlisement que de l’ensevelissement.
Le cri de l’oiseau dit la folle,
est une gifle, une dédicace
qui retentit dans la lumière glauque (p. 33)
Voici mille ans que nous nous aimons, la démente,
celle qui sent le chacal, et moi (p. 56)
Plus près de nous, la demeurée
Du troisième retrouvée dans la vase (p. 60)
Enfin, il y a l’omniprésence de l’amante, avec qui le poète entretient une relation teintée de cruauté, « une hyménée d’ombre et de boue ». Cette dualité se décèle d’emblée dans le nom donnée à la femme aimée, « ma crapaude », mot qui désigne la femelle du crapaud, mais aussi en français de Belgique l’amoureuse, la fiancée.
Certes, je fus le pitre,
Mon cœur fut un paquet de larmes,
Ma crapaude (p. 46)
Mais ne t’affole pas ma crapaude,
Marche tranquillement dans la feuillée
Où s’éploie le linceul
De ce mauvais lys (p. 71)
La relation avec cette femme à laquelle il s’adresse dans « un chant de haine et d’amour », prend la forme d’un jeu que le poète qualifie d’« inique », et marqué par une volonté délibérée de salissure :
et c’est pour t’écraser la bouche
dans un baiser immonde
que je me suis enduit la bouche d’ordures (p. 43)
Chacun est aujourd’hui l’œuvre salie
de l’autre (p. 21)
Dans cette relation passionnelle teintée de cruauté et de vengeance, l’amour qui aurait pu être antidote devient venin et poison, « pendant que j’entasse sur ton corps / Les roses trempées dans le vinaigre et l’alcali » – comment oublier d’ailleurs que le crapaud est un animal venimeux :
Tu seras le drap blanc parsemé d’if,
tu seras la morsure et la thériaque (p. 77)
La main vulnéraire,
la blême méduse des promontoires,
(…) n’est plus qu’un colifichet (p. 73)
Ce relationnel empoisonné et marqué du sceau de l’infamie trouve son paroxysme dans la pulsion de meurtre :
Sous le tulle taché de sang noir,
Je regarde battre la veine dans ton cou (p. 18)
Il y a encore une guirlande,
guirlande des mortes de la mer
agressant ton cou pur,
qu’ici même j’enterre (p. 17)
Cette relation mène à la destruction et à la mort, mais paradoxalement c’est dans la mort et l’anéantissement que la violence peut se résorber et que la séparation peut devenir union, réconciliation :
Nous serons morts ensemble
Sur les mêmes herses étoilées,
dans la même fumée dense (p. 52)
Nous serons séparés.
Nous serons dans la terre de l’échange,
dans l’anneau de la nuit (p. 65)
Un unique anneau nous enchâssait
sous le socle violent de l’autruche égorgée
au cœur du jardin d’ormes (p. 75)
Inversement, c’est dans cet anéantissement, sous le sceau de l’anneau matrimonial consacré dans la mort violente, que réside la possibilité d’estomper la nuit et de faire advenir le jour nouveau :
Les mêmes ronces qui nous ont déchiré les lèvres
nous réunissent par ce matin parcimonieux (p. 72)
De sorte que malgré – ou plutôt, en raison de – cette relation passionnée, la haine de la femme aimée devient la médiatrice, le fil conducteur d’une ontologie douloureuse de l’existence :
la vallée où je creuse et où je dors,
l’aube déchirée que je porte,
ce cercle de songe est ton œuvre (p. 17)
Ce processus ontologique culmine dans la résurrection et la renaissance en tant qu’être humain, par distinction et séparation d’avec le règne animal, au terme d’un processus de salvation :
Car au cadastre des noyés,
je suis la figure ironique de l’animal
qui dénoue le lierre de la tour (p. 71)
Cela se peut que j’aie franchi
la borne au chiffre effacé
ou que j’aie triomphé de la scolopendre,
la pourpre et dure maîtresse des orgies,
cela se peut (p. 27)
et j’œuvre désespérément
à être l’ornithorynque et la belette
dans une glace où seul peut-être
je suis humain (p. 79)
Ce processus ontologique d’Hassam Wachill trouve son aboutissement créatif dans une poétique qui installe ses propres cadres de référence, dépassant toutes références spatio-temporelles pour s’inscrire dans une dimension sublimée à une échelle d’être supérieure :
Nous allons vers le drap millénaire,
l’empreinte ensanglantée de l’oiseau
qui survola les tertres chauves
et les mers gelées.
Et nous allons vers la bouche impénitente (p. 82)
- Ecrire en situation mauricienne (3) : Déjouer l’interculturel stérilisant - 15 octobre 2016
- Ésotérique du guerrier de lumière. - 8 février 2016
- Ecrire en situation mauricienne (2) : Manifeste pour l’émergence d’architectures mentales alternatives - 5 juillet 2015
- Extraits du recueil Eloge de l’Ombre choisis par Catherine Boudet - 22 avril 2014
- L’ELOGE DE L’OMBRE D’HASSAM WACHILL - 22 avril 2014
- La revue Mwa Vèè dédiée à la poésie kanak - 29 janvier 2014
- Le « subréalisme » du cubain Víctor Rodríguez Núñez - 4 octobre 2013
- Les Unités Fugaces, de Juan Carlos de Sancho - 15 septembre 2013
- Ecrire en situation mauricienne : l’obscurcissement de la perspective ontologique - 17 mai 2013
- Anthologie de poésie canarienne : ontologie visible pour archipel inventé - 17 mai 2013