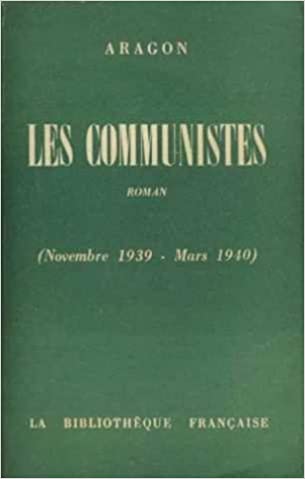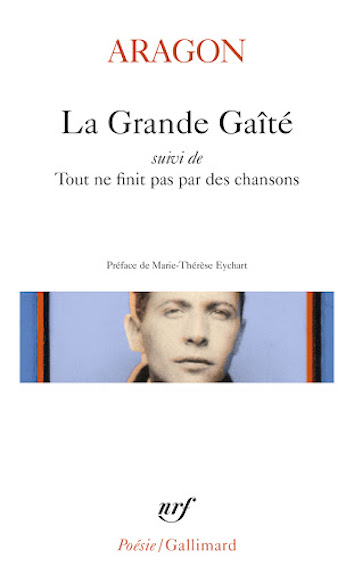Aragon, La Grande Gaieté, suivi de Tout ne finit pas par des chansons
La figure du poète Aragon, si sa place dans la littérature est bien établie, demeure complexe, multiple, parfois contestée, comme son œuvre qu’on pourrait dire variable et parsemée d’écrits inattendus. C’est que le lecteur, confronté à chacun d’eux, s’y trouve dans un moment « de l’histoire d’une vie ».
Car, selon Aragon, tout poème est de circonstance, et sur cette affirmation, au demeurant évidente, l’on a passablement glosé. Or, si la circonstance est le déclencheur, ainsi que la teneur vitale, de l’affaire poétique, de la prise de parole qui devient le dire du poème, deux éléments en modifient la nature : d’une part le texte est écrits, de l’autre le langage pour l’écrire est hors-temps ; je m’explique : malgré des blancs de page en page, des silences, des interruptions apparentes, on peut considérer que « depuis l’humanité » le langage en ses déclinaisons et colorations en langues, continue, et qu’il a toujours continué. Nous naissons au sein d’une langue maternelle reçue. Simplement, un peu comme le monstre du Loch Ness dont les anneaux de loin en loin affleurant à la surface donnent l’impression qu’il est plusieurs, le dire du poète, à cause du vécu révélateur, dû à un tempérament excessif qui force le langage à émerger de loin en loin à la surface de la page, donne un sentiment de diversité et pluralité, bref d’une hétérogénéité circonstancielle. Une fois recueillis en livre cependant, la discontinuité des textes poétiques par la lecture imaginative reforme une unité, rend sa continuité logique, émotive et sentimentale, à un parcours dont les poèmes ne sont en quelque sorte que les bornes.

Louis Aragon, La Grande Gaieté, suivi
deTout ne finit pas par des chansons,
Editions Gallimard, collection NRF Poésie.
C’est le cas de ce recueil d’Aragon dont le titre, d’une ironie déchirante, annonce la suite des poèmes qui sont la conséquence d’amours finissantes : il s’agit de la liaison passionnée, (exacerbée par l’intensité d’un premier amour, disons, « sérieux ») avec Nancy Cunard – héritière à la fortune incommensurable -, et de la façon dont cette liaison s’est délitée, du fait que l’amoureux surréaliste « avant-gardiste » s’est découvert des ressorts psychologiques d’humain ordinaire, c’est-à-dire jaloux de la manière de vivre, des relations d’une femme sans entraves, avec laquelle de toutes façon l’arrière-plan était la pratique (pour Aragon relativement théorique après les idylles fugaces de l’effervescence surréaliste) d’une libre sexualité. Cette évolution vers une jalousie lancinante et destructrice n’est pas en soi tellement neuve, certes. En revanche, le témoignage poétique des réactions d’Aragon à cette liaison qui peu à peu le mine et l’attire vers l’autodestruction, prend le tour d’un langage où la maîtrise fait jeu égal avec sa vérité. Le faux-semblant ici est violemment banni. La réalité matérielle des choses s’y montre sans cesser d’être poème, — « furie / qui dépasse le but et ne l’atteint pas » dit le poète, en un exact et remarquable paradoxe. Dans ses paroxysmes, tout est laminé, néantisé : le recueil est puissamment évocateur d’une expérience que la langue poétique d’Aragon lui a permis de chevaucher, jusqu’à peut-être constituer l’inconsciente soupape de sécurité qui l’aura finalement empêché de réussir « à quitter cette vie », en dépassant fortement la dose de toxique qui eût été mortelle (comme il l’indique dans le commentaire postérieur intitulé Tout ne finit pas par des chansons » )… Le bilan en est que l’on ressort de cette suite de poèmes, à l’humour grinçant et sous-tendus par une vitalité débordante, avec le superbe « Poème à crier dans les ruines », suivi du long et conclusif « Rien ne va plus », cependant que pour la poésie, on peut dire que « tout va toujours ». Le paradoxe est une fois encore que cette audace, à la fois verbalement crue et pourtant digne, cet emportement rageur dans la ruine et la dépression laisse le lecteur – moi-même en tout cas — sur une expérience qui ragaillardit : l’expérience revigorante d’une quasi-noyade sous-tendue par l’implicite perspective (pour nous lecteurs) qu’un coup de talon salvateur contre le fond ramène à la surface. Ce qui se réalisera avec le retour à l’oxygène que sera pour Louis la rencontre, quelques temps plus tard, de la fameuse Elsa, inspiratrice des célèbres poèmes d’amour que l’on sait. En somme après le temps de Nane-Lilith, fièvre et vaccin, viendra l’Ève-Elsa baume d’une vie — qui ne tournera pas pour autant à la relation d’amour sereine et sans nuages, l’un comme l’autre étant restés malgré tout partisans d’une sexualité ambiguë. (Mais ceci, comme on dit, sera une autre histoire.)
Michel Dunand, Au fil du labyrinthe ensoleillé
Avec ce mince recueil au très beau titre, on fait la rencontre d’un poète discret, pétri de songeries profondes, laconique et soucieux de l’essentiel. Une heureuse influence de la pensée du Zen, que l’on sent authentique et non effet de mode plus ou moins frelaté, imprègne le fil de ces pages, qui est manifestement d’Ariane, mais dans un labyrinthe de vie à ciel ouvert, « ouvert à tout, à tous ».
Dans ces courts textes poétique — parmi lesquels je souligne que tel ou tel d’entre eux fait apparaître Ramuz, romancier poétique de la terre valaisanne au style puissant, ou Joe Bousquet, l’un des plus grands poètes (peu connus) du XXème siècle – se laisse découvrir une richesse et une diversité qui veulent être ramifications vers un vivre en joie, non en une joie exubérante et irréfléchie, mais en une sorte de fin « état de joie » pareil à celui du moine oriental quand il travaille son jardin. C’est le côté terraqué de ces notations poétiques, entremêlant géographie, culture aussi bien orientale qu’occidentale, dans une sorte de sagesse du discours qui prend dans son champ la corrélation avec la peinture (Zao Wou Ki, Gauguin, notamment), les paysages de Chine, divers auteurs, diverses époques… Ce sont des traits fugaces, des allusions d’un mot, d’initié parfois (mais aujourd’hui l’Internet renseigne sur tout ! ), toujours chargés d’un arrière-plan éthique, mais qui ne cherche pas à s’imposer.

Michel Dunand, Au fil du labyrinthe ensoleillé,
Jacques André Editeur, collection Poesie XXI.
Michel Dunand y cueille l’instant sans arrière-pensée mais dirais-je, avec une « arrière-réflexion » qui lui fait trier, conserver les seuls et rares mots suffisants pour ancrer l’instant tout en lançant des lignes vers des « ailleurs », tableaux, paysages, poèmes anciens, noms fameux qui sont un monde à eux seuls, lignes qui pour chacun hameçonneront la part de rêve « ensoleillé » qui lui correspond, approfondiront chez le lecteur réceptif sa conscience de l’Instant éternel, si l’on me pardonne cette expression un peu grandiloquente… J’ajouterai que l’ensemble du livre est dédié à la mémoire de Jean-Vincent Verdonnet, poète considérable du lien avec les choses et la nature, décédé en 2013, qui habite les courts textes d’une présence intensément amicale. Le recueil de Michel Dunand me touche aussi par cette fidélité à un proche ; et si le volume en soi paraît mince et léger, il est d’une densité de joie et de « sentiment de la vie » qui est une belle, et réconfortante, leçon ? — non, pas leçon : disons plutôt humble et juste plaidoyer pour la face ensoleillée, secrètement émerveillée, de l’existence, laquelle en notre temps est souvent en proie à l’ombre de gros nuages orageux…
- La poésie à vivre – Édition de jean-Pierre Siméon - 21 juin 2023
- Jean-Pierre Siméon, La flaque qui brille au retrait de la mer, suivi de Matière à réflexion - 21 mai 2023
- Paul Mathieu, D’abord un peu de jour - 5 février 2023
- Olivier Barbarant, Séculaires, Poèmes - 21 octobre 2022
- Zéno Bianu, L’Éloge du Bleu - 6 novembre 2020
- Paul Valet, La parole qui me porte et autres - 19 septembre 2020
- Luis De GÓNGORA, Fable de Polyphème et Galatée - 6 juillet 2019
- Marilyne BERTONCINI, Mémoire vive des replis, Sable - 4 juin 2019
- Aragon, La Grande Gaieté, suivi de Tout ne finit pas par des chansons, Michel Dunand, Au fil du labyrinthe ensoleillé - 4 juin 2019
- Joël Bastard, Entre deux livres, François Cheng, Enfin le royaume, quatrains, Jacques Ancet, Image et récit de l’arbre et des saisons - 3 mars 2019
- Adonis : Lexique amoureux - 5 décembre 2018
- Joël Bastard, Des lézards, des liqueurs - 3 décembre 2018
- “Alcools”, et les “Lettres à Guillaume” - 5 novembre 2018
- Éric CHASSEFIÈRE, Échos du vent à ma fenêtre - 5 novembre 2018
- Claude Raucy, Sans équipage - 4 septembre 2018
- Vénus Khoury-Gata – Gens de l’eau - 3 juin 2018
- Gwen Garnier-Duguy – Alphabétique d’aujourd’hui - 3 juin 2018
- Les cahiers de PAUL VALÉRY - 6 avril 2018
- Jean-Pierre Siméon, Lettre à la femme aimée au sujet de la mort et autres poèmes - 26 janvier 2018
- NIMROD, J’aurais un royaume en bois flotté - 19 octobre 2017
- Fil de lecture autour de Patrick CARRÉ et Zéno BIANU, Patricia CASTEX-MENIER - 2 septembre 2017
- Arthur RIMBAUD Paul VERLAINE, Un concert d’enfers - 20 mai 2017
- Jacques Ancet, Les livres et la vie - 4 octobre 2015
- Pour Joë Bousquet (suite 1 ) - 1 février 2015
- Odysseas Elytis - 19 novembre 2013
- J. Ancet, Ode au recommencement - 2 juin 2013