dans l’écorchure où tout repose
bouillonne l’œil qui expire
Jean-Claude Leroy
Ce volume forme le dixième ensemble poétique publié par Jean-Claude Leroy depuis 2001, et le tout premier chez Rougerie, ce qui n’est pas anodin, après les volumes parus chez Wigwam, Gros Textes, Cénomane et au Pré Carré.
Ce qui n’est pas anodin ?
Ceci, par exemple (P. 36 et 37) :
choisir le piège à étouffement
loi surprise fermée en soi
tenir sa liberté, sa capsule
sa négation, son retournement
se détenir périssable à coup sûr
avec l’unique projet parfois d’en finir
sous les coups d‘une furie haineuse
être ce rien qui leste le temps
corps noyé sec sur l’étal de l’ennui
prêt à jouir d’une lame, devenir fragment
Fragment, devenir fragment, quel plus noble et réaliste projet ? Tellement éloigné des préoccupations massives contemporaines. Il n’y a pas de fausse humilité ici, contrairement au fait de s’affirmer « fragment », « rien » ou « particule » vaguement élémentaire comme l’on entend parfois, non, « devenir fragment », ou s’accepter devenir ce que l’on est tout en travaillant ce devenir. Ce n’est pas anodin, je le disais.
Il y a dans la poésie de Leroy un ton et un regard sur le monde et l’homme difficiles à définir, ce qui est heureux en terres de poésie. Comme une espèce de recul mélancolique, peut-être une forme discrète de désespérance :
malgré tout
horreur est sauve
baiser au lépreux
achat du silence
gerçure des lèvres
ou vieillissement des coïts
usant nuit pour nuit
la même entrave
Et cependant souvent mâtinée d’espoir :
entre les rayons, les étages
sortir à perte, par le col
ne plus culminer, reconnaître
dans la clarté de ce qui reste
paraît vivante la poussière qui échoit
Un entre deux qui apparaît vision finalement lucide sur la complexité d’être au monde et d’être du monde :
combat vrai
entre fond et surface
ne dis rien
garde le sens
entre fond et surface
une lutte à mort :
présent-futur contre présent-passé
le pouvoir vrai
dans le cœur grave
quand tu n’as rien
quand ton projet
sans être dit
se déclare
Oui, c’est exactement cela : il faudrait devenir « fragment ».
Le poète Jean-Claude Leroy est à lire et découvrir.
Jean-Claude Leroy, Aléa Second, suivi de Nuit Elastique, Rougerie, 2013, 60 pages, 12 euros.
………………………………..

Des extraits de À des années-lumière ont paru dans le numéro 8 de la très belle revue Fario, en un texte qui avait frappé la rédaction de Recours au Poème. La parution de l’ensemble, sous forme de livre, est la bienvenue. Ce petit livre, par le format et le nombre de pages, est à mettre au nombre des livres qu’il faut, de notre point de vue, avoir lu cette année. Ce sont des notes rédigées d’abord pour une conférence donnée en 1998 en réponse à cette question : « Un écrivain a‑t-il encore quelque chose à dire ? ». Dans ce texte, Cohen touche du doigt l’immensité du décalage (« à des années-lumière »…) entre nous et les hommes d’hier, nos grands pères, si proches de nous et pourtant si éloignés, ceux qui ont vécu la naissance de la modernité puis son utilisation pour le pire de l’homme – l’extermination. Il y a dans ces notes devenues texte d’importance quelque chose d’une désespérance devant la sorte de déshumanisation dans laquelle nous semblons être plongés :
« Nous savons que la réalité profonde du 20e siècle est d’avoir inventé l’abattage de masse, et que celui-ci s’industrialise jusqu’à atteindre une perfection absolue avec la Shoah. Notons que, pour les Allemands aussi, pendant la Seconde Guerre Mondiale, les problèmes d’intendance ont une importance extrême, l’extermination des Juifs ne devant pas coûter un seul pfennig au Reich. C’est avec l’argent des victimes elles-mêmes qu’on les transporte jusque dans les camps d’extermination. Le tarif dans les wagons à bestiaux est celui du tarif voyageur, soit 4 pfennigs du kilomètre. Les enfants de moins de 10 ans paient demi-tarif. Ceux de moins de quatre ans voyagent gratuitement. Les tarifs sont revus à la hausse tous les six mois et il y a des prix spéciaux à 2 pfennigs pour les groupes de plus de 400 personnes.
L’historien américain Raul Hilberg a montré par exemple que, si l’extermination des Juifs grecs a tardé à se mettre en œuvre, c’est parce que les chemins de fer allemands, qui louaient leurs wagons à la Wehrmacht, voulaient être payés en marks, non en drachmes. Or les Juifs grecs ne possédaient que des drachmes. Et les drachmes n’étaient pas convertibles en marks ».
Cette situation de l’homme, voilà la raison d’être de ces notes, du moins l’interrogation de Marcel Cohen devant le possible d’un tel état de l’homme. C’est aussi la raison d’être de la revue Fario, dont on ne peut que continuer à conseiller la lecture. Car : « c’est l’humanité de l’homme qui a perdu l’essentiel de sa crédibilité ». Et d’une certaine manière, il y a dans les notes de Marcel Cohen amplement de quoi saisir la dépoétisation apparente du monde contemporain. Et à cet état apparent du monde la littérature n’échappe pas :
« Encore nos bibliothèques comportent-elles de grands trous invisibles. Sur les murs du Panthéon à Paris, on trouve les noms de 560 écrivains français tués entre 1914 et 1918. Sous cette liste, une seconde mentionne 197 auteurs tués pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas croire que ces écrivains auraient laissé la littérature française dans l’état où nous l’avons trouvée. À la lueur des textes qu’ils auraient écrits, nos propres livres feraient sans doute pâle figure. En ce sens, nous sommes tous des survivants et cette condition ne va pas sans une part d’arriération. Si l’on ajoute les pertes subies par les littératures allemande, américaine, russe, anglaise, japonaise, italienne, nos bibliothèques sont remplies de « fantômes », que nous en ayons ou non conscience : « fantôme » est le mot désignant la fiche placée dans les rayonnages en lieu et place d’un livre prêté ».
Marcel Cohen insiste sur le fait que les hommes / bourreaux que furent les gardiens des camps nazis affirmaient – et croyaient sincèrement – faire simplement leur travail, leur boulot quoi. Comment ne pas être impressionné par une telle indifférence ? La même finalement que celle dont nous faisons preuve aujourd’hui devant les crimes du capitalisme contemporain, quoi que nous disions pour essayer de nous auto-protéger. Nous aussi, d’une certaine manière, nous faisons simplement notre « boulot ». C’est à ces réflexions que peut conduire, que me conduit en tout cas, une partie du texte de Cohen, l’auteur traçant une sorte de comparaison fort juste entre les totalitarismes d’hier et celui de maintenant, le capitalisme. Non que le capitalisme et le nazisme soient choses identiques, ne faisons pas dire à l’auteur ce qu’il n’écrit pas, simplement que dans les deux systèmes on trouve la même indifférence de certains hommes devant la souffrance infligée à d’autres hommes. Incomparable ? A voir… Qui se demande quelles souffrances il y a fallu pour que chacun ici puisse utiliser un téléphone mobile, dont les composants sont extraits dans des conditions inhumaines par des enfants à la durée de vie limitée. La qualité matérielle de nos vies a un prix, et ce prix est la souffrance d’autres hommes. En sommes-nous conscients ? Oui, bien sûr. Changeons-nous collectivement nos modes de vie ? Non, bien entendu. Une fois dépassés quelques « actes » donnant bonne conscience, nous profitons dans l’indifférence de la souffrance quotidienne d’autres hommes, lesquels se comptent par millions à l’échelle de cette planète. Voilà où nous en sommes, nous qui, parfois, voulons donner des leçons de morale ou d’éthique aux humains d’hier. Tristes sires. Nous en sommes donc là, errants au milieu des ruines d’un humain développant un totalitarisme, le capitalisme, du reste « de gauche », contrairement aux idées reçues, si l’on s’en tient à l’histoire des idées politiques. Bien sûr, il y a quelque provocation à écrire que notre monde a peu à envier à celui de 1939/45, et l’on dira… « Balivernes ». Et pourtant ? A bien regarder ce monde… Que de souffrances et d’indifférence, malgré l’absence apparente d’uniformes noirs à tête de mort :
« Ainsi, seul existe vraiment ce à quoi nous parvenons à donner une forme. Et nous n’existons nous-mêmes que par la forme que nous parvenons à donner à notre existence. C’est pourquoi, dire que l’on n’a rien à dire, c’est encore dire quelque chose. Et ce n’est pas nécessairement un message vain. »
Un livre fort, et fort nécessaire.
Marcel Cohen, À des années-lumière, Fario, 2013, 70 pages, 12,5 euros.
………………………………..
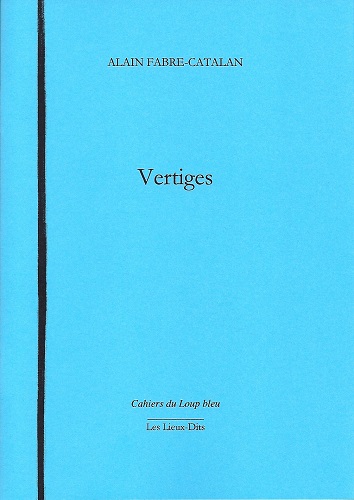
Né en 1947, enseignant, Alain Fabre-Catalan a publié divers textes de poésie et de prose, parfois en micro édition, en revues, sous forme de livres d’artistes. On le lira prochainement aussi dans les pages de Recours au Poème. Il est par ailleurs très actif au sein de la Revue Alsacienne de Littérature, revue dont la qualité n’est plus à démontrer. Ses Vertiges paraissent dans une « petite » collection que nous aimons retrouver, collection où l’on peut lire par exemple des poètes comme Jacques Goorma, Anne-Marie Soulier, Patrick Dubost, Gérard Pfister ou encore Claudine Bohi. Une belle collection en somme. Vertiges ? Des textes placés sous la gouverne de Mandelstam et de Char, ce n’est pas rien :
Dans le jour déjà retourné,
le ciel creuse la route
et sa rumeur de basse terre.
A l’écart,
dans la profondeur du champ,
les bruits un à un s’estompent,
emportés par la longue palpitation du paysage
et son écho qui roule.
(…)
Ce sont les mots qui ouvrent le recueil.
Et plus loin :
l’écluse du silence
déborde, tenue au plus près du vent
Comment ne serions-nous pas sensibles à de telles fulgurances ? On comprend mieux la référence faite d’emblée à Char, en ses mots sur la « nouveauté » que représente toute poésie authentique, en cela qu’elle échappe immédiatement à celui qui, la vivant, en trace les mots. Cet ensemble est d’une très grande beauté :
« Tenir dans la lumière, trembler avec le vent entre les branches jusqu’à l’effacement des feuilles, la fuite du regard dans l’étendue désertée à la poursuite des signes du poème. »
Ou encore :
Incertain,
au-devant des mots qui se taisent,
je m’attarde au bord du noir,
à l’envers des choses où tout s’efface.
Une poésie à lire, et surtout à découvrir.
Alain Fabre-Catalan, Vertiges, Les Lieux-Dits éditions, collection Cahiers du Loup bleu, 2013, non paginé, prix non indiqué.

………………………………..

Avec Roses imbrûlées, le poète belge Gaspard Hons poursuit sa quête en intériorité, celle de cette rose que l’on peut chercher, approcher, jamais entièrement découvrir au plus profond de soi. La poésie tient peut être de la littérature en apparence mais si l’on en soulève concrètement le voile c’est bien de mystique dont il s’agit. La rose… Cette part immobile de nous, centre autour duquel tout semble en mouvement et pourtant ? Quel est le mouvement véritable ? Ce qui s’agite dira-t-on parfois ? On se permettra d’en douter. Rien de plus dynamique au fond que le moteur immobile. D’une certaine manière, la symbolique de la rose dit cela. C’est pourquoi même brûlées pour donner naissance à une vie renaissante les roses intérieures demeurent « imbrûlées ». D’ailleurs, Hons place sa poésie sous cette égide là, celle d’une forme de spiritualité, de sacré ou de mystique, mais pas au sens de « religion », surtout pas, rien de dogmatique ici, au contraire, quand le poète affirme « Je cherche la rose du temps », ainsi que Breton autrefois cherchait l’or du temps. On comprendra sans peine alors pourquoi le poète place des mots de Raymond Abellio en exergue de ce beau recueil de poèmes.
Et, à l’entrée du recueil :
Demander ce qu’est une rose
est demander ce qu’est la présence
Et plus loin :
le centre du silence
est pareil au centre de la joie
où des roses absentes
prennent appui sur des pensées
tombées
de quelques paroles tues
Nous connaissons la force de la poésie de Gaspard Hons, sa profondeur, et c’est une joie que d’avoir de nouveau la chance de pouvoir plonger dans ses mots, qui plus est en un volume édité de très belle façon, reproduisant de bout en bout les lignes manuscrites du poète.
On saisira, avec la présence des mots « vacuité », « absence », entre autres, le vécu intérieur des philosophies dites orientales, une manière pour le poète de s’approprier un réel du monde éloigné de l’image qui se veut ici monde, et l’on comprendra mieux alors pourquoi le poète s’affirme tranquillement jardinier. Le jardin d’orient, ce n’est pas rien.
Gaspard Hons, Roses imbrûlées, éditions Estuaires, collection hors-série n°2, 2013, prix non indiqué.
………………………………..

Né en 1986, Paul Laborde publie ici son premier recueil de poèmes, chez Cheyne et avec une préface de Jean-Pierre Lemaire. On ne sera donc pas étonné, sur ces saines bases, de découvrir une voix en train de naître, une voix dont on se dit que l’on pourrait ou pourra attendre beaucoup. Ces lignes sont pleines de promesse et en même temps, par moments fréquents, pleines d’une certaine maturité poétique. Et l’enthousiasme de Lemaire en sa préface est justifié : « Ce livre nous jette dès la première page dans une « tempête de sable ». Nous entraîne-t-il donc au désert ? Oui, si l’on veut, mais pour une aventure sans lieu ni temps, sans départ et sans arrivée ; une aventure qui se passe « dans le sable de [la] voix » car elle est une approche de la parole elle-même, qui enveloppe, assaille et égare comme un tourbillon de sable où les traces à peine imprimées semblent s’effacer ». Et de fait, d’emblée, le poème se situe dans la tempête, et celui qui parle ici, la bouche emplie de « sel », a la voix pleine de sable. Ce sel menacé, une vie contemporaine elle-même menacée, cela est certain. C’est dire l’importance aujourd’hui du Poème. Et l’on a plaisir à lire cette prise de conscience sous une jeune plume de ce talent en construction. Laborde nous parle du réel quand il écrit sur l’état contemporain de la Parole, perdue dans un désert de sable. Ce n’est que l’oubli, cet oubli de la Parole dont nous tirons semble-t-il quelque fierté. Pour peu de temps encore, cela ne fait aucun doute. Ainsi la poésie de Paul Laborde offre-t-elle des profondeurs de toute beauté :
Il a parlé dans ce nom.
dans ce nom – il a découvert une parole.
il a découvert le nom.
C’est d’une plongée dans les profondeurs de l’être poétique dont il s’agit ici, si bien que l’apparition de la figure de l’ange et de lettres hébraïques vient comme naturellement s’inscrire dans les pages du recueil approchant de son terme. Les lettres, du côté de Jérusalem, ne sont pas que des lettres, elles sont, à l’instar des nombres, des qualités, des symboles aussi faisant résonner des réalités masquées. Paul Laborde vient de loin, cela ne fait guère de doute. Et le chemin qui s’ouvre en son appel poétique ne peut que rendre attentif son lecteur à la poésie qui approche, celle qu’il écrit certainement déjà.
Le livre se ferme sur ces mots :
dans la langue que l’on tisse l’espace n’a plus cours
Un poète à lire, aucun doute à ce propos.
.Paul Laborde, Sables, préface de Jean-Pierre Lemaire, Cheyne, 2013, 58 pages, 16 euros.
………………………………..

Tout amoureux contemporain de la poésie, s’il est un tantinet attentif à ce qui se fait au-delà de lui, connaît Michel Baglin, le poète peut-être – souvent –, l’amoureux de la poésie, défenseur des poèmes des autres depuis les créneaux de sa revue Texture :
Ce qui était modestement un blog et se présentait comme tel est devenu, au fil du temps, une véritable revue de poésie en ligne, et l’une des premières tant sur le plan de la chronologie que de la qualité. Cependant Michel Baglin est avant tout un poète qui a publié une vingtaine de livres, dont nombre de recueils de poésie chez divers éditeurs, en anthologie ou en revues, y compris certains des textes de ce nouveau recueil dans Recours au Poème :
Ce dont nous nous honorons.
Ainsi que son éditeur l’écrit, Baglin trace de poème en poème la carte d’une géographie poétique, et donc de vie, personnelle, une géographie ancrée dans le réel de la vie, des paysages, des gares, des ports, des routes, des hommes. Car Baglin est de ces poètes humanistes, réellement humanistes, devenus assez rares dès que l’on gratte un peu la facilité des mots employés par les uns et les autres. On ne sera pas forcément d’accord avec la vision du monde que sa poésie exprime, on pourra même pourquoi pas la trouver naïve, et alors ? Toute vision du monde est légitime et audible. Pour une simple et bonne raison que toute vision du monde pensée par l’homme est vision humaine du monde, et que tout homme est par nature libre de voir le monde selon ce qu’il est lui-même, intérieurement. Légitime, la vision de Baglin, tout comme celle de ceux qui trouveraient naïve cette vision. Peu importe. Ce qui compte, c’est le poids de la poésie. Et la poésie de ce poète engagé en humanisme vaut son pesant de vers. Dans son Chant des migrants par exemple, ensemble de dix poèmes inspirés par un travail mené en compagnie de personnes en apprentissage/réapprentissage de la langue. Avec Baglin, la poésie n’est pas détachée du réel du monde et donc de la souffrance / vie / joie concrète des humains, ses contemporains. Il est là, maintenant, le poète Baglin. Il n’est pas seulement ce poète-là pourtant. Michel Baglin est aussi le poète des mots et des sons mis en musique, en harmonie poétique. Ce Chant des migrants, comme l’ensemble des textes de ce recueil, chante aussi parce que Baglin trace son propre chant intérieur à la surface de la page, celle des beaux objets livres édités par un autre poète, Bruno Doucey. Cet ensemble de choses en apparence diverses, unies en réalité, se condense dans le poème hommage que le poète a écrit pour son ami disparu Bernard Mazo. Un texte qui ne peut que toucher au plus profond tous ceux, poètes ou non, qui ont partagé l’amitié de Mazo. C’est que, et tout lecteur ne peut que sentir cela, Baglin vit le poème qui vit en lui et cela produit une sorte de tendresse que chacune des pages de ce livre respire. On l’imagine alors fort énervé par les mots des prétendus hommes de gauche, si bavards et nombreux en terres de poésie, hommes prétendument de « gauche », dans les mots du moins, et qui à chaque occasion retournent vivre le contraire des mots qu’ils prononcent dans leur « vie publique ». L’humaniste poète Baglin doit regarder ces comportements avec tristesse, lui qui aime l’homme, l’autre homme en lui et devant lui. Sa poésie, sans le dire, dit aussi cela : le ras le bol des faquins. Tout lecteur attentif de son Chant des migrants sentira cela. On l’espère du moins.
Michel Baglin, Un présent qui s’absente, éditions Bruno Doucey, collection « Soleil noir », 2013, 112 pages, 15 euros.
………………………………..

J’ai lu qu’un poète avait changé le monde
Isabelle Lévesque
Poète, Isabelle Lévesque contribue aussi activement à l’existence et à la force de la revue Diérèse
Elle est cependant avant tout poète, et une poète traçant discrètement un véritable et cohérent chemin poétique, elle dont les recueils paraissent ou ont paru chez divers éditeurs de grande qualité : Encres Vives, Rafael de Surtis, Les Vanneaux, pour n’en citer qu’une partie. Un peu de ciel ou de matin est le second recueil qu’elle fait paraître aux éditions des Deux-Siciles, et pour la seconde fois avec une préface ou une postface de Pierre Dhainaut. Ce n’est pas anodin quand Dhainaut apparaît progressivement pour ce qu’il est : un de nos principaux poètes contemporains. Ce qu’il dit de la poésie d’Isabelle Lévesque est à la fois fort et juste :
« Les mots auxquels se dévoue isabelle Lévesque doivent leur intensité à ce qu’ils rendent présent, à ce qui à la fois les rend présents : les « voix traversières » sont furtives comme les sonorités de la flûte, elles accueillent avec d’autant plus de fougue le « chant éternel » qui les aimante et les transcende. Leur silence, une plénitude ».
Ces mots, extraits de la postface, sont reproduits en 4e de couverture et disent concrètement ce qui se trame en ce recueil : une musique. La poésie d’Isabelle Lévesque est une musique de toute beauté. Elle est aussi et en même temps, cela n’est en rien contradictoire, une poésie de la nuit, du et des passages (s), des morts et des renaissances, de cette vie qui est transformation et transmutation permanente. Et c’est exactement sur ce point précis que se tient le réel de l’Amour, auquel Dhainaut fait d’ailleurs référence, un mot à saisir au sens que lui donnait Jean de La Croix, celui de l’Amour/rencontre, avec soi, avec l’autre, de soi avec l’autre, le tout autre, aussi bien cet homme que l’arbre qui se profile dans sa silhouette. Oui, sans doute est-ce cela, cette heure du « retour des nombres » dont parle Isabelle Lévesque, un retour/recours au réel de la vie, laquelle est miracle permanent. Il en faut de l’Amour au creux de la vie, prise en son ensemble, pour vivre et naître/renaître, miracle permanent justement. On ne saurait donc être surpris de voir, en ces pages, la lune sauver un nuage, auprès de la « naissance des feuilles ». Un recueil de toute beauté.
Isabelle Lévesque, Un peu de ciel ou de matin, postface de Pierre Dhainaut, peintures et dessins de Jean-Gilles Badaire, Les Deux-Siciles, collection Poésie, 2013, 74 pages, 16 euros.





























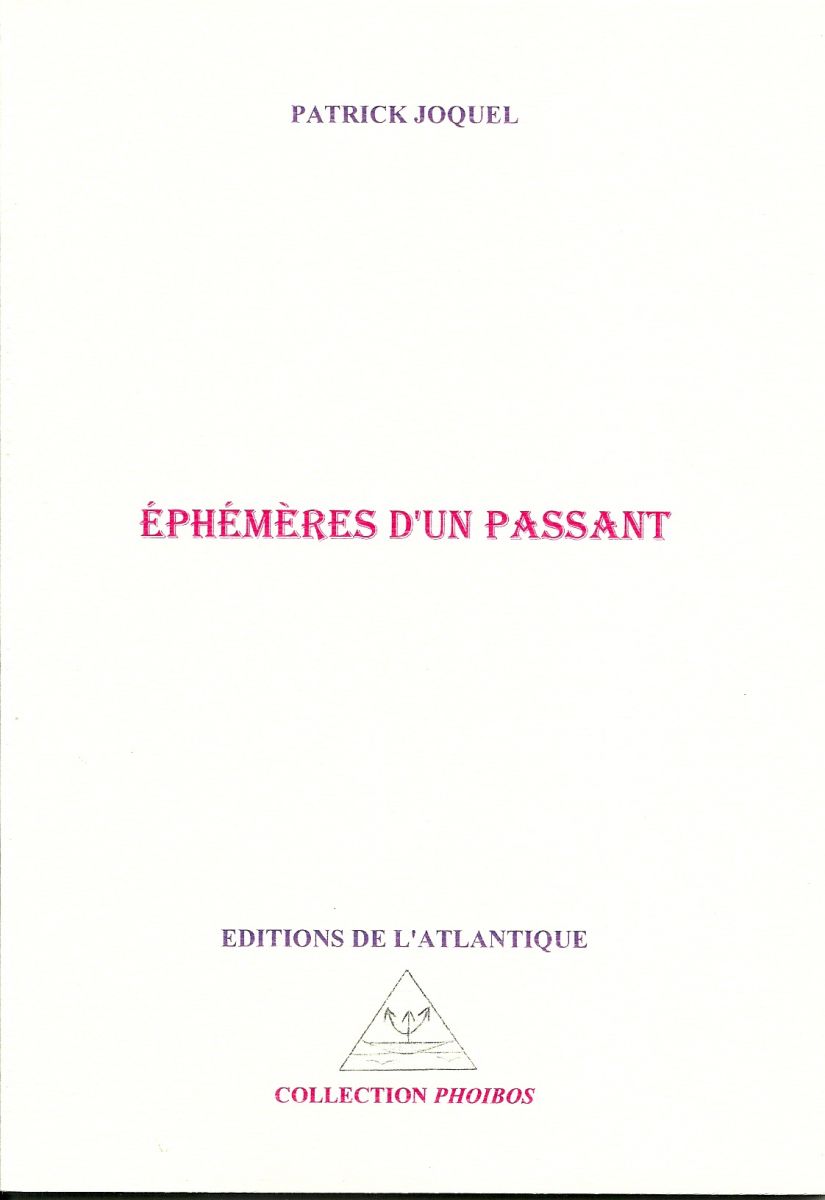

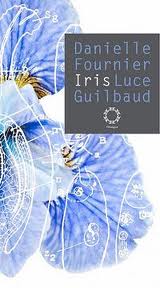


 Sur le plan chronologique de l’écriture, les textes de Un tango pour Amalia (2007) précèdent ceux de Sinon dans la chair (2009). Entre les deux, il y a la souffrance source de la violence sublime qui anime ces poèmes de Deschizeaux. Violence de la perte, celle de l’être proche.
Sur le plan chronologique de l’écriture, les textes de Un tango pour Amalia (2007) précèdent ceux de Sinon dans la chair (2009). Entre les deux, il y a la souffrance source de la violence sublime qui anime ces poèmes de Deschizeaux. Violence de la perte, celle de l’être proche.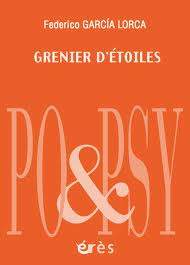 « Grenier d’étoiles », un titre choisi par Danièle Faugeras dans le poème Rêves, ici reproduit de superbe façon au cœur du volume. Les poèmes de cet ensemble proviennent de Canciones (1921–1924) et de Suites (poèmes publiés en revues entre 1920 et 1928). Je n’aurais pas ici l’outrecuidance d’écrire au sujet de Garcia Lorca, poète et poésie qui ont sans doute aucun entraîné le plus de commentaires jamais écrits sur une œuvre. Laissons la parole à Lorca.
« Grenier d’étoiles », un titre choisi par Danièle Faugeras dans le poème Rêves, ici reproduit de superbe façon au cœur du volume. Les poèmes de cet ensemble proviennent de Canciones (1921–1924) et de Suites (poèmes publiés en revues entre 1920 et 1928). Je n’aurais pas ici l’outrecuidance d’écrire au sujet de Garcia Lorca, poète et poésie qui ont sans doute aucun entraîné le plus de commentaires jamais écrits sur une œuvre. Laissons la parole à Lorca.