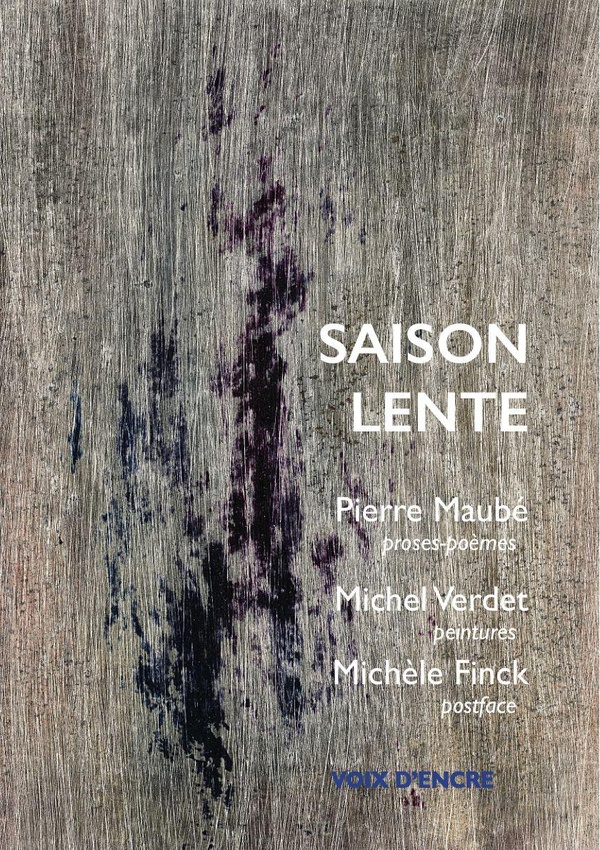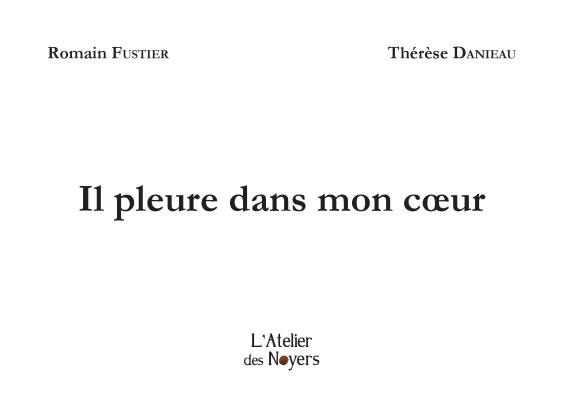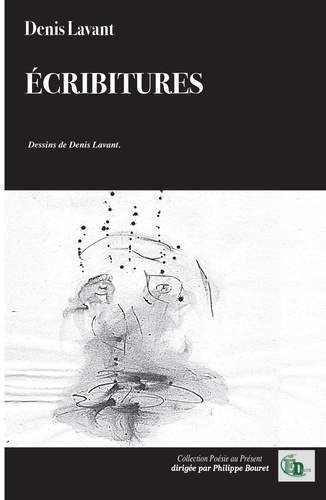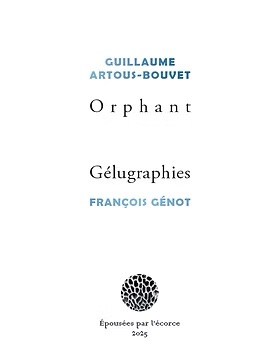(Voir “Recours au Poème” 190, déc. 2018)
Amont dévers
Onzième livraison
Et le réel… sans les mots, qu’est-ce ? – Au risque de choquer, je dirai d’abord, pour laisser quelques portes ouvertes, qu’au delà du trop ressassé « effet de réel » (Riffaterre, Barthes) auquel bien sûr seuls succomberaient les esprits ingénus ou ignares, c’est, à travers un texte, l’émotion qui vous prend lorsque vous croyez reconnaître, dans une ombre entrevue, la figure d’un être aimé – ou que vous eussiez aimé ! – autrefois encore, ou hier à peine, ou naguère. Ou totalement ailleurs.

Vous vous dites oui, c’est exactement cela (ou lui, ou elle), par une espèce de miracle…Et d’adhérer à ce vrai, cette pieuse illusion, ainsi que l’ont montré quelques sociologues de la littérature, est aussi un marqueur culturel “bas”, d’appartenance sociale « subalterne », que l’on nous pardonnera ici de revendiquer, symboliquement en tout cas (encore que… ).
Pensers fallacieux de poètes, sans doute. Séductions du rêve. Histoire mise en mots (GiòFerri). D’où la possibilité, en soi paradoxale, vu l’arbitraire presque absolu du signe linguistique, de diverses formes de réalisme, en particulier celles du réalisme que j’ai essayé de dire habité, c’est-à-dire dépassé, malgré qu’on en ait – ou troué, si l’on veut – par l’arrière-fond énigmatique, le double fond du mystère des lettres, sous-texte et avant-texte y compris, à savoir par les mots de la Littérature même. Et, au plus haut point, de la poésie, dont il est question ici, sans exclusive. Légitime simple illusion, donc. Ce qui fait signe au delà, et veut être de ce fait reconnu alors que rien ne “ressemble” plus. Parce que tout reste à faire (on pense au beau nom, en France, de l’Action poétique), tout est à venir (Fortini) ou “en avant”. La preuve, Rimbaud : sous l’étoile duquel nous plaçons (aussi avec l’italien Campana, qui a été réellement fou) cette traversée nocturne. Dans le miroir, toute réalité est habitée, oui, par une autre elle-même, « et c’est toujours la seule », etc.
∗∗∗∗∗∗
-
« La réalité rugueuse à étreindre… »
De la plèbe
Le peuple est une bête variable et grosse,
qui ignore ses forces ; aussi reste-t-il
sous le poids et les coups de bois et de pierres,
mené par un enfant de faible puissance
qu’il pourrait mettre à terre d’un soubresaut ;
mais il le craint et le sert en ses outrances.
Et ne sait que lui, est craint, car les féroces
ont jeté un sort qui ses sens obnubile.
Chose étonnante ! il se pend et s’emprisonne
de ses propres mains, s’occit, se fait la guerre,
pour un carlin, de tous ceux qu’il donne au roi.
Tout est à lui, entre le ciel et la terre,
mais il n’en sait rien, et si quelque personne
vient l’en aviser, il la tue et fossoie.
Campanella, Opere– dallaCantica(1622)
L’auteur, torturé par le mal de pierre
Et donc dedans mes reins se sont formés
les durs cailloux hostiles à ma vie,
qui chaque jour sont plus fiers ennemis,
car ils ont de mes jours la fin fixée.
Certains de pierres blanches vont marquer
leurs bonheurs, moi j’en marque les ennuis ;
les cailloux servent à bâtir, ceux-ci
pour détruire leur fabrique sont nés.
Ah, je peux bien appeler mon sort dur,
s’il est de pierre ! Va me lapider
depuis la part interne la nature.
Je sais que sur la pierre aiguise l’arme
la mort, et pour former ma sépulture
dans mes viscères s’érigent des marbres.
Ciro di Pers, Poesie[1666–1689]
∗∗∗∗∗∗
Un paysan du territoire de Recanati, ayant amené un de ses bœufs, déjà vendu, au boucher qui l’avait acheté pour qu’il fût tué, au moment de l’opération, demeura d’abord incertain, tiraillé entre l’envie de partir ou de rester, de regarder ou de tourner la tête ; la curiosité finit par l’emporter et, voyant le bœuf s’écrouler, il se mit à pleurer à chaudes larmes. Je l’ai entendu d’un témoin direct.
Leopardi, Zibaldone29 [c. 1819]
Le taurillon
I.
Sur la rive du Serchio, à Salvapiane,
en deçà du Pont où fait halte pour boire
le charretier venu de la Garfagnane,
depuis Castelvecchio conduisent, les soirs
des jours de fête, leur tout petit troupeau
nombre de jeunes filles aux tresses noires.
Elles s’assoient là sur la berge, menton
dans une main, regardant les peupliers
blancs du fleuve ; et elles parlent. Mais le vent
apporte un brouhaha de voix, des échos
de feux d’artifice, un écho bref de pas
et un confus tremblement de cloches doubles.
Il est doux d’écouter alors, mais la tête
attirée ailleurs, ces quelques simples mots…
un peu recouverts par les cloches en fête !
ailleurs… au Serchio qui brille, ou au soleil
qui prend le mont… ô Nelly ; et aux ourlets
de ton tablier, et même aux vaches seules
qui broutent les flouves sous les châtaigniers.
II.
Tiens…ce veau – à son gros œil tu apparais
immense, avec un arbre souple à la main,
quand avec une tige tu le conduis –
il regarde, surpris, le mont neuf, la plaine :
toute une sylve, le mont ; et la descente
semblable à un tendre velours de froment.
Lui qui jamais n’avait connu de printemps
agite sa dure queue raide, et salue
le monde beau. Avant, cela n’était pas :
il s’y retrouve ; il flaire la brise, il flaire
la terre ; dans l’air d’une secousse il jette
les cornes brèves de son front animal
et de ses pattes impatientes retourne
la terre. Le ciel est en entier plein d’or,
Nelly, et le sol est tout empli de menthe.
Il voudrait remplir de sa joie le sonore
espace, le veau, tirant de sa profonde
gorge un mugissement rauque de taureau.
Une génisse lointaine lui répond.
III.
Donc, Nelly, tu ramènes un taurillon ;
mais calme, car il te voit toujours devant
avec à la main le grand arbre flexible.
Te voilà à Castelvecchio, à sa source
nouvelle, pérenne, où s’avancent en file
les vaches lourdes qui reviennent du mont.
Elles, d’un côté, au réservoir de marbre
aspirent l’eau ; quand elles soulèvent leur
cou, l’eau retombe de leurs noires narines.
De l’autre résonne, s’emplissant au jet
vif, la seille : une jeune femme surveille,
tenant son bourrelet sur ses boucles brunes.
À cette source, ô Nelly, vois que se presse
ton taurillon, pour y boire ; et de la pleine
cuvette l’eau s’écoule dans le chéneau,
si bien qu’on croirait voir pulser une veine.
Il regarde avec ses gros yeux, et ne boit :
car au-dedans de l’eau, qui se meut à peine,
il voit un couteau bleu onduler léger…
IV.
Il meugle et s’échappe. Et en meuglant il erre
deux jours, de sylve en sylve, par la colline,
arrachant parfois des fils d’herbe à la terre.
Il souffre et il cherche ses trous d’eau secrets
verts de cheveux-de-Vénus ; il y regarde
et au fond le couteau coupe l’ombre humide.
Il attend au puits, si quelqu’une y remonte
le seau : en déborde presque une eau, tressaute :
au-dedans le couteau tourne, tourne, tourne.
Alors, au torrent : de la côte aérienne
il descend : le couteau est sur le gravier ;
mais le courant le heurte un peu, le soulève
peut-être, et l’emporte. Il attend. Il se couche
sur les lisses joncs, et de ses grands yeux guette,
les fixant vers l’eau à travers la jonchaie,
si jamais cette ombre de la mort au loin
emmènent les flots. Au-dessus de sa tête
le temps par sa route muette s’enfuit.
Il attend : et l’eau passe, et cette ombre reste.
V.
Le troisième jour… « Qu’as-tu à pleurer, sotte ?
Sait rien. C’est des bêtes sans cervelle : écoute,
même nous, on ne sait ce que nous aurons ! »
dit ton père, ô Nelly. Tu cours, du côté
de la Route Neuve, tu regardes, là,
pour le voir passer même une seule fois.
Il passe : un homme devant, un par derrière :
il est entravé, fréquemment il trébuche…
Il passe…Oh ! pentes claires ! gîtes ombreux !
Et toutes ces luzernes ! tout ce sainfoin !
Giovanni Pascoli, Poemetti, 1900
Déjà publié sur : http://poezibao.typepad.com/poezibao/2018/05/carte-blanche-%C3%A0-jean-charles-vegliante-une-traduction-de-giovanni-pascoli.html que nous remercions.
Le vitrage
Le soir d’été fumeux
Du haut du vitrage verse ses éclats dans l’ombre
Et me laisse au cœur un sceau ardent.
Mais qui a (sur le terre-plein sur le fleuve s’allume une lampe) qui a
À la petite Madone du Pont qui est-ce qui est-ce qu’a allumé la lampe? – c’est
Dans la pièce une odeur de pourri : c’est
Dans la pièce une rouge plaie qui s’étiole.
Les étoiles sont boutons de nacre et le soir s’habille de velours
Et enfle le soir tremblant : est tremblant le soir et il enfle mais c’est
Au cœur du soir, c’est :
Toujours une rouge plaie qui s’étiole.
Campana, Canti Orfici, 1914
Souvenir
Souvenir d’une vieille église,
solitaire,
à l’heure où l’air devient ocre
que la voix devient rauque
sous l’arc tendu du ciel.
Tu étais lasse,
on s’est assis sur une marche
comme deux mendiants.
Mais le sang frissonnait
de merveille, à voir
chaque oiseau se muer en étoile
dans le ciel.
Caproni, Come un’allegoria, 1936
Le paradis au-dessus des toits
Ce sera un jour tranquille, de lumière froide
comme le soleil qui naît ou qui meurt, et la vitre
laissera dehors l’air sale du ciel.
On s’éveille un matin, une fois pour toujours,
dans la tiédeur du dernier sommeil : l’ombre
sera comme la tiédeur. Emplira la pièce
par la grande fenêtre un ciel plus grand.
De l’escalier gravi un jour pour toujours
ne viendront plus des voix, ni visages morts.
Il ne sera pas nécessaire de quitter le lit.
Seule l’aube entrera dans la pièce vide.
La fenêtre suffira à habiller toute chose
d’une clarté tranquille, presque lumineuse.
Elle mettra une ombre maigre sur le visage étendu.
Les souvenirs seront des caillots d’ombre
rencoignés comme une ancienne braise
dans l’âtre. Le souvenir sera la flambée
qui hier encore mordait dans les yeux éteints.
Pavese, Lavorare stanca, 1943
∗∗∗∗∗∗
Sa mère a appris à Virginia
l’importance du corps
chaque soir durant de nombreux beaux étés
son père recevait
une fois Virginia éloignée
sa compensation
nous étions heureux si j’y pense
le métier maudit des sous
le petit commerce
un chat au milieu des chiens
faisait son papa
c’est étrange
grand et joyeux
comme il est doux de garder un corps humain
Virginia se souvient
la viande sur la table le vin barbera
la lumière au dessus du pain
puis plus tard
la lumière rationnée pas de viande
Virginia
le père à la maison
s’embaucha comme employée
le père avait désormais quarante-et-un ans
dactylographe bien considérée
et non pour sa robe fendue
Téléphones à la stipel Panettoni
de motta Magasins standa/upìm
que de pluie est tombée sur les toits
qu’elle est dure la voix de Virginia
cela pourrait finir ici mais il y a autre chose
il y a le père comme un chat sur sa chaise
qui attend la dame avec son manger[…]
Giancarlo Majorino, La capitale del nord, 1959
Tellement jeune…
« Tellement jeune et tellement putain » :
t’as ce renom et ce n’est peut-être pas
ta faute – c’est le pull en laine
noir serré qui parle mal pour toi.
Et la bouche rit aigre :
mais comment ça te mord le cœur
il le sait, celui qui t’a vue maigre
refaire tes tresses pour faire l’amour.
Giovanni Giudici, La vita in versi, 1965
À mi-côte
Ce qu’on voit d’ici
– vous m’entendez ? – depuis
le belvédère de non retour
– ombres de campagnes gradins
naturels et quel luxe
d’eaux quels éclairs quels embrasements
de couleurs quelles tables apprêtées –
c’est ce qu’on voit d’ici de vous
et que vous savez d’autant
moins que vous y êtes plus.
Sereni, Stella variabile, 1981
Voix en rêve
C’est ce que dirent les derniers arrivés
le front bas, privés de vue,
d’une auto sans chauffeur descendus
– la honte la plus dure m’a écrasé –
– par la rage j’ai été déchiqueté –
– les flots par pitié m’ont noyé… –
Le feu d’été gonflait l’asphalte
en bosselant les traces vagues
– ainsi nous sommes passés dans l’histoire –
De Signoribus, Nessun luogo è elementare,2010
Siglo de oro
La poussière m’intéresse, si elle tournoie
dans un puits de lumière, attendant
juste ce qu’il faut de gravité
pour rejoindre la terre. Le minuscule
silence avec lequel si nous marchons elle fuit
dans les coins pour s’y faire galaxie ou minons.
Quand nous secouons les vêtements, passons
le doigt sur les meubles pour la surprendre
dans son sommeil et troublons le rêve gris
de se ré-agréger en strate et corps.
Sa nostalgie de toute forme,
l’incompréhension pour l’eau
et cette façon de se poser en marge, sur les côtés
comme un témoin de la noce.
Sa ressemblance avec le sable,
géant qui au moins s’exprime en dunes,
mime des collines et engrène la tempête.
Sa tranquille décadence,
futur saigné à blanc qui campe,
douce armure, ombre que nous sommes,
mère du temps, notre obsolescence.
Paolo Febbraro, in : Kamen’ 51 (juin 2017)
∗∗∗∗∗∗
-
De nouvelles références ?
Pour tenter de vivre
[Giacomo Leopardi, après sa déconvenue avec Fanny T. T. ]
[…]
Vante-toi, tu le peux. Raconte que seule
tu es de ton sexe à qui j’ai dû plier
ma tête fière, à qui j’offris simplement
mon cœur indompté. Raconte que tu vis
la première, et j’espère unique, mes yeux
qui suppliaient, moi si timide devant
toi, plein de crainte (je brûle si j’y pense
et m’indigne, et rougis) : moi privé de moi,
à guetter humblement chaque envie, chaque acte,
chaque mot tiens, à pâlir aux impatiences
superbes, m’illuminer au moindre signe
courtois, changer à chaque regard de mine
et de couleur. L’enchantement est rompu,
et avec lui brisé, à terre gisant,
ce joug ; je m’en félicite. Et, bien que pleines
d’ennui, après le servage enfin, après
une longue errance, j’embrasse content
sagesse et liberté. Car si de passions
est veuve ma vie, et de nobles erreurs,
comme une nuit sans étoile en plein hiver,
me sont suffisants réconfort et revanche
du sort des mortels, dès lors qu’ici sur l’herbe
immobile étendu, oisif, je regarde
la mer, la terre et le ciel, et je souris.
G.L. Aspasie, fin (ChantsXXIX)
(Chœurs de Didon, IV)
Je n’ai dans l’âme qu’arrachements sourds,
Équateurs sylvestres, sur des marais
Brumeux amas de vapeurs où
Délire le désir,
Dans le sommeil, de n’être jamais né.
Ungaretti,Cori descrittivi di stati d’animo di Dido, 1947
Pauvres
Les pauvres ont la froidure de la terre.
Dans la ville qui penche, aux toits, aux fumées
tranquilles des maisons, le jour émigre
dans la couleur d’orient : si calme,
le soir se fait lueur aux yeux dolents.
Je m’en souviens contre un ciel aéré,
les pauvres étonnés, comme l’acerbe
vert des prés effleure dans la pluie
une éternité voilée de soleil.
Gatto,Poesie1929–41, 1961
(Internat)
[…]
Il y aura peut-être, ensuite,
une journée comme tant d’autres, dépensée
en studieuse application, jeux enflammés,
parfaite préfiguration
de la vie future. Non pour toi
qui, inquiet, retournes
ton esprit dans une hantise incessante
en quête de la joie impossible, amour
qui se satisfait de soi
jouissant d’une joie autre
en autre chose…
Plus tard, attends, elle viendra, au bord
du désespoir, ce sera,
une fois largement épuisé le temps
imparti et pourtant
tendu encore sur la terre le coton
du ciel, pour un peu,
pour autant que ta faim soit apaisée et ce sera
le jeu tranquille
d’un camarade sur les rives ensommeillées
d’une eau qui s’en va.
Attilio Bertolucci, La camera da lettoXII, 1984
Encore sur le Golfe
Que, d’immondes armées,
la ferraille en décharge
de rouilles et goudrons
dessèche les vallées.
Qui a tué, or pleure,
mais juste en rêve ; puis
puisse oublier. Ses larmes
ne servent plus à rien.
Où courut le liquide
qui baigne les méninges,
de crânes innombrables
pointe, ah, un maigre épi,
un chaume ! Et cet aride
piquant broute une chèvre.
Que ce seul espoir s’ouvre
aux vivants d’ici-bas
jusqu’à ce que tordus
crient les gonds de la terre
et, chantant, bleus s’embrasent
les mondes dans la guerre
de l’espace et des clairs
astres d’outre le temps
et vacant rie le temple
de l’Être qui là, fut…
Fortini, Light verses e imitazioni, 1994
(une première version sur http://www.nuoviargomenti.net/poesie/un-omaggio-a-fortini/)
[ … ]
déchaînée elle se déroule dans la cavité et se déglingue
et ne trouvant pas le bon appui ne consonne point
jusqu’à s’affaisser sur le plancher
et elle a du mal avec le effe chuintant
tant qu’elle devient en tremblant muette sous la voûte écroulée
mise à l’écart dans sa Thèbes
elle ne retrouve pas sa demeure de coins et parois
la langue tortionnée
l’ennemi est archi-victorieux ?
mais le dernier mot n’est pas dit
et je m’en irai par le monde
avec mon petit caillou en poche
parce que la vitrine ne m’attire pas,
ni la boucherie où pendent boyaux et malecordes
Jolanda Insana,La stortura, 2002
Tu n’auras que la vie
Les chaussures ne furent pas retrouvées.
Mais la lumière tombait coïtalement sur le corps de la jeune femme
cristallisé dans le témoignage.
Entre les yeux et le ventre
des traces de lavoir – un parcours inversé pour établir les alibis.
La porte d’entrée avait été fermée à quadruple tour.
Elle brûlait comme une hostie dans la matière
lacrymale de fin d’après midi – la tête prise dans les arbustes
et l’opiniâtre répétition des trajets. Pour des raisons inconnues
elle n’a pas pu atteindre ses années
quelle que fût leur fonction singulière, mais un immobile
adieu à la beauté du monde
réchauffait la fibre qui résiste,
cri de joie du corps sans douleur.
Maria Grazia Calandrone, Gli scomparsi –Storie da “Chi l’ha visto?”, 2016
- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021
- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020
- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020
- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020
- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019
- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019
- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019
- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019
- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019
- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019
- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018
- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018
- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018
- Amont dévers 8 - 3 juin 2018
- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018
- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017
- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017
- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016
- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016
- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014
- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013
- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013
- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012