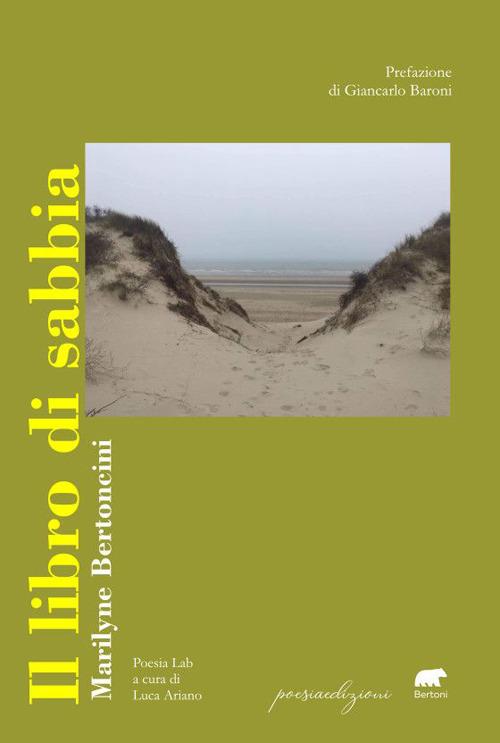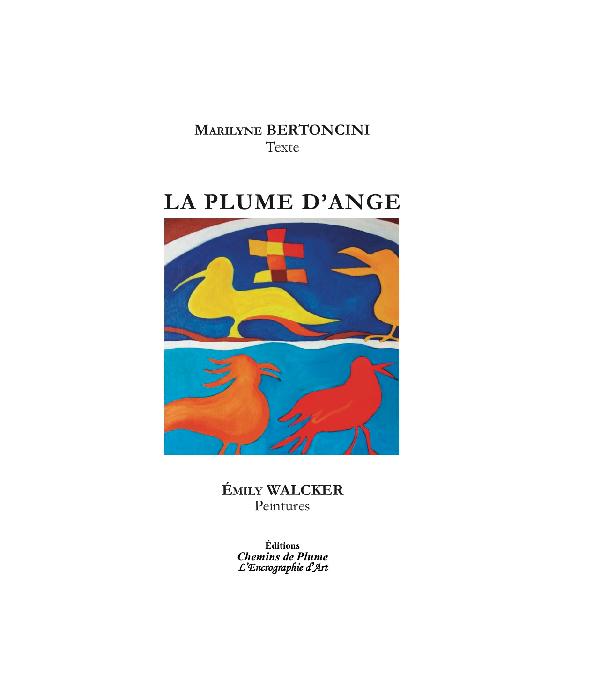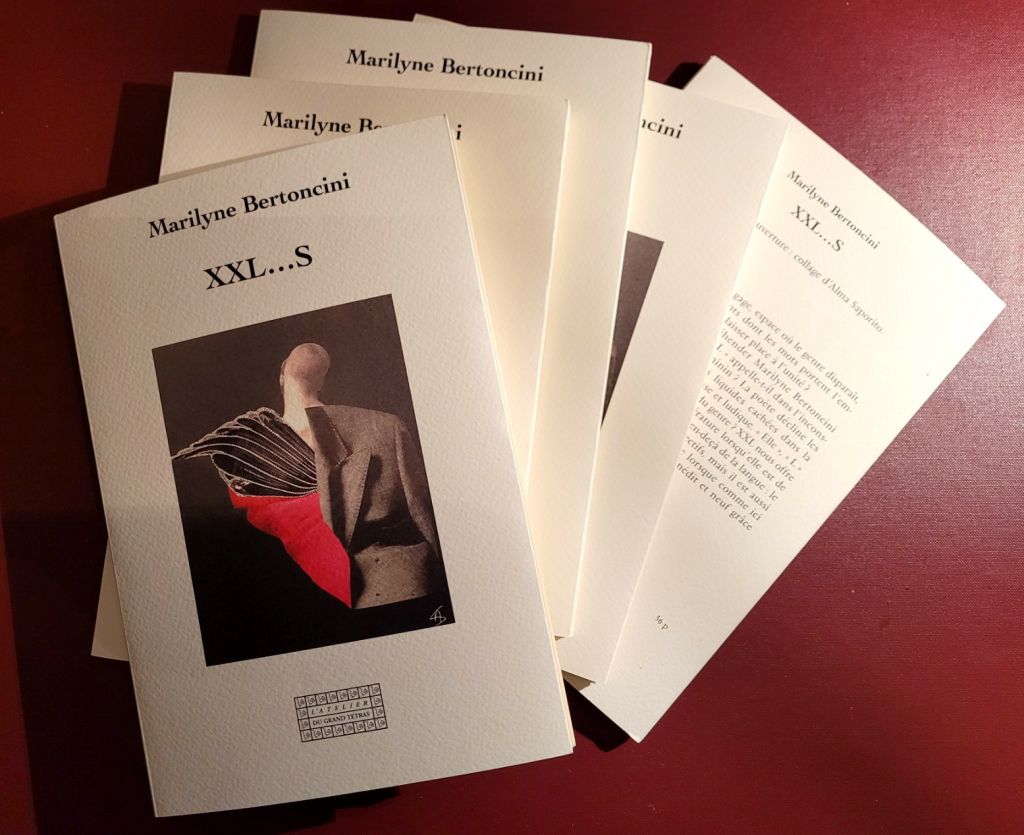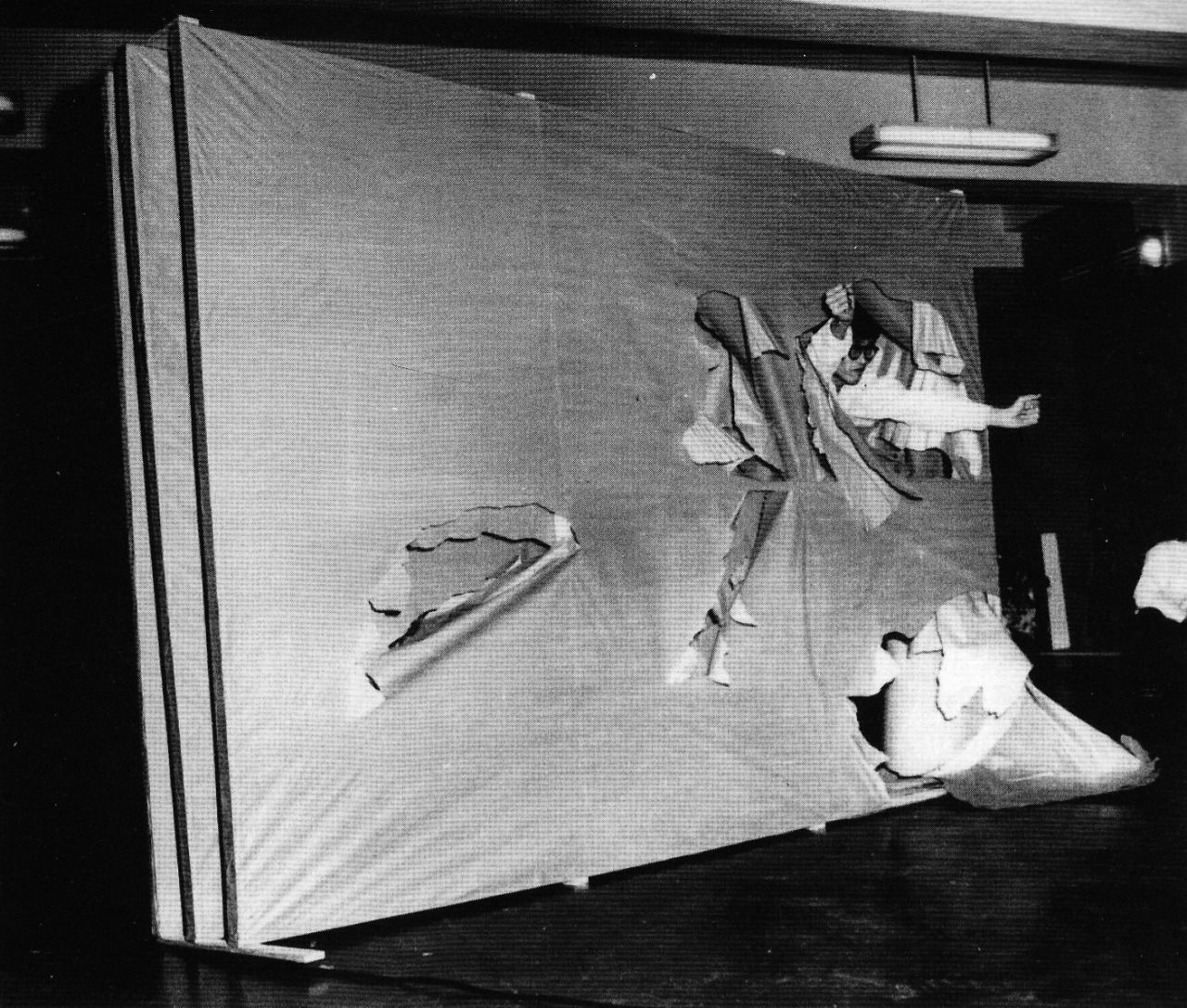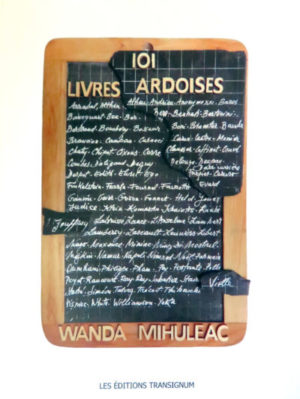Cette suite poétique, à la construction musicale, points et contrepoints, bouleverse et interroge. Inspirée d’une dépêche d’AFP, elle fait osciller le lecteur entre plusieurs réalités, temporalités et espaces. Continuité et rupture, matérialité et immatérialité, réel et mythe, on avance, le cœur en suspens, sur une crête à la fois paisible et brutale.
« Onagawa », le nom de ce petit port de pêche, avec son O, yin et yang, « comme une perle » ouvre tout un univers, celui du Japon, de « ses baies bleues du cobalt océan », de ses cerisiers en bourgeons « dans leur gaine de soie », de ses daims, hirondelles et papillons, de ses parfums printaniers. Une attente vaporeuse, un paysage rêvé d’une sérénité toute bouddhique. Les mots flottent, légers, dans une délicatesse de haïku. Sauf que nous ne sommes pas dans le présent de la sensation mais dans le passé comme le montre l’usage de l’imparfait, temps de la durée, de la promesse renouvelée.
Et soudain c’est « la noyée », « raflée / comme un poisson » par « une muraille de mort » énorme. Nous sommes le « onze mars 2011 ». Le tsunami vient de faire « plus de dix-huit mille » victimes en un instant. Parmi elles, Yuko, une employée de banque, épouse de Yasuo, un chauffeur de bus. Marilyne Bertoncini raconte le cataclysme dans l’ordre des faits, de la submersion apocalyptique à la dévastation, au sentiment de vide abyssal.

Marilyne Bertoncini, La Noyée d’Onagawa, Jacques André éditeur, Collection XXI n°58, préface de Xavier Bordes, 12 euros.
Les faits s’énoncent en chiffres (date, heure, intensité du séisme, nombre de victimes…) mais ces chiffres sont écrits en lettres comme si l’alphabet permettait de mieux apprivoiser la mortelle réalité, de la rapatrier à l’intérieur du langage, de la recréer et donc de la métamorphoser. N’est-ce pas le pouvoir de l’art, de la poésie : recréer la réalité pour la donner à vivre de l’intérieur ?
Le cataclysme se répercute à l’autre bout du monde, selon l’effet papillon : nous voici maintenant à Villefranche, en France, auprès de l’auteur cueillie au réveil par l’annonce. S’ensuit alors un jeu d’analogies et de correspondances entre les deux vies, les deux villes. Interdépendance toujours des éléments, des événements situés sur une même corde, « Life on a string » (cf. l’exergue).
Qu’est devenue Yuko ? Ressac de la vague, on revient au Japon trois ans plus tard, avec Yasuo qui, à 57 ans, entreprend un projet fou à l’issue improbable, mais comment accepter le « sans voix / sans corps » ? Tant de disparus sans autre trace que leur nom.
Dans ce recueil, si espace et temps dialoguent dans une même continuité, c’est pour nous rappeler la force de la nature, sa pérennité violente, chaotique, et, en creux, notre folie à la défier, à l’ignorer quels que soient les avertissements. (Yuko, par ironie, se réfugie sur le toit de sa banque. Nos tas d’or seront-ils jamais assez hauts ? ) Le nom de « Fukushima », apparu tout à coup dans le texte, fait dangereusement résonner le « cobalt » employé précédemment pour décrire l’océan.
La noyée d’Onagawa, à l’image d’Oyuki (fantôme traditionnel populaire peint en 1750 par Maruyama Ōkyo) a maintenant pris force de mythe. Elle représente à elle seule la beauté et la fragilité de notre humaine condition, elle est notre douleur à jamais inconsolée. Yasuo, le sage, le volontaire, nous bouleverse en éternel Orphée. (Le texte est émaillé de plusieurs références à la mythologie grecque, si chère à l’auteur qui tend un fil d’Ariane entre les lieux, les époques, les cultures.)
Ce récit-poème s’annonce en effet dès le départ comme un « thrène » antique, une lamentation funèbre, la langue, le langage assurant une continuité entre les événements et les êtres, même s’il est difficile et dérisoire de mettre des mots sur le drame, de le mettre en mots. Juste la poète annonce-t-elle vouloir laisser quelques « traces de silence » qui rendent compte de « l’écho muet du fond des mers ».
Après la catastrophe (dénouement de la tragédie au sens antique), retour au temps de l’écriture, à la fois rêverie et réflexion, ombres mêlées ici, là-bas. Les deux calligrammes (nef et ancre/flèche) de clôture semblent faire écho aux idéogrammes envoyés sur son téléphone portable par Yuko, retrouvé(s) bien après par les plongeurs : « tsunami énorme ».
Fluidité aquatique, les frontières s’effacent. La douceur de l’air fait place à celle de l’eau, malgré les crânes, les « carcasses rouillées », les « poulpes bleus » et « les algues échevelées ». Yasuo, fidèle à son amour, poursuit sans relâche sa quête impossible, la vie aussi qui fait tourner « ses boucles infinies. »
Et résonne en « l’HOMME » le « AUM » du grand tout.
N.B. On peut retrouver sur le net plusieurs sites relatant l’émouvante histoire de Yasuo Takamatsu.
Présentation de l’auteur
- Marc Alyn, Forêts domaniales de la mémoire - 22 septembre 2023
- Mérédith Le Dez, Alouette - 6 septembre 2023
- Jacques Ibanès, Hokusai s’est remis à dessiner le Mont Fuji - 20 décembre 2021
- Aurélie Foglia, Comment dépeindre - 21 juin 2021
- Thierry Radière, Entre midi et minuit, - 6 juin 2021
- Aline Recoura, Scènes d’école - 20 mai 2021
- Nimrod, Petit éloge de la lumière nature - 6 mai 2021
- Jean-Claude Touzeil, Yvon Kervinio, Prendre l’air - 19 mars 2021
- Louise Dupré, Anouk Van Renterghem, Roses - 21 décembre 2020
- Pierre Dhainaut, Une porte après l’autre après l’autre, suivi de Quatre éléments plus un - 26 novembre 2020
- Marilyne Bertoncini, La noyée d’Onagawa - 6 septembre 2020
- Haikulinaires et autres fantaisies - 29 août 2020
- Estelle Fenzy, Coda (Ostinato) - 21 juin 2020
- Véronique Maupas,Passagère - 21 mai 2020
- Fabienne Juhel, La Mâle-mort entre les dents - 6 mai 2020
- Fabienne Swiatly, Elles sont au service - 21 mars 2020
- Gérard Bocholier, Depuis toujours le chant - 6 mars 2020
- Christian Degoutte, Le tour du lac - 20 décembre 2019
- Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim - 6 décembre 2019