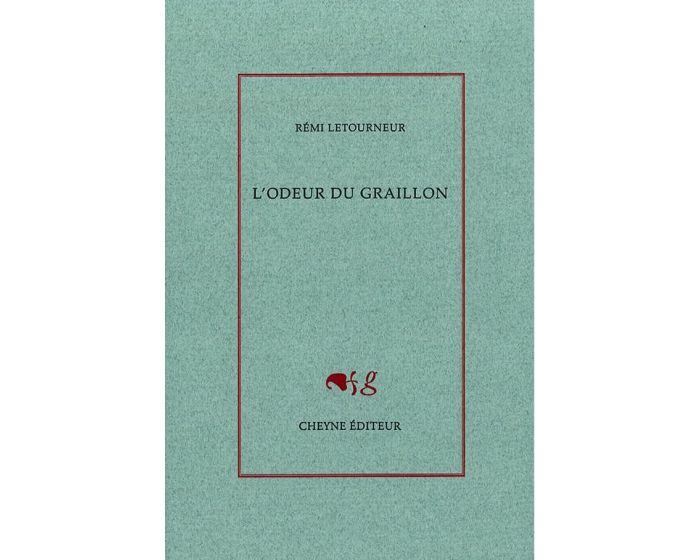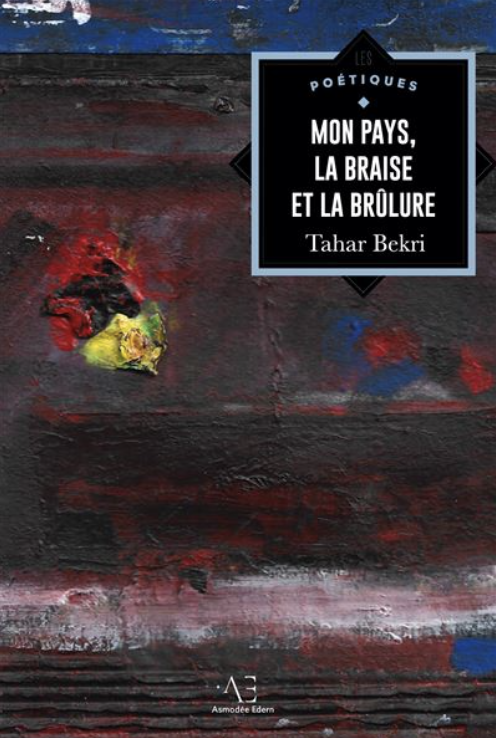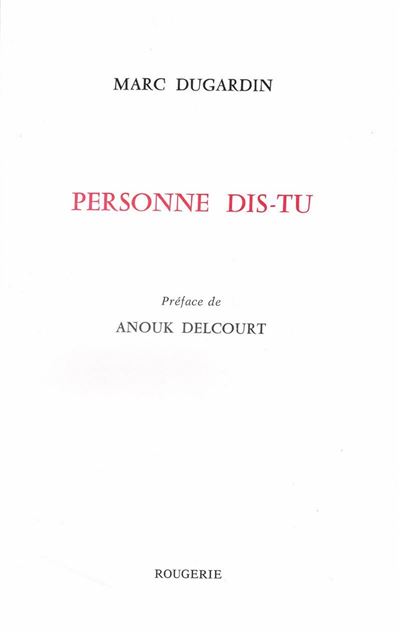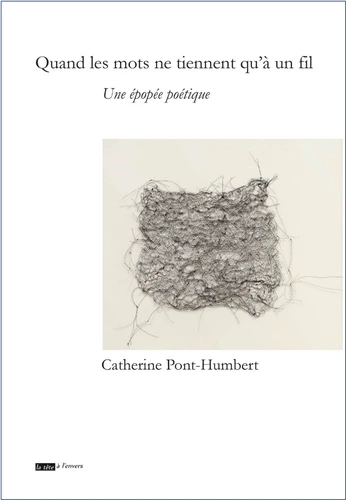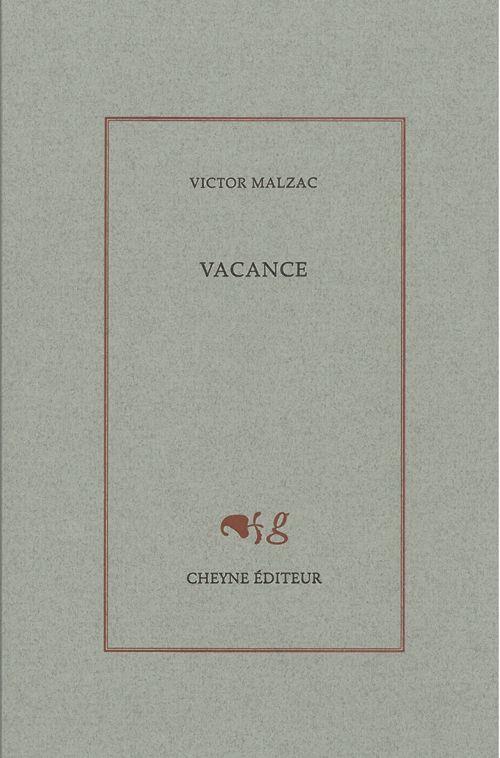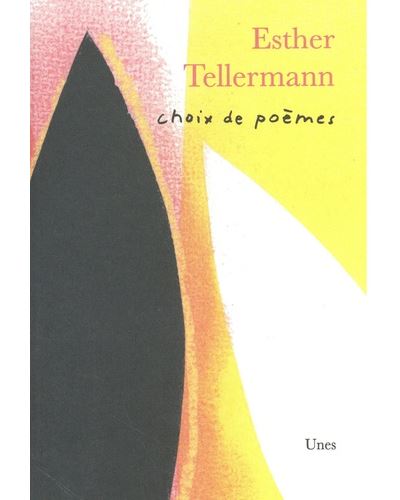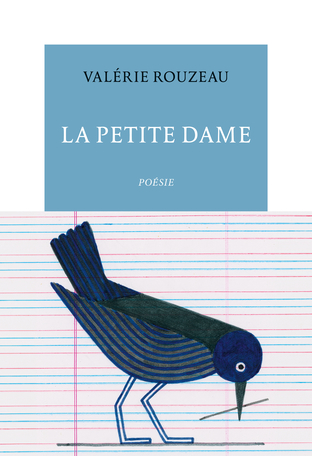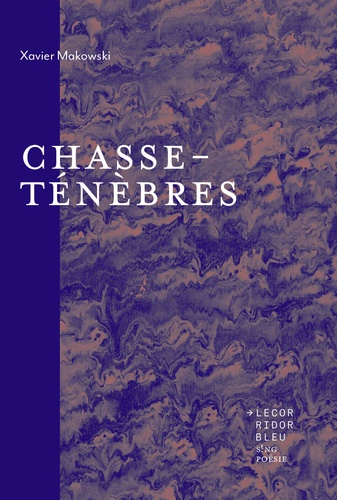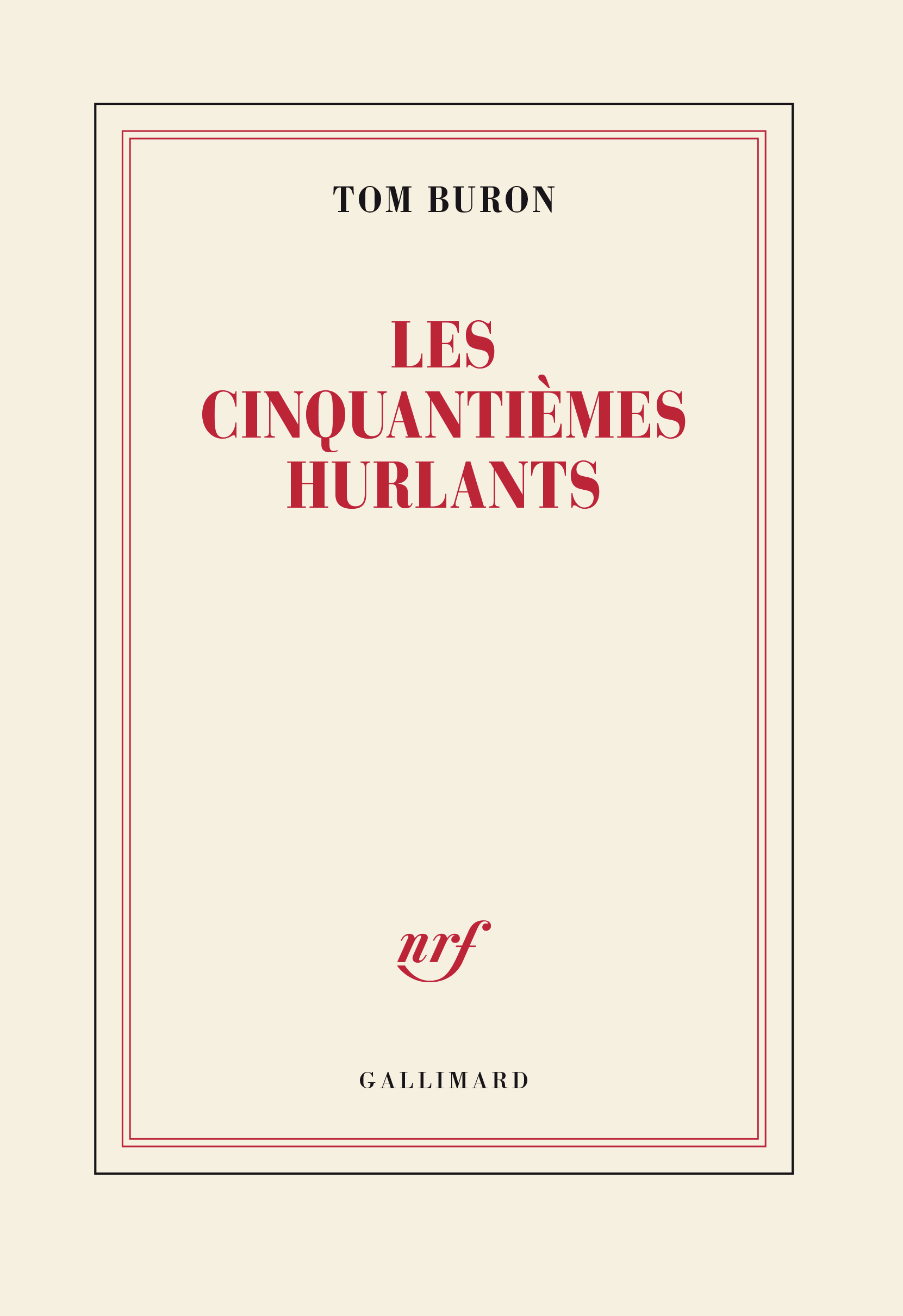Au confluent des sens et de l’énigme, l’écriture au corps à corps que trace Ida Jaroschek dans son recueil, elle l’envisage selon ces formules : « Ces poèmes à mains nues, à voix nue découvrent des mondes, des ciels, des sentiments. C’est bien la nudité qui est ici portée aux nues, la peau qui rejoint l’étendue, les robes qui soulèvent l’azur et le corps qui pèse à même la nuit. » Dans ces derniers, « les grands fauves entrent dans la mer », « les roses prennent aux femmes leur visage », les cargos rouillent dans le port d’Athènes ou croisent au large du port de Ouistreham, et les baisers, les étreintes se mêlent de tout ; l’amour embrase une perspective où la vie plonge vers un inconnu sauvage que le verbe n’a de cesse d’arpenter, à la poursuite de sa piste secrète, à la capture des songes, visions, et énigmes : « Il déploie alors une poésie empreinte de sensualité et de mystère, une poésie qui cherche sa ligne claire en côtoyant les ombres. »
Cet horizon, cette ligne de crête, cette « ligne claire en côtoyant les ombres », c’est celle qui impulse la main à tracer ces poèmes en distiques comme autant de bords de dessins qui portent l’empreinte humaine, la tension érotique même du corps féminin ouvert tant au ciel qu’à la terre, aux principes célestes qu’à la matière première, sensualité, sensibilité, sensitivité mêlées, pour dire ce rapport charnel à soi-même, aux autres, au monde, au grain de la peau. Gilles Cherbut revient, dans son Avant-propos au recueil, à cet aspect essentiel de sa quête d’écrivaine : « Dans À mains nues, Ida Jaroschek délivre un poème sauvage dont le verbe, néanmoins jardiné, exprime sa connivence avec l’amour, avec la mort, avec l’irréductible énigme qui nous contient, nous englobe et nous féconde. En cela, la poésie d’Ida Jaroschek est « un ondoiement, l’ombre d’une flamme, un grain de terre »… Elle est aussi un grain d’or qui, semé dans l’esprit du lecteur, n’en finit pas de dispenser son étincelante incantation, son insondable sortilège. »
Amor, amour, à mort, finalité du désir dans la finitude de toute existence, la poète n’aura de cesse de chanter sur tous les tons, cette rencontre peau contre peau qui fait le sel de la vie tant dans la simplicité des paroles crues que dans la profondeur d’un verbe hermétique dont les paysages traversés ne s’avèrent que les décors inépuisés de ces corps-à-corps que la poésie met en scène, théâtre d’ombres et de lumières où part maudite et part bénite se tutoient dans l’étreinte amoureuse, possibilité d’accord du « je » à un « tu » se hissant au sommet du « nous deux » dont elle demeure la vigie ardente : « Je veille, / je garde là ton cœur serti de nuit / Mes pensées et mes fauves / tapis assoupis inassouvis / fertilisent des territoires / steppes hallucinées traversées de vents, / de mémoire / où ton geste féconde l’air / rejoint le corps des failles » !
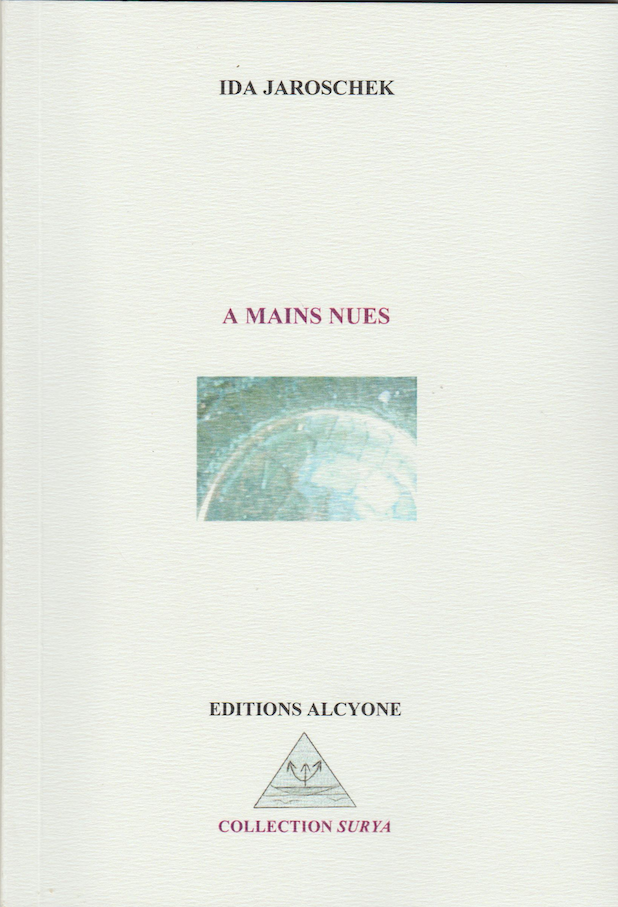
Ida Jaroschek, À mains nues, Éditions Alcyone, Collection Surya, 94 pages, 20 euros.
Lignes de « failles » à devenir autant de lignes de forces de ces courbes féminines où la chair se fait la matière-réceptacle de la matérialité même des contrées foulées qui rythment d’emblée le départ dès les premières pages en invitation au voyage sensoriel : « dense terre noire / au lever des brumes / imprime de cendres la lumière / tout entier dans tes mains / nouées ensemble / tu pars / tu pars navire d’ombre / mon sang » ; psalmodie sanguine jusqu’à l’incantation qui met en route sur les chemins abrupts de cette nature première, in domestiquée, déroutante, avec laquelle la voyageuse ne fait qu’une : « Je suis la séparée, la traversante / corps illimité au prolongement des paysages / au long des crêtes, des failles / nos brèches, des horizons »
Temps et espaces que zèbre le passage des « grands fauves » déclinant, à la rencontre desquels Ida Jaroschek se dirige, intrépide, prête à rejoindre cette possibilité du tutoiement à l’adresse des traces : « Je vois dans les herbes mortes et rases / au sortir de l’hiver des fauves éteints / des oiseaux fantomatiques / hérons blancs alignés dans la brume / Toute à l’oubli du givre / genou brumeux je vais / je vais comme je marche / immobile comme je marche / je vais immobile / et je te rejoindrai sur le chemin des respirants » ; mouvement presque immobile, souffle ténu de l’émotion qui meut, émeut, et que l’écrit destine, selon la dédicace inaugurale : à l’horizon azur indépassable du poème…
- Bertrand Belin, La Figure - 6 mars 2025
- Chroniques musicales (14) : Chant vibrant de Clara Ysé - 6 janvier 2025
- Retour À la ligne, en hommage à Joseph Ponthus - 6 novembre 2024
- Chroniques musicales (13) : Singulière voix de Bertrand Belin - 6 septembre 2024
- Lara Dopff, Ainsi parlait Larathoustra, Viatire, Yves Ouallet, Ainsi vivait Yvan Bouche d’or - 6 septembre 2024
- Chroniques musicales (12) : Bruno Geneste, Sur la route poétique du rock - 6 mai 2024
- Adeline Miermont-Giustinati, Sumballein suivi de le tunnel, - 1 mars 2024
- L’écho de l’écho, le carnet de haïku de l’AFAH N°12 – Novembre-Décembre 2023 - 6 janvier 2024
- Jean-Pierre Védrines, Artaud et les constellations - 30 octobre 2023
- Chroniques musicales (11) : Gaëtan Roussel, l’orpailleur de Louise Attaque à Est-ce que tu sais ? - 30 octobre 2023
- Revue la forge - 29 octobre 2023
- Chroniques musicales (10) : -M- , double masqué de Matthieu Chédid depuis Le Baptême jusqu’à Rêvalité… - 5 septembre 2023
- Chroniques musicales (9) : Raphaël, l’apiculteur de L’Hôtel de l’Univers à Haute fidélité… - 29 avril 2023
- Dominique Sampiero, Ne dites plus jamais c’est triste - 29 avril 2023
- Lu Ji, Wen Fu, Essai sur la littérature - 21 avril 2023
- Possibles N°27 – Où va la littérature ? - 6 avril 2023
- Pierre Seghers, La Résistance et ses poètes - 6 avril 2023
- Revue Cairns n°32 - 19 mars 2023
- PHŒNIX N° 38 – GIANNI D’ELIA - 2 mars 2023
- Chroniques musicales (8) : Serge Gainsbourg, de Lucien Ginsburg à « Gainsbarre », variations de L’Homme à Tête de Chou… - 1 mars 2023
- Ida Jaroschek, À mains nues - 1 mars 2023
- Daniel Brochard, Lettre d’un ex-directeur de revue de poésie à un jeune poète, Mot à maux, Manifeste pour une poésie sociale - 6 février 2023
- Chroniques musicales (7) - 5 janvier 2023
- Florence Saint-Roch, Au bout du fil, encres de Maud Thiria - 21 décembre 2022
- Bruno Doucey et Robert Lobet, Peindre les mots. Gestes d’artiste, voix de poètes - 6 novembre 2022
- Par-delà le noir — Pierre Soulages - 4 novembre 2022
- Dominique A, de l’ardent Courage des oiseaux à la Vie étrange… - 6 octobre 2022
- A propos de XXL…S — entretien avec Marilyne Bertoncini - 12 août 2022
- Maïakovski, Un nuage en pantalon - 1 juillet 2022
- Hélène de Oliveira, Un thé aux fleurs bleues - 20 mai 2022
- Revue Voix d’encre, numéro 66 - 3 mai 2022
- La Main Millénaire, une aventure poétique - 3 mai 2022
- Laure Gauthier, Les corps caverneux - 20 avril 2022
- À la Une d’oulipo.net : site officiel de l’Ouvroir de Littérature Potentielle - 20 avril 2022
- Chroniques musicales (6) : Mélodies du dandy Christophe, d’Aline aux Vestiges du Chaos… - 5 mars 2022
- La Peinture La Poésie, Numéro 81 de Poésie/première - 5 février 2022
- Chantal Dupuy-Dunier, Les Compagnons du radeau - 21 janvier 2022
- Revue Festival Permanent des Mots, numéro 26, La Poésie Manifeste - 5 janvier 2022
- Chroniques musicales (5) : Feu ! Chatterton, trajectoire(s) D’ici le Jour (a tout enseveli) au Palais d’argile - 31 décembre 2021
- Teo Libardo, Il suffira, Emma Filao, éparpiller la peau, Élisa Coste, Les chambres - 20 décembre 2021
- Yves Ouallet, De L’écriture et la vie ou la volonté de Sur — Vie à l’Apocalypse pour notre temps - 6 décembre 2021
- Alain Nouvel, Sur les bords de l’Empire du Milieu - 21 novembre 2021
- Chroniques musicales (4) : Le Voyageur Solitaire, Gérard Manset - 1 novembre 2021
- Julien Blaine aux éclats du dire ! - 6 septembre 2021
- Marilyne Bertoncini et Ghislaine Lejard, Son corps d’ombre - 6 septembre 2021
- Revue Francopolis, numéro 166 - 6 mai 2021
- Chroniques musicales (3) : Nous n’avons fait que fuir de Bertrand Cantat et de Noir Désir, aux éditions verticales. - 2 mai 2021
- Pour un horizon jaune flamboyant ! Cathy Jurado et Laurent Thinès, FEU (poèmes jaunes) - 21 avril 2021
- Ito Naga, Dans notre libre imagination - 5 mars 2021
- Chroniques musicales (2) : Vertige de la création, Alain Bashung de Gaby à Immortels… - 5 mars 2021
- Perrin Langda, poésie assistance 24h/24, Fabien Drouet, Je soussigné, attestations dérogatoires de sortie - 6 février 2021
- Chroniques musicales (1) : De l’univers de Christian Olivier, des Têtes Raides et des Chats Pelés - 5 janvier 2021
- Jean D’Amérique, Atelier du silence - 21 décembre 2020
- Catherine Pont-Humbert, légère est la vie parfois - 26 novembre 2020
- Une sorte de bleu… - 6 novembre 2020
- Lucien Suel, La justification de l’abbé Lemire - 21 juin 2020
- Hélène Dassavray et Zaü, Quadrature de l’éphémère - 21 mai 2020
- Cécile Coulon, Noir volcan - 21 avril 2020
- Amnésies, Marlène Tissot - 21 mars 2020
- Thomas Vinau, C’est un beau jour pour ne pas mourir - 6 mars 2020
- Maïakovski, Un nuage en pantalon - 5 janvier 2020