Fil autour de Catherine Gil Alcala, Serge Pey, Olivier Domerg
Catherine Gil Alcala, La Foule divinatoire des rêves,
Il est une poétesse qui grandit avec ses rêves. Ceux-ci sont les lieux où se réfugient ses pensées, où tout peut arriver, où rien n’est impossible. Là, Catherine Gil Alcala s’évade à sa façon, déployant et dévidant ses cœur et corps enchevêtrés. Il arrive qu’ « un morceau d’arc-en-ciel tombe à ses pieds », qu’ « un nain chevauche un chien en pelure d’orange » , que « des mains d’arc-en ciel déroulent des rubans bariolés »…
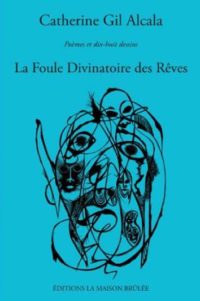
Catherine Gil Alcala, La foule divinatoire des
rêves, Editions La maison brûlée, 2018, 15€.
Il arrive que « la dame d’un mirage joue au bilboquet aztèque » ou qu’une autre dame « dévore le cœur épicé de l’amant ». L’auteure y rencontre même l’homme d’un rêve qui « joue son propre rôle » : Lawrence et « sa parole dépersonnalisée dans les bruits de quincaillerie de l’immensité » ou Lear – sans doute le roi - « allongé sur un lit pliable ». Sa poésie flotte au-dessus du monde de poème en poème, à l’image de la vision qu’elle déploie d’elle-même : « Je marche sans toucher le sol » (rêve 26), puis « Je marche vers le rivage/Je veux me noyer dans la mer pour renaître » (rêve 30). Un tel « vertige au bord du vide/dans le miroir éternel d’âme folle » (rêve 35), raconte ainsi l’histoire d’une femme dont la plongée dans le gouffre sous-marin aurait pu être noyade, mais qui revient vers le rivage où apparaît un crabe jaune, « une étoile de mer » . La créatrice accomplit une sorte de ronde à travers elle-même, où toute fin n’est qu’apparente mais recèle en secret un autre commencement. Se deviner soi-même à travers ses rêves-miroirs offre parfois d’heureuses surprises.
Cette performeuse met ensuite sa poésie en dessins fugaces et sombres, en mouvement et en gestes. Elle la prolonge en une sorte d’offrande délicieusement illogique devant les spectateurs de son théâtre de l’intériorité (La foule divinatoire des rêves, Déréliction de l’Art, Miroir 10).
∗∗∗∗∗∗
Serge Pey, Mathématique générale de l’infini
D’où vient l’envie soudaine de consulter cette Mathématique générale de l’infini, de me jeter dans ces mots poétiques – certes mon habitude – déchaînés sur quatre centaines de pages ? Comment entrer dans un tel univers disposant de multiples portes d’accès, évidentes ou secrètes, réelles ou inventées, hall ou vestibule, cul-de-sac… au risque d’être emportée par un courant d’air ou un ouragan.
L’auteur en soi excentrique avait accepté au Marché de la Poésie de me dédicacer son livre sans que je ne le mette à sa disposition (l’opuscule était resté chez moi). Sur mon cahier de brouillons, j’ai eu néanmoins droit à la même estime que la solliciteuse précédente qui serrait en main le vrai produit Gallimard. A savoir une dédicace au stylo noir sur laquelle se pose, en un second temps, un personnage succinct esquissé au stylo rouge. Serge Pey s’exécuta avec une étincelle fugace dans le regard, écrivant au noir : « A Jeanne, mon amie/Sur ce livre absent/En remontant l’échelle de tous les poèmes/En vous embrassant». Puis au rouge, il traça d’emblée un personnage au corps quasi-rectangulaire dans la lignée d'une dalle funéraire : la tête en bas avec deux yeux ronds, les deux pieds en haut et sans mains (hormis deux gribouillis rouges).
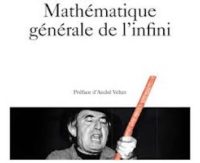
Serge Pey, Mathématique générale de l’infini,
préface d’André Velter, Gallimard, février 2018,
432 pages, 8, 50 €.
Position inconfortable à la Docteur Knock ! L’énergie graphique de Pey pour la banale passagère du Marché que j’étais, m’imposa un pensum d’été : essayer de croire que je pouvais cerner une démarche poétique qui semblait faire tout pour se rendre insaisissable.
La première interrogation sur le titre de l’ouvrage, intégralement répété dans plusieurs poèmes (Le haut sacrifice de midi, Monnaie nouvelle au 21ème « bâton ») confortait déjà mon goût secret de l’énigme. Semblable intitulé révèle habituellement un idéal philosophique : la « mathématique » (l’ordre et la quantité de quelque.s chose.s) de l’« infini » (n’ayant de limite ni en forme ni en taille) est néanmoins susceptible d’être « générale » (en regroupant la majorité ou tous les cas). Ni plus, ni moins ! Ouf. L’art mathématique devrait donc se révéler plus ou moins subrepticement au fil des pages - tantôt ici, tantôt là - de diverses manières.
Tout d’abord par les signes traditionnels propres aux opérations mathématiques. Ainsi en est-il de la multiplication : « Pour multiplier le chemin/l’homme a besoin de deux bâtons/qu’il croise comme un signe ». Puis de la soustraction : « Nous soustrayons le Nombre/à son chiffre imparfait ». Puis de l’addition : « Nous traçons la croix/d’une addition/quand un oiseau s’échappe du vent/pour s’ajouter à un arbre». Puis de la négation : «Nous jetons des oui/puis des clefs/pour entrer dans les négations ». Dans quel but ? Le poète ne semble pas hésiter puisque « Nous organisons l’ordre/dans le désordre des boussoles » .
Cet enchevêtrement inextricable n’était pas pour me déplaire, car la raison s’y perdait. Alors pourquoi ne pas persister à lui arracher un sens, ne serait-ce que pour justifier cette note de lecture. L’aspect réducteur du projet parut évident : l’insensé se contentant de lui-même ! Je choisis d’emprunter un chemin de Petite Poucette, d’abord rythmé par le repère/repaire des nombres, mes pierres d’égarement très calculé !
Ah, soutient carrément le poète : « Nous sommes/le Nombre/C’est nous/Nous comptons/sans compter/Nous soustrayons le Nombre à son chiffre imparfait » . « Compter sans compter » ou « chiffre imparfait »… Des aberrations logiques inscrites en une phrase poétique saccadée, haletante, hachée en petits morceaux. Des miettes d’insensé encensé. D’un tel constat découle aisément l’affirmation : « le soleil est un zéro/au fond du puits » . Le cercle solaire peut se tapir, telle la vérité, au fond d’une excavation. Pourquoi pas ? Pourtant chacun sait que le zéro étant zéro, il est un rien sans lieu ou place ! Ou du moins n’a-t-il de place qu’en poésie dans l’imaginaire fulgurant du créateur. La meilleure, sans doute.
Rien ne nous étonne plus désormais. Une telle incohérence* peut muer l’univers de Pey en un bûcher stupéfiant, introducteur d’un infini imprévu qui n’est pas tout à fait lui-même : « Les photos/voient brûler leur halte/et saluent les chiffres/venus d’un infini/caché dans une marge ». Derrière cet infini marginal – difficile à concevoir - s’inscrit en outre un second infini (le même masqué ? le même devenu autre?). Or ce néo-infini peyien/peyesque ne supporte pas l’enfermement ou le confinement dans sa « marge » . « Je ferme la porte à clef/car elle prend/ l’habitude de l’infini/ de son ouverture entrebâillée». Ici, on n’est pas dans la chambre close où Barbe Bleue case ses épouses curieuses !
Tout se complique en découvrant que cet infini version Pey possède de surcroît les caractéristiques du fini qu’il n’est pas. Cet infini là - paradoxal car fini - se mesure pour donner un réel tournis au lecteur. Ainsi il est possible de « compter les pieds/de l’infini » et de les compter deux fois et même d’« allonger l’infini/d’un pas plus grand que lui » . Pour aller encore plus loin, l’infini se développe non seulement dans l’espace – trop facile - mais aussi dans le temps du poète qui se cale sur celui de l’homme préhistorique de Tautavel : « J’ai/quatre cent cinquante mille ans/plus ou moins l’infini/sans lui et contre lui/Je ne sais pas s’il est fini/ » . Tels sont les prémices vertigineux de notre « humanité du XXIe siècle » ! Cette temporalité immense est reprise en leitmotiv : « J’ai/quatre cent cinquante mille ans/Je ne sais pas/un peu moins/un peu plus/que l’infini » . Pris dans le temps ce qui cesse d’être le temps chronologique en devenant l’éternité - le toujours temps, le encore-temps-, le poète (ou le lecteur/rice) revient au point de départ (le titre de l’ouvrage). En effet, cette éternité soustrait le paysage « dans la mathématique générale de l’infini ». Un temps-espace qu’il n’est pas vain d’appréhender ou de détruire. Une « épitaphe » porte cette alternance fini-infini, telle une marque de la vie-mort : « Car mourir c’est voir/de tous les angles de la maison infinie/jusqu’à ne plus penser qu’on voit ». Vivre consistait, à l’opposé, à voir une maison finie en pensant toujours qu’on voit. Vivre ou mourir, ont un point commun : « voir » . Reste qu’à un moment du déraisonnement poétique le poète lui-même n’en peut plus : sa quête mathématique d’infini devient : « un coup de fusil /tire vers l’Autre chose/qui balaie le champ/où l’idée d’un dieu mort… »
Que noter encore dans ce dédale poétique possédant différentes strates de lecture ? La prééminence d’un « nous » , porteur d’engagement. Il honore ce Pey qui dansa la sardane devant les fusils dans l’horrible camp de concentration d’Argelés (comme Rimbaud chantait dans les supplices). Cet incarcéré est-il l’un de ses ancêtres (ou s’il ne l’est il pourrait l’être) auquel il s’identifie ? Le « Je » n’est qu’exception que le poète Pey s’autorise pour être celui de cette femme « envoûtée » qui abandonna sa fillette sur une plage de Berck. Il exprime parfois des moments insolites : « je te caresse avec un lézard de morphine/et je jouis à mort dans ta chèvre puante et tes crapauds » . Ou il s’inscrit dans une conjugaison personnelle, donnant un coup de pied à l’orthographe : « Je tu nous vous îles ailes » .
De fait, sa pensée s’exprime sans ponctuation tantôt par coup de butoir au réel (« Avorteuse d’escargots/et de sardine » , « Nous portons des étoiles/dans un sac de pommes de terre/et d’oignons » , etc., tantôt par une propension à la définition originale (la mort est un miroir, les mots sont les petits jouets cassés de la mort, la mer est mère des poupées, la lune est une roue de trop à la brouette, le vent est un oiseau, etc.). Une clef de lecture possible est donné au hasard des pages : « Quand nous commençons/une définition/par un article indéfini/nous écoutons/ deux fois l’infini/dans tout ce qui a disparu** »
Que voulez-vous, « Nous sommes là pour rire » ! Le poète le suggère. A moins qu’il ne se mette, comme le Guignol lyonnais, à donner des coups de « bâton » pour les bêtises commises en ce commentaire. Ces bâtons sur lesquels il a déjà inscrit ses propres poèmes, peuvent accueillir de nouvelles colères, critiques ou des désaccords avec le monde.
****
* Le mot n’est pas péjoratif mais logique
** Le lecteur souligne la racine des mots, non le poète qui l’emploie.
∗∗∗∗∗∗
Olivier Domerg, La somme de ce que nous sommes
« La somme de ce que nous sommes », ce dont nous sommes la somme. Voila un titre qui tourne en boucle dans la tête et se retourne sur lui-même, tantôt comme un serpent Ouroboros se mordant la queue, tantôt en s’enrubannant en un Möbius du langage.
Nous sommes presque sommés de croire que nous sommes la somme de quelque chose, nous additionnant en quelque sorte à nous-mêmes. Pourquoi ne pas explorer ce mot « somme » avant de se lancer dans la rédaction d’un commentaire ? Son et sens emmêlés. Le poète-enfant Olivier Domerg se glisse ainsi… dans un « demi-sommeil si léger, si sensuel » qu’il en perd la notion du temps ! En une sorte de vertige, il découvre que « nous sommes faits de vieilles géologies intérieures, de sombres épaisseurs du temps ». Il est alors emporté vers « l’absence de sommeil » plus extrême, cette « insomnie comme un scalp ; comme un rapt ». Il continue néanmoins imperturbable ses additions sur le vif : « En somme », il tisse et « tresse » trois états du texte qu’il détecte et déploie à travers ces lieux magiques d’enfance que sont le jardin, le ruisseau, l’île. Cette triade d’espaces singuliers propices – ici ou là – engendrent des souvenirs et sentiments également singuliers. Autant de bases « de départ » en quelque sorte, toujours en connivence avec ce qui la suit tout en la … précédant.

Olivier Domerg, La somme de ce que nous sommes,
Editions Lanskine, 2018, 112 pages, 14 €.
Nous n’échapperons pas à cette lecture-commentaire grâce à un « somme » apaisant ! Car nous réalisons brusquement la présence – pourtant évidente - de ce « nous » dans l’intitulé. « Nous », c’est qui ? Domerg et ses lecteurs ou ses copains d’enfance indistinctement, Domerg et les humains en général dont moi en particulier, Domerg qui se pense en être universel. Rien n’est impossible. Chacun de nous étant universel à sa façon ! Tout prend peu à peu sens, d’autant que les qualités graphique et humaine de l’édition (*) incitent à poursuivre.
Offrons-nous d’abord un caprice de lectrice, en entrant dans le « bleu » , un certain bleu franc dont la présence est ressentie sous les mots de chaque poème ? Certes ce bleu Domerg occupe une place d’emblée reconnue, celle du ciel. « Toujours bleu ? Bleu dans la chair de nos souvenirs. Bleu dans la conscience aigüe que nous en avions ». Pourquoi ? Parce que l’enfance « est le lieu de la clarté la plus vive » , celle du commencement ou du point d’origine. « Si le ciel est toujours bleu, c’est que l’enfance est lumineuse ». Les équivalences espace et bleu, temps et enfance constituent son évidence poétique.
Ce bleu – son bleu - se décline différemment selon les lieux dans la nature : il peut être le bleu « extatique » du parc du Mugel aux « configurations précises » dans le Sud (parc de la Ciotat). Un bleu en extension qui va depuis « Saint-Jean jusqu’aux Crêtes, immense, troublant » . En Bretagne, il devient pourtant celui de « l’ombre » des « blockhaus éternellement enlisés » . Plus culturel, il peut se muer en cette couleur peinte sur le « tableau de Jean » , dont l’eau est d’un « bleu soutenu ».
Il advient que ce bleu croise le blanc : ici, la « fixité du bleu, blanc des roches » au bord du ruisseau ; là, le surgissement de la « nature » (de l’objet île, ce me semble) « nette et blanche sur fond bleu » . Cette contiguïté du blanc et du bleu est, d’une certaine façon, très méditerranéenne (à la grecque).
Choisissons l’île pour séjour de l’esprit, aboutissement ou début de soi ? Ce lieu de fantasmagorie est tantôt un « jouet » de l’imagination, tantôt au « commencement de l’écriture » , tantôt cette même île est « elle », tantôt elle est « il/lusion de sa présence ». Cette enfilade de significations insulaires se développe du réel (jouet) au conçu (écriture), au genre (il-elle) puis au produit ludique d’un jeu de sonorités (il/lusion). Ainsi la pensée du poète revient autrement… au jeu du jouet !
Il apparaît peu à peu que ce poète à la légèreté profonde – oxymore ! – cherche et vit selon une « géométrie du plaisir » . Ce goût du jouissif émerge dès que ce premier mot prononcé devient « JEUométrique » en remuant nos trompes d’Eustache ! Il conduit du ruisseau « jusqu’à la mer », en suivant une leçon traditionnelle de géographie. Après tant et tant de marches de pierres dévalées dans le jardin, les enfants entendent « la conque des songes » , la « crécelle enrouée » d’un moulin sonore, découvrant d’autres cordes « contre les sœurs de la harpe » : une musique secrète et subtile perce ainsi derrière la prose.
Cependant le lieu mental de l’enfance n’est pas dans ce passé où chacun croie qu’il est.… Notre enfance qui « grandit » reste « devant nous » . Au fil de sa croissance, elle grandit en permettant aux ancêtres d’émerger : ainsi grand-mère qui, « comme un roc chantourné (…) fixe la trame incessante des vagues » ; ainsi grand-père qui joue du violon en gilet et costume sombre, « debout devant la bibliothèque en acajou » . Est-elle aussi cette « forme dans la forme » (pas seulement celle de l’île) ? Nous retrouvons ça et là « les identités fluettes et lumineuses de ceux que nous sommes et que nous fûmes » . Nous sommes… Nous voici revenus au début de ce commentaire, et même avant lui puisqu’il est question de ce « que nous fûmes » ! Il ne manque plus désormais que la somme de ce que nous serons ! Elle sera peut-être dans le prochain ouvrage ?
****
(*) L’édition dont le nom révèle l’histoire d’une grande amitié de M. Lanskine avec l’éditrice Catherine Tourné, base de sa présente démarche éditoriale.