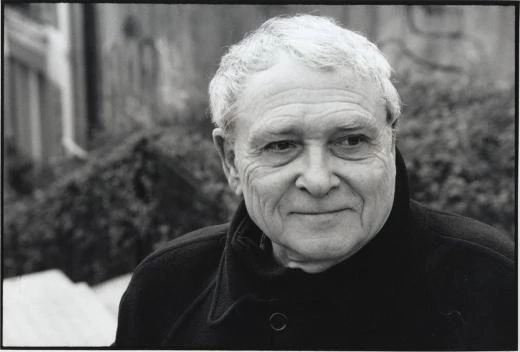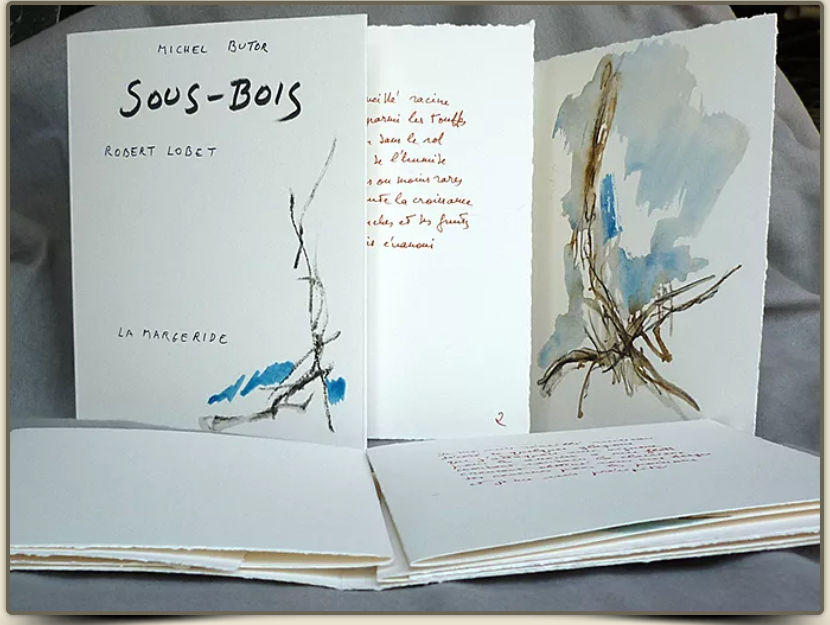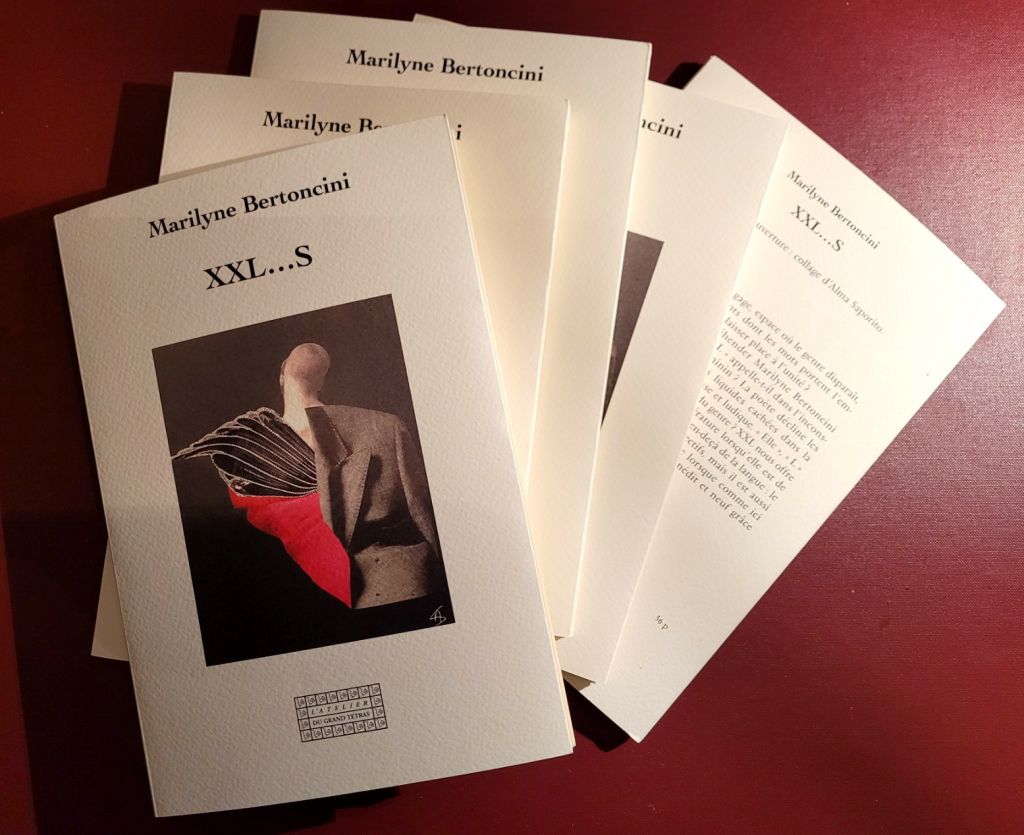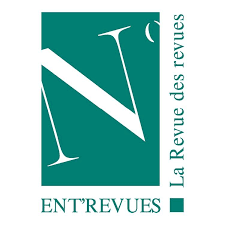Cher Gilles Baudry, merci d’accepter cet entretien depuis ce lieu de silence et de prière qu’est l’Abbaye de Landévennec dans laquelle vous vivez. Vous êtes moine. Vous êtes poète dont l’œuvre est publiée presqu’exclusivement chez Rougerie, sauf votre dernier opus édité par Ad Solem. Et la première question que l’on peut se poser vous concernant est celle-ci : écrire de la poésie, pour un moine obéissant à l’ordre des Bénédictins, n’est-ce pas entrer en contradiction avec la parole de Jésus transmettant le Notre-Père comme prière suffisante pour parler à Dieu ?
La prière du Notre-Père est centrale dans la liturgie ; elle est au cœur de l’Eglise, son cœur battant puisque la seule prière de Jésus transmise à ses disciples ! Une prière qui va jusqu’à nous faire entrer dans la prière même de Jésus. Tant de commentaires ont été écrits et l’on ne peut en parler qu’en retirant ses sandales…
Mais votre question semble remettre en cause la légitimité de l’écriture poétique. Au fond : que sont les mots en regard de l’unique Parole ? En effet n’était l’Incarnation où le Verbe n’a pas pris d’autres mots que les nôtres (au risque des malentendus !), toute poésie (mais aussi toute théologie, toute exégèse) serait incongrue.
Mais ce serait oublier que toute la Bible est à la fois parole et écriture humaine et divine ; que Dieu, qui a fait alliance avec l’homme ne cesse d’appeler. La prière, c’est toujours un “répons”, donc. Le poète croyant ne peut être qu’un serviteur de la Parole, humblement et jamais à la hauteur de la page blanche. Toujours balbutiant, débutant permanent. Le théologien médiéval se penchait avec amours sur la “pagina sacra”. Quand l’écriture lui faisait signe, jamais il ne séparait les lettres d’avec l’esprit. Malheureusement, nous avons versé dans l’hyperconceptualisation. Or, les mystiques d’Orient et d’Occident pratiquaient conjointement théologie, spiritualité et littérature.
La poésie est un tropisme d’intériorité et celle-ci est mise à mal aujourd’hui. D’autre part, la foi réduite à un “intellectus” perd tout contact avec la vie. Aussi ai-je émis le souhait, en notre époque de désymbolisation, que la poésie soit un contrepoint à la rationalité théologique… Dans un dernier opus, aux éditions Ad Solem (Demeure le veilleur) voulu et préfacé par Nathalie Nabert, je désirais que le poème se fasse offrande et le poète, prière afin que plus rien ne s’interpose entre le secret de la poésie et le mystère de Dieu. Y suis-je un peu parvenu ?… Parole et silence, visible et invisible, prière et poésie se pollinisent…
Vos publications sont régulières. La règle bénédictine à laquelle vous obéissez semble très stricte, depuis les heures matinales jusqu’aux dernières prières du soir en passant par vos obligations de vie en communauté. Dans quelles conditions composez-vous votre poésie ?
Votre question rejoint ma propre interrogation, étonné que je suis d’avoir page à page, recueil après recueil, élaboré organiquement et avec cohérence ce qu’il faut bien appeler “une œuvre”, comme à mon insu et sans préméditation. Du moins à l’origine j’étais dépourvu de cette ambition-là. Je n’ai fait que creuser un sillon pour accueillir et ensemencer les mots offerts.
Quant au temps consacré à soi (qui ne saurait être confondu avec l’oisiveté) : l’ “otium litteraturae”, il ne m’est accordé que par surcroît. Pourtant, ce sont des moments, rares, retirés à l’écoulement des heures… Sous la lampe et à ma table d’écoute, j’écris adossé à mon âme. Il s’agit de trouver l’adéquation entre le monde et soi sous la dictée de la voix cachée.
Votre poésie est en rapport constant à la transcendance. La vie régulière permet-elle un rapport au temps humain ordinaire ?
C’est surtout le temps ordinaire des petites heures notre lot. La quotidienneté qui n’est pas pour autant incolore. Pour ce, il faut habiter le temps, retrouver le sens de la durée. Notre rapport au temps est inhérent au sens donné à l’existence. C’est le “Présent intérieur” (l’un de mes titres) que nous avons à conjuguer, non le “présentisme” actuel qui rend le passé dépassé et l’avenir incertain. L’immédiateté fébrile, la tyrannie de l’urgence, le culte de la vitesse sont néfastes. On ne vit pas, on est vécu…
Dans la liturgie des heures il y a un “mystère du temps” : Dieu lui donne une qualité. D’où la nécessité de demeurer constamment en éveil car il ne cesse de passer, de venir. C’est parce que notre Dieu est l’Eternel qu’il a pouvoir de nous venir en aide chaque jour. Maître des temps, il est contemporain de tous les âges. Et nous n’existons vraiment qu’à cause de l’éternité de cet amour. Loin de nous évader dans un futur utopique ; loin de nous enliser dans un passé mythique, nous avons à vivre cet “entre-temps”, cet équilibre dans un “déjà-là” et un “pas encore”. Car l’au-delà, nous le portons au plus intime de notre cœur. “Le temps a cargué ses voiles pour entrer au port d’éternité”, selon l’image marine de St Paul (1 Co 7,29).
Votre parole ne se départit jamais de la simplicité. Elle est dense, profonde, et les titres de vos recueils le disent : Nulle autre lampe que la voix, La seconde lumière, Présent intérieur, Invisible ordinaire, Versants du secret, Demeure le veilleur. Est-il fondamental de puiser son inspiration à la contemplation de la nature, et d’en faire un rapport avec le cosmos intérieur de l’être humain ?
Avec Plotin, il faudrait vivre, être dans l’ “épistrophè”, l’âme faisant peau neuve, retrouvant sa véritable nature en contemplant la beauté sensible. Et le mystique irlandais du IXème siècle Jean Scot Erigène voyait dans le cosmos une théophanie du Dieu caché. La nature était pour G.M Hopkins, selon Kathleen Raine, le “Corpus Christi, l’Hostie partout consacrée”.
Pour ce qui me concerne, mon amitié-complicité avec les arbres, l’estuaire, les ciels de Bretagne, le miel de la lumière baignant les paysages… ne fait que croître. Louer devant la création — 5ème Evangile — constitue un prélude à la vision. Bénédictin, ma porte est franciscaine sur ce plan-là et je me sens en accord majeur avec la pensée d’Eloi Leclerc.
Le titre de l’un de vos recueils interroge : Nulle autre lampe que la voix. Le Christ disait : “La lampe du corps, c’est l’œil”. Vous semblez lui répondre avec malice ?
La contradiction n’est qu’apparente car le Christ se dit aussi la “voix” (du berger) et la “voie” vers le Père. Et Claudel parle de “l’œil qui écoute”. Rétrospectivement, j’ai le regret de n’avoir pas lu à temps cet aphorisme de Pierre Dhainaut : “Pour toute lampe notre écoute” et d’en avoir fait un titre. Le poète écrit comme on écoute. La page, il se la joue à l’oreille. Le poème comme une partition s’adresse à des lecteurs-auditeurs.
Quel medium que la voix, la vive voix, l’acte de lire, sans quoi l’écriture serait orpheline… Art délicat de dire un texte sans dramatisation outrancière, sans exagération… et sans minimisation plate non plus. “Une lente lecture, disait Bachelard, donne à l’oreille tous les concerts”. Toute langue n’existe-t-elle pas que prononcée ? Notez que “Mikra” désigne la Bible ainsi que “lecture à haute voix”… Il faut respirer les mots en respectant la ponctuation et habiter le texte : seule clé pour trouver le ton juste, les inflexions qui touchent. En résumé : le silence serait la basse continue ou la fondamentale ; la voix, le chant de l’être, H.G Gadamer dit : “la lumière qui donne reflet à toute chose, c’est la parole”.
Vous êtes un homme reclus, dans une société totalement extravertie. Ce qui vous parvient des métamorphoses du monde influence-t-il votre inspiration ?
“Reclus, c’est beaucoup dire. Si j’ai fait vœu de stabilité je ne suis pas “assigné à résidence”. Le monastère est un enclos ouvert et, comme l’écrit Guillevic, “les vrais murs sont en nous”. Le pèlerin sédentaire n’est pas vraiment si immobile que cela… La marche quotidienne — fut-elle limitée — m’est nécessaire, féconde pour la prière comme pour le poème. Elle permet la concentration dans la détente, la méditation sans tension.
Quant à ce qui influence mon écriture, sauf dans les notes de mon carnet et en des cas assez rares (cf. le génocide du Rwanda, l’assassinat des moines de Tibhirine…) je laisse aux journalistes, dont c’est la vocation, le soin de relater “l’écume des jours”. J’essaie comme d’autres poètes, de déceler une minuscule odyssée dans l’existence la plus terne. Rien n’étant insignifiant…
Beaucoup de vos poèmes évoquent l’ombre, la nuit, la mort. Est-on poète, est-on moine, pour apprivoiser le moment décisif de la mort ?
C’est bien possible, au moins inconsciemment. Depuis plusieurs années, je tente de me constituer une anthologie personnelle des plus beaux poèmes à lire. A ma surprise, la plupart “tournent” autour de la thématique de la mort. Si oubliée par les médias, la poésie s’avère paradoxalement l’ultime recours testamentaire lors des sépultures.
Dans son dernier livre qu’il vient de me faire parvenir (“Cinq méditations sur la mort”, Albin Michel) François Cheng exprime la vue profonde selon laquelle c’est la fin, la mort qui est en mesure d’éclairer la vie. Bénéficiant d’une double culture et convoquant Rilke, Shelley, Fondane, Hugo, Bergson, Wang Wei, il témoigne d’une vision de la vie en mouvement ascendant qui renverse notre perception de l’existence… Rien ne s’achève. “Sic transit…” Tout passe, tout est périssable, et la mort aussi ! La mort n’a pas le dernier mot. Le premier-né de nos tombeaux, par sa résurrection, fait de nos cercueils des berceaux en quelques sorte. L’enfance éternelle est devant nous. Mais le grain doit mourir en terre pour porter fruit. Nul autre sommeil que le repos dans la lumière. Cet horizon derrière l’horizon est l’éternité qui nous attend et nous convie… Mourir, c’est réaliser enfin qu’on a plus sa vie en mains, et consentir alors, comme le Christ, à remettre notre esprit entre les mains du Père de qui tout vient, vers qui tout va. Dès lors, la mort n’y peut rien. Quand elle arrive en charognard, il ne lui reste que les restes. Que la “carcasse”. L’essentiel est Ailleurs…
Comment le poète Gilles Baudry perçoit-il la notion de paradis aujourd’hui ?
Loin de moi l’idée d’évoquer les fallacieuses “arrières-mondes” dénoncés par Nietzsche. D’autant que la spiritualité monastique parle plutôt de “vie éternelle”. Un au-delà qui est un au-dedans, univers caché déjà présent au cœur du monde. Plus qu’un ciel à mériter, un Royaume à accueillir, donc. Le paradis : moins un lieu qu’un état. Et comme l’écrit J.Cl. Renard : “Un monde infiniment plus beau que son attente”.
Et poétiquement parlant, qui ne désirerait à travers ses vers cette “musique du paradis” qu’un Dylan Thomas voulait faire entendre ? Cette musique affiliée au silence et à la lumière (comme chez Dante) ne nous offrirait-elle pas — en prélude — l’image sonore de la grâce ? Le pressentiment du paradis, il m’arrive de l’avoir en des moments rares à vous éblouir l’oreille lors de concerts, d’écoute de telle cantate de Bach, de tel motet de Tallis, de Victoria… Ils me “transportent” et m’arrachent des larmes comme ce fut le cas au Togo ces danses au son du tam-tam ou, plus récemment la voix cristalline de Divna, le violon virtuose de Natacha Triadou.
Beaucoup de vos poèmes, discrètement, humblement, traduisent une connaissance profonde de l’invisible, ce que le commun des mortels perçoit rarement sauf à vivre ce que l’on nomme philosophiquement une crise. Pourtant, il me semble que votre poésie est moins une parole de connaissance qu’une parole d’espérance. Notre temps aurait-il davantage besoin d’espérance, et donc de charité, que de vérité ?
Avec la crise, tout l’avenir est à l’avenant ! Et par gros temps, il ne faut pas démâter l’espérance. La crise des illusions est si forte que l’espérance n’a pas bonne réputation. A cet égard, St Augustin mettait en garde en se méfiant de deux choses : le désespoir sans issue, l’espérance sans fondement. L’authentique espérance est le contraire de “ces illusions consolantes” dont parle Elias Canetti. Le contraire des anesthésiantes promesses électorales, de la méthode Coué, des faux-fuyants. Lucide, l’espérance n’est en rien l’optimisme béat. Elle est courage d’être, en dépit de tout. D’autant plus invincible qu’elle a la fragilité du cristal et qu’elle connait les larmes. En plaine nuit, l’espérance anticipe l’aube pour deviner la lumière qui vient…
Face à la désespérance postmoderne de l’Occident, un écrivain d’Haïti (pays pauvre entre tous les pauvres), Daniel Maximin s’insurge : “Tu écriras loin de tout désespoir, qui est le luxe des peuples nantis.”
Pouvez-vous nous parler de vos influences poétiques ? Quels sont les poètes que vous lisez et vous inspirent ?
J’éprouve toujours quelque perplexité à l’égard de ceux qui déclarent ne devoir rien à personne ou — plus fréquemment bien que moins péremptoires — ceux qui ne fréquentent pas la poésie. Pour ma part j’éprouve une grande gratitude envers mes pairs et m’avoue d’abord et avant tout “lecteur” ; secondairement et corollairement “auteur”, ayant toujours le crayon à la main…
Bien sûr, mes lectures buissonnières d’anthologies (celle de Seghers ou autres) m’avaient fait découvrir la poésie française de Villon et des troubadours jusqu’à Apollinaire en passant par Verlaine, Baudelaire. Mais c’est à l’âge de vingt ans que tout a commencé lorsqu’un ami me mit entre les mains les textes de René Guy Cadou et l’admirable essai à lui consacré de Michel Manoll dans la collection “Poètes d’aujourd’hui”. Ce fut une nuit blanche à la lanterne magique.
Bien plus qu’une simple réminiscence, cela reste, quarante ans après, l’expérience lumineuse et germinale à même de féconder ma quête, d’orienter mes lectures ultérieures : Milosz, Schéhadé, Reverdy, Follain, Malrieu, Novalis, Rilke… et surtout Supervielle dont la voix m’est si intérieure.
J’ajoute que seul me touche le chant profond étant comme l’émanation de l’être. Je vous fait grâce donc d’un fastidieux florilège de mes “délectures) (néologisme de Guy Goffette). Seulement que parmi mes correspondants : (Pierre Gabriel, Michel Manoll, Hélène Cadou, Anne Perrier, Jean-Pierre Lemaire, François Cheng) bien des pages me furent des “partitions” exemplaires. Je suis plutôt éclectique bien que j’aie — comme tout un chacun — mes répulsions et mes coups de coeur. Ainsi, depuis quelques années, ma pente va vers mes poètes “chambristes”, mélodistes, tels Gérard Le Gouic, Lionel Ray, Jean-Yves Masson… Le lyrisme d’intériorité apporte un surcroît de sens.
J’ajoute enfin qu’ “influence” ne doit pas rimer avec “dépendance”. Il s’agit de trouver “sa” voix, la sienne, unique.
Merci Gilles Baudry
- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024
- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021
- Revue des revues - 4 juillet 2021
- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018
- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018
- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018
- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017
- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017
- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017
- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016
- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016
- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016
- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016
- JAMES SACRÉ - 27 février 2016
- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016
- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016
- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015
- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015
- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015
- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015
- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015
- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015
- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015
- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015
- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015
- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014
- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014
- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014
- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014
- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014
- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014
- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014
- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014
- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014
- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014
- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014
- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014
- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014
- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014
- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014
- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014
- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014
- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014
- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014
- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014
- MARC ALYN - 22 février 2014
- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014
- Pierre Garnier - 1 février 2014
- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013
- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013
- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013
- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013
- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013
- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013
- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013
- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013
- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013
- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013
- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013
- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013
- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013
- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013
- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013
- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013
- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013
- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013
- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013
- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013
- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013
- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013
- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013
- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013
- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013
- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013
- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012
- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012
- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012
- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012
- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012
- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012
- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012
- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012
- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012
- Vers l’Autre - 5 juillet 2012
- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012
- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012
- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012
- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012
- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012
- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012
- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012