A l’occasion de la publication de son dernier ouvrage Venise, démons et merveilles (éditions Ecriture), Marc Alyn nous a accordé un entretien de fond sur la poésie.
***
Cher Marc Alyn, on ne devrait pas avoir à vous présenter : vous êtes né en 1937 à Reims, cité de sacre ; avez fondé la revue Terre de feu à 17 ans, avez obtenu le Prix Max Jacob à 20 ans, êtes mobilisé en 1957 en Algérie, collaborez au Figaro littéraire. En 1966, vous fondez la collection Poésie chez Flammarion, que vous dirigez, obtenez en 1973 le Prix Apollinaire, en 1994 le Grand Prix de poésie de l’Académie française, en 2007 le Prix Goncourt de la Poésie. Aujourd’hui, en 2014, comment définiriez-vous le poète et le poème ?
Le poète aujourd’hui, c’est l’abominable homme des marges, Orphée l’orphelin, le fugitif illuminé… Peu importe le nom qu’on lui prête puisque sa fonction consiste à s’effacer derrière le Poème, sentinelle oubliée quelque part au créneau de la Grande Muraille.
Autant de poètes, autant de conceptions de la poésie. Et celle-ci s’enrichit de chacune de ces approximations fugaces et contradictoires qui, loin de s’annuler, se complètent et dégagent de nouvelles perspectives à l’infini. Beaucoup voudront voir dans le poème un refuge, une île, une résidence secrète pareille au « cher grand fond Malampia » de la séquestrée de Poitiers: un ventre maternel où se retrouver en tête à tête avec sa propre voix. Pour d’autres, il s’agit d’un moyen de connaissance « entre le vide et l’événement pur ». Liberté à l’état sauvage qui choisit, s’il lui plaît, de s’imposer des chaînes prosodiques ou métaphysiques. Constitue-t-il la pointe extrême (oralité de l’origine, écriture éclatée, calcinée ou givrée du livre ultime) de toute culture, ou échappe-t-il à la littérature par son caractère unique d’expérience intérieure engageant la totalité de l’être ? Couteau à lames multiples susceptible de tailler les rosiers de Ronsard ou de forcer les serrures de l’absolu, le poème, vu du large, n’a ni commencement ni fin : c’est pourquoi il persiste dans son être, lampe allumée en plein midi, circulaire comme l’est le Temps, roue du Karma des Orientaux. Certaine phosphorescence émanant des vocables dénonce de loin la respiration poétique. Mais le poète, pour sa part, semble avoir fait vœu d’invisibilité : il revendique le privilège de ne rimer à rien dans l’un ou l’autre de ces « pays qui n’ont plus de légende » hantés de malentendants et de voyeurs aveugles. Le poème, dangereux et imprévisible à l’instar du Golem, attire la foudre plutôt que les grands tirages ; sa substance, matière première radioactive, exige d’être maniée avec vigilance. Prenons garde aux séductions apparentes du lyrisme; tout commence par un berger jouant de la flûte et s’achève par quelque sublime déflagration : Ezéchiel, Homère, Nietzsche, le grand coup de cymbale de Dante ! Et voici que se déploie maille à maille le Texte — la texture du monde : la phrase éternellement silencieuse et parlante faite du fil où circule le courant à haute tension de la divinité. Il faut octroyer un supplément de ciel à l’espace. Le langage distillé, filtré, décanté de nouveau, porté à des températures de magma central, puis, brusquement, soumis à des sous-degrés polaires, atteint le point extrême de la quête philosophale : la dissolution de l’alchimiste dans l’or immatériel: « Tu brûles ! », chuchote le Trésor.
- Que peut le Poème aujourd’hui, si jamais son rôle avait changé dans le monde ?
Le poème est événement dans le langage, aubaine heureuse semblable à l’éclosion/explosion du printemps lorsqu’il métamorphose de grises écorces en amandiers en fleurs. Le passant s’émerveille ou poursuit son chemin sans sourciller. Qu’importe ! Le rôle du poète consiste à ne jamais laisser le verbe en repos : il lui faut sans cesse remuer la pâte, l’aérer, lui conférer de nouvelles propriétés, d’autres formes, mêler profondeur et surface en vue de réconcilier la circonférence et le centre. L’œuvre exige de reposer sur des fondations puissantes, destinées cependant à rester invisibles.
N’oublions jamais que toute architecture est piège, chaque poème, l’entrée d’un labyrinthe. Que trouverons-nous à l’intérieur ? Dieu, le Néant, le Minotaure ? Certains textes ne renvoient qu’à eux-mêmes, d’autres reflètent les facettes ambiguës de mondes parallèles; de rares aventuriers mystiques inventent des chemins vers une réalité dissimulée sous le sens apparent. A chacun sa ligne de chant, de chance. Peut-être le poème pourrait-il aider l’homme contemporain à se recentrer sur lui-même, à regagner les territoires perdus d’une individualité menacée de désintégration au sein de la pensée unique ? Osons les longs silences illuminés par la lampe de la méditation gratuite. Les mots possèdent des antennes, et les morts des oreilles. Tout rêve ouvre à double battant sur des songes plus spacieux, eux-mêmes en cheville avec des étagements de gouffres formidables. Les cercles concentriques de l’image s’élargissent vers les confins étoilés du poème irrévocable. « Juste de voix », telle était la louange suprême dans l’Egypte des Pharaons. La grande affaire, en attendant, consiste pour chacun à trouver, à force de tâtonnements, le bouton de la minuterie, quelque part dans le parking obscur qui nous tient lieu de demeure.
- Après une reconnaissance précoce, vous quittez Paris et par moments la France afin de ne pas entrer dans les travers de la reconnaissance bourgeoise ; c’est le début d’une aventure spirituelle en Orient …
Pourquoi ai-je arpenté, scribe errant sans bagages, les routes et sentiers de l’Orient solaire et ténébreux — lieu de toutes les genèses, annonciades et épiphanies — sinon parce que j’avais rendez-vous là-bas, depuis l’enfance, avec moi-même ? « Je vais en Orient comme on va aux fontaines / boire après tant de soifs la seule eau souveraine », ai-je affirmé dans Le Livre des amants, imprimé en 1988 dans une cave de Beyrouth alors dévastée par les bombardements. Dehors, passé le crépuscule, les mandarines, petits soleils, luisaient doucement au bout des branches; à l’intérieur des immeubles régnait une pénombre d’église byzantine. Entre deux rafales, le rossignol reprenait ses trilles — tandis que Nohad, mon Isis sans fin perdue et retrouvée, me chuchotait des oracles à l’oreille. Souvent, au point du jour, je tissais, métissais, entretissais les vocables d’un poème, que je tapais, d’un doigt, sur une portative orange. « J’étais au bout du monde et tout au bout de moi » à l’issue de ces nuits féroces où j’écoutais les bruits de la rue, car la vie, contre toute attente, reprenait son cours : « Vitrier, vitrier ! » Certaine difficulté à naître m’avait de tout temps tourmenté. Au moindre mouvement, je me heurtais aux soubassements de l’énigme, tenaillé par la tentation de me laisser couler à pic dans les abysses d’un mot pris au hasard. Perdu comme un objet qui s’enfonce, retourne à la matière et ne peut pas crier, je cherchais obstinément l’autre côté des choses ; ainsi le chat trompe son image en se faufilant derrière le miroir. De Babel à Baalbek, j’avais traîné mon ombre sur les ruines d’empires disparus depuis des millénaires, et je me retrouvais au milieu d’autres gravats, encore brûlants. Sans cesse me revenait la leçon de Byblos dont s’élaborait en moi l’opéra…
- A Byblos, vous vivez une expérience fondamentale, donnant naissance à votre chef‑d’œuvre Les Alphabets du Feu. Pouvez-vous nous parler de cette « minute magique » ?
A Byblos, la mer et la mort se font face, se toisent dans une odeur d’algues, de thym et de voiles mouillées. Quelques colonnes, des escaliers ne menant nulle part, des rampes, des terrasses dominent le site encombré de débris de monuments. Bombardée à bout portant par le Temps depuis des millénaires, la cité-royaume n’est plus qu’une carrière à ciel ouvert veillée par un château-fort datant des croisades. Rien de spectaculaire comme à Baalbek : des éboulis, des blocs, des dalles grises sur la colline surplombant le verset toujours en mouvement de la mer. La voûte céleste pèse sur les cyprès. Ici, le soleil domine sans partage, cœur immense qui bat au même rythme que celui de l’homme, mais lui survit.
Tandis que je pénètre pour la première fois dans le cercle magique de la ville qui donna son nom au Livre, je ressens la présence autour de moi du langage intimement mêlé au génie du lieu. Si la stèle où figure la Dame de Byblos, Baalat, regarde désormais filer les trains à la station de métro Louvre, au centre de Paris, on devine que le sous-sol du petit port phénicien regorge de textes non exhumés qui se lisent entre eux dans l’obscurité parmi des conciles de racines. Du haut de l’horizon, le soleil se déverse, or en fusion, dans les anfractuosités du terrain. Un faucon pèlerin vole à la verticale des vestiges, emportant une proie où je reconnais bientôt un serpent qui s’agite et semble tracer d’étranges signes dans l’azur. Quel appel d’air ! Je me tiens au bord du vide, somnambule sur la pente du toit. Une cohorte de fourmis émerge de la fente d’une dalle protégeant la sépulture d’une épouse royale — et cette procession évoque le noir enchaînement des signes typographiques subjuguant la blancheur de la page — l’Alphabet !
L’instant dure, et fulgure. Les plateaux de la balance romaine du soleil s’équilibrent: c’est midi. « L’éternité ne fait pas son âge » aujourd’hui ; on dirait qu’elle se dégèle, laisse tomber le masque et esquisse un sourire. L’envers, l’endroit, l’avant, l’après s’unissent en un présent qui ne laisse rien dans l’ombre. Ici prend fin la Chute à travers les siècles des siècles, plancher pourri. Demain, peut-être, la lumière inventera l’œil, donnant naissance à l’homme ascensionnel… De cette immersion initiatique jailliront, autour du recueil fondateur Byblos (acte de résurrection), La Parole planète (phase de conquête) et Le Scribe errant où le poète parcourt les territoires enchevêtrés du visible et de l’invisible, dénombrant les vaisseaux, les points d’eau, les prodiges. Cette trilogie, publiée entre 1991 et 1993, portera le titre général Les Alphabets du Feu.
- Pouvez-vous évoquer la notion d’urgence poétique ?
La gestation d’un poème peut s’étendre sur des années : quand l’heure sonne rien ne saurait s’opposer à son surgissement. Chaque image doit reposer longuement au fond de la nappe du verbe afin qu’elle puisse fuser le moment venu dans sa fraîcheur originelle — j’allais dire : natale. Cette coexistence du retrait et de l’élan, de l’immobile et du mouvant pourrait surprendre: elle acquiert tout son sens dès qu’on la situe dans le cadre plus vaste d’une poétique des contraires réconciliés.
L’urgence, bien sûr, s’impose également en fonction de la pression du temps. A plusieurs reprises, notamment au cours des années 90, lorsque j’achevais Le Scribe errant sur un lit d’hôpital, quelque événement dramatique peut substituer son tempo au rythme personnel de l’auteur détourné de son cours. La partie intitulée Voix off, dans L’Etat naissant, permet une approche directe (rare chez moi) de ce phénomène : la vie, la voix, étroitement liées, s’affrontent en un duel farouche au bord de l’abîme : « Le poète égorgé veillé par son poème ». Par la suite, il me sera donné de subir l’épreuve indicible de la perte de la voix. Pendant quatre années (suite à l’opération d’un cancer), je ne communique que par écrit — ce qui me fournit l’occasion d’une réflexion fondamentale sur les rapports de la parole proférée et de l’écriture, le lien entre oralité et graphie et, de façon plus générale, sur le silence considéré comme élément moteur de l’expression poétique. A qui serait curieux de connaître l’autre versant de cette confrontation, je suggère la lecture du long poème de Nohad Salameh Le Bout du tunnel (dans son recueil Les Lieux visiteurs) : éloge de la lutte quotidienne pour la survie s’achevant par une note d’espérance — car le pire n’est pas toujours sûr.
L’urgence, au bout du compte, se manifeste également à certains moments d’accélération de la clepsydre et du calendrier, lorsque l’on prend conscience du rétrécissement de l’horizon perpétré par l’âge. Ainsi me suis-je parfois exprimé sous une forme aphoristique (Le Silentiaire, Le Dieu de sable) afin de rassembler en un éclair tout un faisceau de perspectives et de méditations de longue haleine.
Le 18 mars 2014, j’aborderai le cap des 77 ans : soixante années de poésie, donc, si l’on veut bien se souvenir que j’ai fait paraître mon recueil inaugural (Le Chemin de la Parole) à 17 ans. Faut-il se contenter d’exalter le « dur désir de durer » ? Je préfère, pour ma part, saluer les créateurs tenaces comme Claude Monet, lequel commença à peindre ses Nymphéas à l’âge de 75 ans. S’il est vrai que le monde se partage entre les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer, les artistes, eux, appartiennent à cette dernière famille. Au bar de l’hôtel de l’Univers, tandis que les voiliers du port rongent leurs amarres, les poètes trinquent fraternellement à la santé du large.
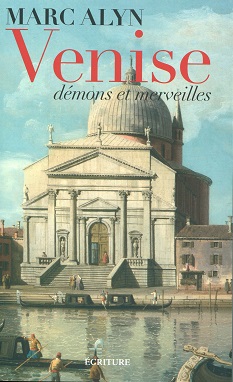
- Vous venez de faire paraître un essai intitulé Venise, démons et merveilles aux éditions Ecriture. Ce livre érudit aborde la Sérénissime par une lecture initiatique des œuvres secrètes. Vous y parlez des anges, des monuments, de Mélusine, établissez des rapports avec les cartes du Tarot, dressez les portraits de Giordano Bruno, de Galilée, de peintres de génie tels Tintoret, Titien, Carpaccio, Véronèse, Bellini, Lotto, entrez dans les arcanes de la Kabbale… Nous sommes ici au cœur du déploiement artistique et miraculeux du Poème. Quelle nécessité a commandé ce livre en vous ?
Venise, démons et merveilles est le second ouvrage que je consacre à la Sérénissime. Le premier, Le Piéton de Venise (Bartillat, 2005 et 2010 en livre de poche), suggérait déjà l’existence d’une cité invisible de caractère magique derrière le décor flamboyant dont rêvent les touristes. Ce nouvel essai, qui embrasse non seulement la ville mais aussi la lagune et la Vénétie, propose une plongée initiatique dans le Grand Canal à la recherche des bijoux perdus de la Connaissance :
Là, un fond sans fond.
Echec et Mat :
temps, formes et lieu !
(Maître Eckart)
Les jardins secrets de Venise débordent de rosiers alchimiques nés du désir de l’absolu ; artistes, poètes et kabbalistes n’hésitent pas à jeter leur vie dans la balance pour accélérer la floraison philosophale : « A cause de cette rose, le verger entier sera épargné », promettent les Sages du Ghetto cultivant la Thora. Ce périple dans l’espace se double d’une flânerie à l’intérieur du temps, le moindre pont gardant trace du passage d’étonnants voyageurs aujourd’hui disparus et que signale pourtant quelque luminescence du côté du casino des Esprits.
Que cherchons-nous à ce poste-frontière par où s’infiltrent les fantômes, sinon la révélation d’un charme (carmen), un parfum partout ailleurs évaporé et qui subsiste au fond de ce flacon ouvragé à Byzance ? Le vent marin venu d’Orient souffle sur ces effluves, salubre, triomphal, conviant à l’aventure amoureuse ou métaphysique. La jeunesse, depuis Giorgione et Byron, Mozart et Brodsky, fait la planche sur Venise poisson phosphorescent. Certains viennent y apprendre à vivre, d’autres à disparaître ; quelques-uns y découvrent le cœur calciné de l’amour tandis que leurs voisins, frôlés aux carrefours, prennent tragiquement conscience des limites de l’autre : « Presque nous — et à la fin personne. » Quoi de plus grisant que cette progression en apesanteur sur les dalles lisses des ruelles quand le piéton semble accéder à la lévitation, pareil au fumeur de joint immobile sur sa natte ? Cette ambiance de liesse prélude à toutes sortes d’ébriétés d’un ordre plus élevé. « Venise, décrète Malraux, est au service du poème. » Au fond de chaque église ou palais, l’art est embusqué, prêt à fondre sur sa proie, pendant que se mêlent sur les quais personnages évadés des tableaux et couples on ne peut plus vivants s’avançant enlacés vers l’embarcadère du vaporetto et de Cythère.
- Venise, sous votre regard, est la cristallisation ou l’aimantation du génie occidental. Est-ce aujourd’hui la dernière cité gardienne de la mémoire ancienne ?
« La Treizième revient — c’est encor la première », constate Nerval qui ne connut pas Venise, mais la chercha obscurément : parole dissimulée dans l’épaisseur d’un palimpseste recouvrant à son tour d’insondables alphabets. La ville toute entière est un texte crypté par les kabbalistes invisibles aux yeux desquels « chaque phrase sortie de la bouche du Tout-puissant se divise en soixante-dix langages » (Talmud). Babel n’est jamais loin en cette métropole où le Verbe devient image et l’image couleur sans cesser d’être musique. La Dominante dispose d’un équipement magique à toute épreuve créant autour d’elle un champ magnétique protecteur. Quelque chose de la pensée gnostique a survécu ici, en ce point où l’Orient et l’Occident se rejoignent et s’étreignent — noces célestes pareilles à celles qui unirent Simon le Mage (le soleil) et Hélène (la lune), incarnation d’Ennoia, la Pensée. Hermès, l’Eveillé, se confond, au terme de transfigurations fantastiques, avec saint Marc/Mercure, l’enchanteur Merlin, Orphée et Mithra, dieu solaire vêtu de bleu et de rouge (tenue du Bateleur, lame première du Tarot) immolant le taureau, image de l’énergie sexuelle, en présence des divinités voyeuses. « Heureux qui possède, parmi les hommes, la vision de ces mystères », scandait Pythagore, dont le nom signifie : « porte-parole de la Pythie. » Le plan labyrinthique de la cité des Doges passe pour reproduire le « château en spirale » de l’illumination ou encore cette mythique « ville de Troie » où le roi solaire réside après sa mort, et dont il revient ayant subi d’indicibles épreuves… Ainsi, tous les symboles de l’imaginaire poétique se concentrent ici, se ressemblent, s’assemblent autour de la huppe et du Phénix, oiseaux cosmogoniques détecteurs de trésors. Nulle part ailleurs on ne verra cohabiter, mêlés à l’existence quotidienne la plus enjouée, tant de signes d’une proximité palpable de l’Enigme. Les arbres engloutis sous l’eau de la lagune, qui servent de piliers à Venise, se confondent avec les chênes de la forêt de Brocéliande où l’Enchanteur ne dort que d’un œil.
- Cher Marc Alyn, ma dernière question consiste à vous laisser le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c’est peut-être qu’il n’existe pas de fin, que tout est à refaire continuellement par de nouveaux venus dépourvus de mémoire, édifiant leurs châteaux de sable sans un regard pour la marée montante. Nous savons que la vie est une passade, une glissade plus ou moins réussie sur la glace trop mince. Le temps de dire : « Je suis », un autre occupe la place et achève la ligne, lui-même bientôt remplacé par l’intermittent de service. Mais l’essentiel n’est-il pas d’avoir bravé les interdits et les terreurs afin de s’élever par les surplombs piégés de neige fraîche et de couloirs d’avalanche, jusqu’ aux grands à‑pics sauvages d’où l’on peut entrevoir en toute majesté le Soleil, derviche tourneur ?
L’activité poétique possède une valeur sans rapport avec son retentissement dans le siècle : elle constitue un événement spirituel d’une portée cosmique, phénomène qui ne gagnerait rien à être élucidé, mais dont on peut suggérer en un éclair la nature : l’altitude et la profondeur atteintes d’un seul bond. A quoi rêvent les routes, sinon de voyager pour leur propre compte ? Le poème, en définitive, m’apparaît comme une barque détachée de la rive, et qui plonge imperceptiblement avant d’épouser le fil du courant.
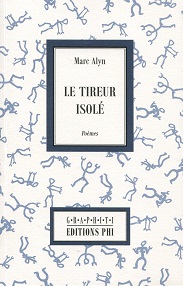
- ZÉNO BIANU : Rencontre avec Gwen Garnier Duguy - 7 juillet 2024
- L’honneur des poètes - 5 juillet 2021
- Revue des revues - 4 juillet 2021
- Marc ALYN, Le temps est un faucon qui plonge - 5 mai 2018
- Xavier Bordes : la conjuration du mensonge - 1 mars 2018
- Entretien avec Nohad Salameh - 1 mars 2018
- Rencontre avec Richard Millet - 8 novembre 2017
- RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE - 2 septembre 2017
- Jean-Louis VALLAS - 31 mars 2017
- Elie-Charles Flamand, La vigilance domine les hauteurs - 28 juillet 2016
- Elie-Charles Flamand - 21 juillet 2016
- Munesu Mabika De Cugnac : Un monde plus fort que le reste - 31 mai 2016
- ZÉNO BIANU - 29 mars 2016
- JAMES SACRÉ - 27 février 2016
- Avec Claire BARRÉ pour son roman ” Phrères” - 8 février 2016
- La collection poésie/Gallimard fête ses 50 ans : rencontre avec André VELTER - 3 janvier 2016
- André Velter/Ernest Pignon-Ernest, Pour l’amour de l’amour - 21 novembre 2015
- Conversation avec Xavier BORDES - 8 septembre 2015
- THAUMA, n°12, La Terre - 14 juillet 2015
- Jean Maison, Presque l’oubli - 5 juillet 2015
- Paul Pugnaud, Sur les routes du vent - 10 mai 2015
- JEAN-FRANÇOIS MATHÉ - 28 février 2015
- Juan Gelman, Vers le sud - 20 février 2015
- CHRISTOPHE DAUPHIN - 1 février 2015
- Claude Michel Cluny - 11 janvier 2015
- MARC DUGARDIN - 13 décembre 2014
- A‑M Lemnaru, Arcanes - 6 décembre 2014
- Maram al-Masri, L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre - 30 novembre 2014
- Revue Les Hommes sans Epaules, n°38 - 1 novembre 2014
- Onzième n° de la revue THAUMA - 19 octobre 2014
- François Angot, A l’étale - 13 octobre 2014
- Si loin le rivage,d’Eva-Maria Berg - 14 septembre 2014
- Sur deux livres récents de Jigmé Thrinlé Gyatso - 7 septembre 2014
- Saraswati, revue de poésie, d’art et de réflexion, n°13 - 7 septembre 2014
- JEAN MAISON 2ème partie - 28 août 2014
- Nunc n° 33 : sur Joë Bousquet - 25 août 2014
- PHILIPPE DELAVEAU - 13 juillet 2014
- Le prix Charles Vildrac 2014 remis à notre ami et collaborateur le poète Jean Maison pour son recueil Le boulier cosmique (éditions Ad Solem) Extraits - 16 juin 2014
- Rencontre avec Nohad Salameh - 13 juin 2014
- Jean-François Mathé, La vie atteinte - 8 juin 2014
- PASCAL BOULANGER - 18 mai 2014
- Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines - 21 avril 2014
- Paul Verlaine, Cellulairement - 7 avril 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (10) Arnaud Bourven - 6 avril 2014
- La vie lointaine de Jean Maison - 30 mars 2014
- L’Heure présente, Yves Bonnefoy - 23 mars 2014
- MARC ALYN - 22 février 2014
- BERNARD MAZO — AOÛT 2010 - 12 février 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (6) Pascal Boulanger - 8 février 2014
- Pierre Garnier - 1 février 2014
- Une nouvelle maison d’édition : Le Bateau Fantôme - 30 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (5) Gérard Bocholier - 26 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (4) : Alain Santacreu - 12 janvier 2014
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (3) : Jean-François Mathé - 30 décembre 2013
- JEAN-LUC MAXENCE - 29 décembre 2013
- Rencontre avec Gilles Baudry - 30 novembre 2013
- A L’Index, n°24 - 25 novembre 2013
- Jean-Pierre Lemaire - 1 novembre 2013
- Regards sur la poésie française contemporaine des profondeurs (1) - 23 octobre 2013
- Le dernier mot cependant de Jean-Pierre Védrines - 16 octobre 2013
- Mille grues de papier, de Chantal Dupuy-Dunier - 9 octobre 2013
- Rencontre avec Balthus de Matthieu Gosztola - 29 septembre 2013
- Demeure le veilleur de Gilles Baudry - 25 septembre 2013
- EUGENIO DE SIGNORIBUS - 25 août 2013
- Dans la poigne du vent, de F.X Maigre - 16 juillet 2013
- L’extrême-occidentale de Ghérasim Luca - 8 juillet 2013
- Au commencement des douleurs, de Pascal Boulanger - 22 juin 2013
- Le 23e numéro de A l’Index - 20 mai 2013
- James Longenbach, Résistance à la poésie - 10 mai 2013
- Jean Grosjean, Une voix, un regard - 19 avril 2013
- Etienne Orsini, “Gravure sur braise” - 5 avril 2013
- Paroles à tous les vents, Boulic - 22 mars 2013
- Gérard Bocholier, ses deux derniers recueils - 15 mars 2013
- Jean-Pierre Lemaire, Faire place - 8 mars 2013
- Ariane Dreyfus, par Matthieu Gosztola - 2 mars 2013
- Marc Delouze, “14975 jours entre” - 24 février 2013
- Mangú : Le sens de l’épopée - 23 février 2013
- Les poèmes choisis de Paul Pugnaud - 9 février 2013
- Faites entrer l’Infini, n°54 - 2 février 2013
- Au coeur de la Roya - 19 janvier 2013
- Entretien avec Jean-Charles Vegliante - 24 novembre 2012
- Un regard sur Recours au Poème - 3 novembre 2012
- Pierrick de Chermont, “Portes de l’anonymat” - 7 octobre 2012
- Denis Emorine, “De toute éternité” - 6 octobre 2012
- Hommage à Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu n°30 - 6 août 2012
- POESIEDirecte n°19, le désir - 2 août 2012
- Marc Baron, Ma page blanche mon amour - 1 août 2012
- Bernard Grasset, Au temps du mystère… - 1 août 2012
- Totems aux yeux de rasoir - 19 juillet 2012
- Vers l’Autre - 5 juillet 2012
- Jean-Pierre Boulic - 2 juillet 2012
- Jean-Luc Wauthier - 2 juillet 2012
- Le bleu de Max Alhau - 30 juin 2012
- Jean Maison, Araire - 21 juin 2012
- Rencontre Jean MAISON [1ère partie] - 13 juin 2012
- Patrice de La Tour du Pin, le poète de la Joie - 18 mai 2012
- Rencontre avec Iris Cushing - 5 avril 2012
















