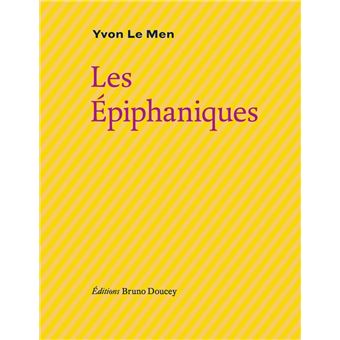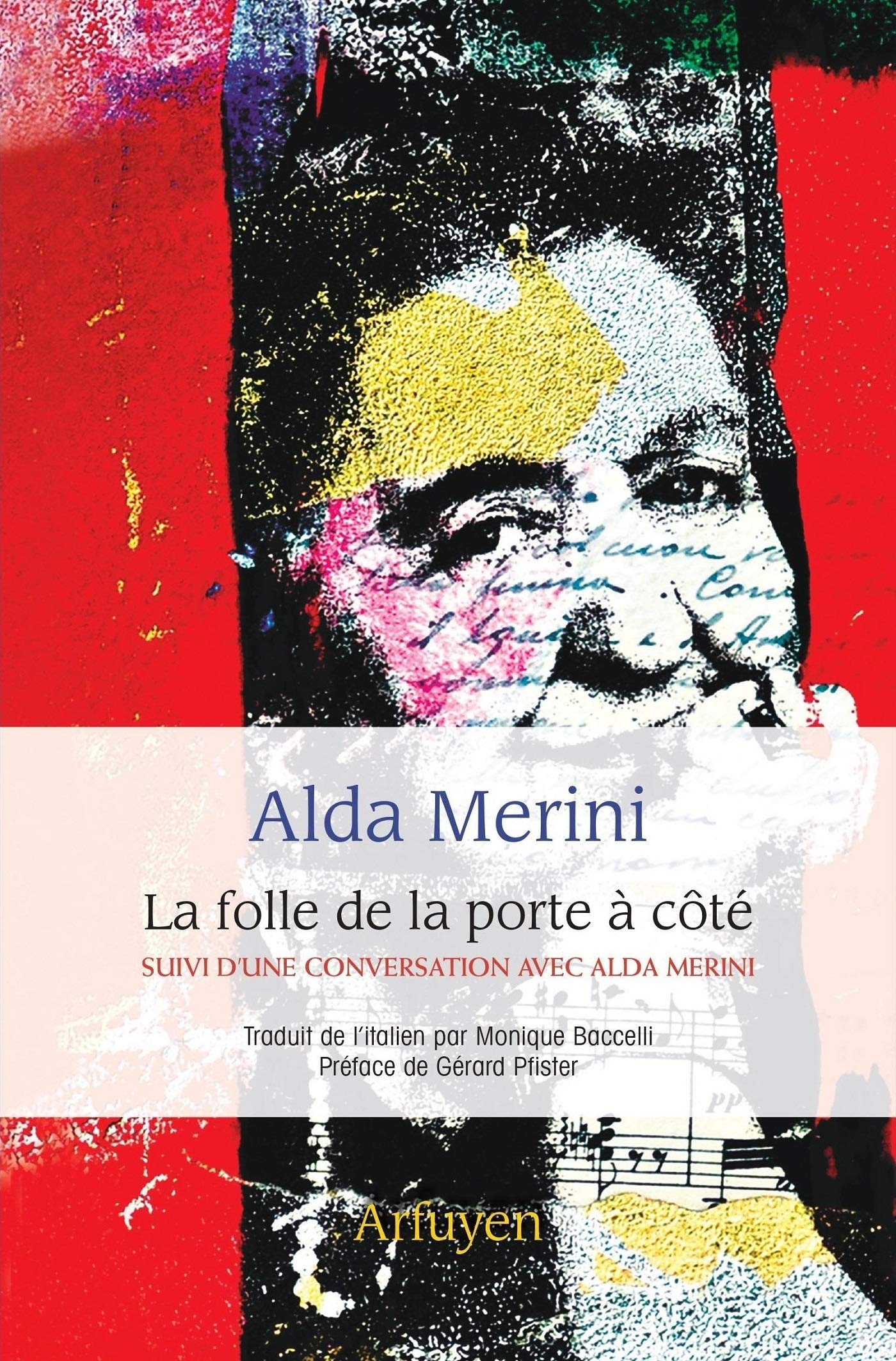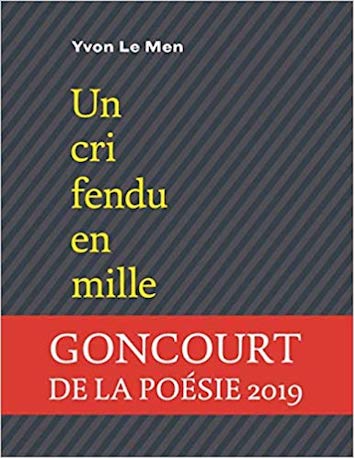Rezâ Sâdeghpour : « Le bris lent des bouteilles »
Il est Iranien. Il a trente-quatre ans et il est déjà reconnu dans son pays comme un très grand poète. Rezâ Sâdeghpour – avocat dans le civil, à Ispahan – a obtenu en 2015 le « Prix du recueil de l’année » décerné lors du Festival de la poésie persane contemporaine pour son livre Le bris lent des bouteilles. Ce livre est aujourd’hui publié en France dans une édition bilingue.
Avec Rezâ Sâdeghpour il ne faut pas s’attendre à des grandes envolées lyriques ou mystiques. Non, nous sommes ici dans le minimalisme, ce qui n’empêche pas que cette poésie soit riche de sens et garde des accointances avec la poésie classique iranienne.
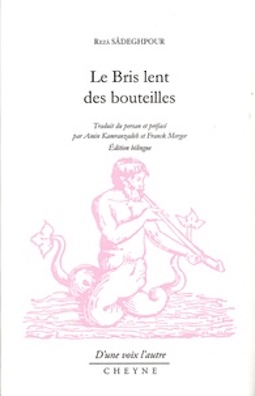
Rezâ Sâdeghpour,Le bris lent des bouteilles, traduit du persan et préfacé par Amin Kamranzadeh et Franck Merger, éditions Cheyne, collection D’une voix l’autre, édition bilingue, 110 pages, 22 euros.
Le jeune auteur a été marqué, comme tous les poètes de son pays, par l’écriture de Hafez (1320–1389) et aussi d’Omar Khayyam (1050–1123). Mais Sâdeghpour aborde la poésie dans une autre « posture » que ses illustres prédécesseurs. Il est sans doute plus proche des banalités de la vie quotidienne et élabore une autre architecture des poèmes avec des mots comme empilés les uns sur les autres. Plus fondamentalement, « l’ambiguïté est le maître-mot de la poésie de Rezâ Sâdeghpour, qui compare sa poésie à un lac calme et limpide où viendraient se mêler les eaux noires de rivières agitées », note ses deux préfaciers.
Les poèmes – au nombre de 46 dans ce livre – sont brefs. Une dizaine, une quinzaine de mots. Souvent pas plus que dans un haïku, un genre poétique auquel on pense volontiers quand on lit certains de ses courts textes. « Cerisiers en fleurs/moineaux joyeux/une ligne blanche/fait du ciel deux moitiés,/mes dents/hélas/cette année/noircissent ».
Il faut dire que, pour ce qui est de la concision et de l’art de saisir la banalité des jours, Sâdeghpour a de qui tenir. Avant lui, Sohrab Sepehri (1928–1980) avait, dans L’Orient de la tristesse, repris l’atmosphère si particulière du haïku japonais (« Une ride plie la face d’un étang/Une pomme roule sur la terre/Un pas s’arrête, la cigale chante »). Plus récemment, Abbas Kiarostami (1940 – 2016) avait carrément fait le choix d’écrire des haïkus persans tels qu’on les découvre notamment dans ses deux livres Avec le vent (P.O.L.) et Un loup aux aguets (La Table ronde). Lisant Le bris lent des bouteilles, comment ne pas penser à ces quelques vers du cinéaste-poète. « Une bouteille cassée/déborde/ de pluie de printemps ».
On retrouve donc chez Sâdeghpour ce détachement propre au haïku et cette sensibilité au passage des saisons : « cette année l’automne/a duré quatre mois: /les feuilles du figuier/ne tombaient pas ». Et cette attention soutenue à ce qui nous entoure : « Il interrompt sa prière/pour faire boire un oiseau/dans le creux de sa main…»
Mais contrairement aux grands maîtres japonais du genre, il y a dans ce livre une forte dose d’amertume. Si l’on devient poète à cause d’une femme que l’on a perdue (comme dirait Stendhal), alors on peut faire ici le constat de la perte et du manque. C’est ce qui signe fondamentalement ce recueil. « L’amoureux/ connaît ce sort: /une cigarette/à ses lèvres attristées/et des sanglots/tels des trémolos », écrit le poète. Ou encore ceci : « les photos au-dessus du lit/les narcisses dans le vase/les bougies/peuvent témoigner/que personne n’était là/pas même moi/à l’heure/où tu n’es pas venue ».
Yvon Le Men : « Un cri fendu en mille »
Yvon le Men publie le 3e tome de son autobiographie poétique. Après l’enfance et le terroir familial (tome 1 : Une île en terre), après la découverte du monde par la littérature et la peinture (tome 2 : Le poids d’un nuage), voici les carnets de voyage du poète breton sous le titre Un cri fendu en mille. Titre sans doute inspiré par les mots du poète ami Claude Vigée cités en exergue : « L’homme nait grâce au cri ».
On sait d’Yvon Le Men qu’il est un « étonnant voyageur ». Pas seulement parce qu’il anime, chaque année à Saint-Malo, des rencontres poétiques au salon du livre du même nom. Pas seulement parce qu’il convie des poètes du monde entier au Carré magique dans sa bonne ville de Lannion. Non, il est surtout cet étonnant voyageur parce qu’il a toujours eu l’humeur vagabonde. Auteur d’un Tour du monde en 80 poèmes (Flammarion), livre où il rassemblait, pays par pays, ses auteurs favoris, il est lui-même allé à la rencontre du monde, bourlinguant de la Chine au Brésil en passant par l’Afrique et l’Europe. Pas pour nous décrire des paysages ou évoquer la nature mais pour parler, d’abord et avant tout, des rencontres qu’il a faites.

Yvon Le Men, Un cri fendu en mille (Les continents sont des radeaux perdus, 3) , éditions Bruno Doucey, 157 pages, 16 euros.
« Le métier de poète/n’est-il pas de vérifier le sens des mots ? », note Yvon Le Men qui part sans préjugés, avec un esprit d’ouverture teinté de compassion quand le drame et la folie des hommes viennent broyer des vies à Gaza, à Haïti, en Bosnie, au Liban et dans tant d’autres pays. « Il faut du silence/autour des morts/pour entendre leur vie ».
Citoyen du monde, il n’évacue pas pour autant les différences. « Toutes elles sont noires/je suis tout blanc/sauf une trop blanche parmi les noires », constate-t-il dans une école de Port-au prince. Parlant plus loin de son ami haïtien Bonel Auguste, il écrit : « Il ne vivrait pas dans mon pays/je ne vivrais pas dans le sien//trop silencieux pour lui/trop de trop pour moi//même si nous sommes frères/fils du même père/sur la même terre//malgré l’océan/le ciel/la moitié d’un globe/qui nous sépare ».
Tout le Men est là dans ce type d’affirmation. Dans le fond et dans la forme. Cette manière à lui de faire surgir les mots entre les blancs. De leur donner du poids, en poète qu’il est et dont il revendique le statut. « Dans l’avion, mon voisin m’avoue son métier. Policier en chef. Poète, je réponds. Il se rend à un congrès international contre le terrorisme et je vais rendre hommage à un ami dont les vers sont encore sur les lèvres des habitants de Sarajevo. Il y a trois ans, Izet Sarajilic mourait. De chagrin, mais en chantant, malgré les récents massacres ».
Marc Baron : « Ô ma vie »
Marc Baron écrit pour les enfants et pour les « grands enfants » que nous pouvons devenir en lisant des poèmes. Ô ma vie, son dernier recueil, est destiné à tout le monde. L’auteur nous parle – à mots feutrés – de sa vie. Et donc aussi de la nôtre.
Comment ne pas être saisi par les premiers vers de ce recueil : « Ô ma vie/tu m’en fais voir/de toutes les couleurs//La mort de mon père/et l’oiseau dans la boue ». Exercice de dédoublement. Le poète s’adresse à sa vie comme à quelqu’un à la fois d’extérieur et d’intime. Il lui parle comme à un compagnon de fortune et d’infortune. « Ô ma vie/tu m’en fais voir/de toutes les couleurs (…) moi le daltonien dont on se moque/lorsque je cueille une pomme verte ».

Marc Baron, Ô ma vie, avec des dessins de Frédéric Coyère, éditions La rumeur libre, 47 pages, 14 euros.
Marc Baron ne durcit jamais le trait mais il sait nous dire qu’il a « des bleus partout » et qu’il fuit « la bêtise humaine ». Aussi appelle-t-il volontiers au sursaut. « Ô ma vie révolte-toi toujours/n’accepte plus bonimenteurs/ni compromis ». Mais comment faire face quand la vie vous bouscule ainsi, quand le sang coule « pour une broutille ou pour la guerre » ? Le poète part sur sa « voie verte » et « tire allègrement un wagon de poèmes ». Pour s’aérer l’esprit et carrément pour survivre, il fait aussi beaucoup de « pompes ». Soulevant des haltères, il peut soulever sa « rage ». Et en musclant ses « deltoïdes », il muscle son cerveau.
Marc Baron ne nous propose pas pour autant un traité de bien-être ou de résilience. Ses poèmes ne fredonnent pas les airs à la mode. Ils creusent le sens de nos existences au-delà des traités de sagesse que l’on voit fleurir dans les devantures. « Ô ma vie, ma bien vivante/et mon étoile morte quand je m’éteins/pour un oui ou pour un non ». Son livre est un hymne à cette vie qu’il chérit au fond. Mais sans illusion ni concession. « Pas d’amour qui ne fasse mal// Pas de moisson sans guérison ». Le poète lit Rimbaud ou se met au piano, accueille le jour comme il le faisait enfant quand le soleil du matin inondait son lit.
Marc Baron a créé le salon du livre jeunesse de Fougères. Il n’a pas quitté sa jeunesse, son enfance. Et fait d’ailleurs cet aveu : « Ô ma vie/je ne fais pas mon âge ».
- Lucie Grall, C’est toi qui mènes la danse - 6 mai 2025
- Rainer Maria Rilke, Lettres à une jeune femme - 6 mai 2025
- Eve Lerner, Un tant soit peu de lumière - 5 février 2025
- Jean-Yves André, Jacques Poullaouec, Femmes de pierre - 6 janvier 2025
- Jacques Josse, Trop épris de solitude - 21 décembre 2024
- Le 30e numéro de Spered Gouez, L’esprit sauvage - 6 novembre 2024
- Antonia Pozzi, Un fabuleux silence - 6 septembre 2024
- Jean-Pierre Boulic, Quelques miettes tombées du poème - 6 mai 2024
- Joseph-Antoine D’Ornano, Instantanés sereins - 1 mars 2024
- Cécile A. Holdban, Premières à éclairer la nuit - 6 février 2024
- Estelle Fenzy, Une saison fragile - 6 janvier 2024
- Maurice Chappaz, Philippe Jaccottet : Correspondance, 1946–2009 - 21 décembre 2023
- Marina Tsvetaïeva, Après la Russie - 6 décembre 2023
- Hélène Dorion, Mes forêts - 29 octobre 2023
- Cécile A.Holdban, Toutes ces choses qui font craquer la nuit - 22 septembre 2023
- Colette Wittorski, Ephéméride - 6 septembre 2023
- Jean-Claude Coiffard, Le ciel était immense - 21 juin 2023
- Cécile A. Holdban, Kaléidoscope, Tapis de chiffons - 6 juin 2023
- Claude Serreau, Réviser pour après - 20 mai 2023
- Philippe Jaccottet, La promenade sous les arbres - 29 avril 2023
- Gérard Bessière, De lumière et de vent - 20 avril 2023
- Chantal Couliou, Instants nomades - 6 avril 2023
- Paul Verlaine, Nos Ardennes - 19 mars 2023
- Michel Dugué, Veille - 1 mars 2023
- Marie de la Tour et Taxis, Souvenirs sur Rainer Maria Rilke - 21 février 2023
- Haïkus : Du bleu en tête - 5 février 2023
- Marie-Josée Christien et Yann Champeau, Marais secrets - 24 janvier 2023
- Yvon Le Men, prix Paul-Verlaine - 29 décembre 2022
- Gustave Roud, Œuvres complètes - 29 décembre 2022
- Liza Kerivel, Nos - 21 décembre 2022
- Cypris Kophidès, La nuit traversière - 4 décembre 2022
- Alain Vircondelet : Des choses qui ne font que passer - 18 novembre 2022
- Benoît Reiss, Un dédale de ciels - 6 octobre 2022
- Anne-Lise Blanchard, L’horizon patient - 22 septembre 2022
- Le haïku face au changement climatique - 1 juillet 2022
- Carles Diaz : L’arbre face au monde - 19 juin 2022
- Alain Vircondelet, Des choses qui ne font que passer - 20 mai 2022
- Olivier Cousin, La vie à l’envers - 3 mai 2022
- Yvon Le Men, Les Epiphaniques - 20 avril 2022
- Jean-Claude Albert Coiffard, Il y aura un chant - 5 avril 2022
- John Keats : La poésie de la terre ne meurt jamais - 21 février 2022
- Jean Lavoué, Carnets de l’enfance des arbres - 21 janvier 2022
- Claude Serreau, Résurgence ou les parenthèses du soir - 28 décembre 2021
- Stefan Zweig, La Vie d’un poète - 21 décembre 2021
- Christine Guénanten, Féerique fougère - 6 décembre 2021
- Xavier Grall – Georges Perros, Regards croisés - 21 novembre 2021
- Marie-Josée Christien, Eclats d’obscur et de lumière - 21 octobre 2021
- Yvon Le Men, La baie vitrée, Alda Merini, La folle de la porte à côté, Chantal Couliou, Du soleil plein les yeux - 6 septembre 2021
- Yeats : le poète irlandais réédité - 5 juillet 2021
- Anne-José Lemonnier, Au clavier des vagues - 20 avril 2021
- Eve Lerner, Le Chaos reste confiant - 21 février 2021
- Marie-Josée Christien, Constante de l’arbre - 6 février 2021
- François Clairambault, Les Anges sont transparents - 21 janvier 2021
- Nathan Katz, La petite chambre qui donnait sur la potence - 6 décembre 2020
- Colette Wittorski : L’immensité des liens - 31 octobre 2020
- Claude Vigée : la disparition d’un grand poète - 19 octobre 2020
- Nicole Laurent-Catrice, Pour la vie - 6 octobre 2020
- La douceur amère de l’Américaine Sara Teasdale - 19 septembre 2020
- Alain Kervern, « praticien » du haïku - 6 septembre 2020
- Marie-Claire Bancquart, De l’improbable précédé de MO®T - 21 juin 2020
- Nicolas Rouzet, Villa mon rêve - 6 juin 2020
- La vision Claire de Jacques Josse - 21 mai 2020
- Bernard Perroy et Nathalie Fréour, Un rendez-vous avec la neige - 6 mai 2020
- Le haïku face au changement climatique - 21 avril 2020
- Yvon Le Men et Simone Massi, Les mains de ma mère - 6 avril 2020
- Yves Elléouët, Dans un pays de lointaine mémoire - 21 mars 2020
- Etty Hillesum et Rainer Maria Rilke - 6 mars 2020
- Janine Modlinger, Pain de lumière - 26 février 2020
- Thierry Cazals et Julie Van Wezemael, Des haïkus plein les poches - 20 janvier 2020
- Bluma Finkelstein, La dame de bonheur - 5 janvier 2020
- Guénane, Ta fleur de l’âge - 20 décembre 2019
- Paul Guillon, La couleur pure - 6 décembre 2019
- Estelle Fenzy, La minute bleue de l’aube - 21 novembre 2019
- Jacques Rouil, Les petites routes - 6 novembre 2019
- Daniel Kay, Vies silencieuses - 25 septembre 2019
- En longeant la mer de Kyôto à Kamakura - 1 septembre 2019
- Autour de Salah Stétié - 6 juillet 2019
- Yvon Le Men : un poète à plein temps - 4 juin 2019
- Collection PO&PSY : le grand art de la forme brève - 4 juin 2019
- Fil autour de Jean-Claude Caër, François de Cornière, Jean-Pierre Boulic - 4 mai 2019
- Cécile A. Holdban : Toucher terre - 3 février 2019
- Rezâ Sâdeghpour, Yvon Le Men, Marc Baron - 4 janvier 2019
- Thierry-Pierre Clément reçoit le Prix Aliénor d’Aquitaine pour Approche de l’aube - 3 décembre 2018
- Gilles Baudry et Philippe Kohn, Roland Halbert, Xavier Grall - 3 décembre 2018
- Autour de Paol Keineg, Jean-Luc Le Cléac’h, Guy Allix et Amaury Nauroy - 5 novembre 2018
- Alexandre Romanès, Le Luth noir - 5 octobre 2018
- Le « roman » du poète Gustave Roud - 5 octobre 2018
- Japon : « Poèmes et pensées en archipel » - 6 avril 2018
- Marie-Hélène Prouteau enchante Nantes - 26 janvier 2018
- Antoine Arsan et son « éloge du haïku » - 26 janvier 2018
- Jean-Pierre Denis, Tranquillement inquiet - 26 janvier 2018
- Pierre Dhainaut, Un art des passages - 26 janvier 2018
- Jean-Marc Sourdillon La vie discontinue - 26 janvier 2018
- Jean Onimus, Qu’est-ce que le poétique ? - 26 janvier 2018
- Les méditations poétiques de Philippe Mac Leod - 14 octobre 2017
- Xavier Grall, Les Billets d’Olivier réédités - 30 septembre 2017
- Jean-Marie Kerwich, Le livre errant - 30 septembre 2017
- Mémoire d’Angèle Vannier - 30 septembre 2017
- Jean Lavoué, Ce rien qui nous éclaire - 30 septembre 2017
- Anne-Lise Blanchard, Le soleil s’est réfugié dans les cailloux - 30 septembre 2017
- Claude Albarède sur le Causse - 30 septembre 2017
- Fil de lecture : Yvon LE MEN, Guy ALLIX, Anne GOYEN, Terada TORAHIKO - 25 mars 2017
- Fil de lecture : Louis BERTHOLOM, Jean-Pierre BOULIC, Roland HALBERT. - 12 novembre 2016
- Fil de Lecture de Pierre Tanguy : Cécile HOLDBAN, Alain KERVERN, Gilles BAUDRY - 16 octobre 2016
- Denis HEUDRE : Sèmes Semés - 15 mai 2016
- Fil de Lecture de Pierre TANGUY : sur Philippe JACCOTTET et Jean-Michel MAULPOIX - 15 mai 2016
- Fil de lecture de Pierre Tanguy : sur Antonia POZZI, et SÔSEKI - 29 avril 2016
- FIL DE LECTURE de Pierre Tanguy : Grall, Jaccottet, Prouteau, Vernet, Bertholom - 8 février 2016
- Paol Keineg Mauvaises langues - 1 mars 2015
- Iraj Valipur, Zabouré Zane, femmes postmodernes d’Iran en 150 poèmes (1963–2013) - 17 février 2015
- Dorianne Laux, Ce que nous portons - 5 janvier 2015
- Sur deux recueils de Roland Halbert - 24 octobre 2014
- Andréï Tarkovski : ce qu’il nous dit de la poésie - 14 septembre 2014
- Pierre Jakez Hélias, une œuvre poétique à (re) découvrir - 31 janvier 2014
- A propos de Claude Vigée - 14 janvier 2014
- Lucia Antonia, funambule de Daniel Morvan - 23 décembre 2013
- Clin d’Yeu de Guénane - 27 novembre 2013
- Traversée de Marie-Hélène Lafon - 19 novembre 2013
- Hommage à Seamus Heaney - 18 novembre 2013
- Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie de François Cheng - 4 novembre 2013
- Le chant de la source de Fanch Peru - 26 octobre 2013
- Il fait un temps de poèmes, textes rassemblés par Yvon Le Men - 22 octobre 2013
- Chemin de feu, peinture et poésie, de Bernard Grasset - 2 octobre 2013
- Poétique de la théologie - 6 août 2013
- Littérature et spiritualité en Bretagne - 30 juillet 2013
- Sans adresse l’automne, Jean-Albert Guénégan - 16 juillet 2013
- Comme un nuage au fond des yeux, Geneviève Le Cœur - 9 juin 2013