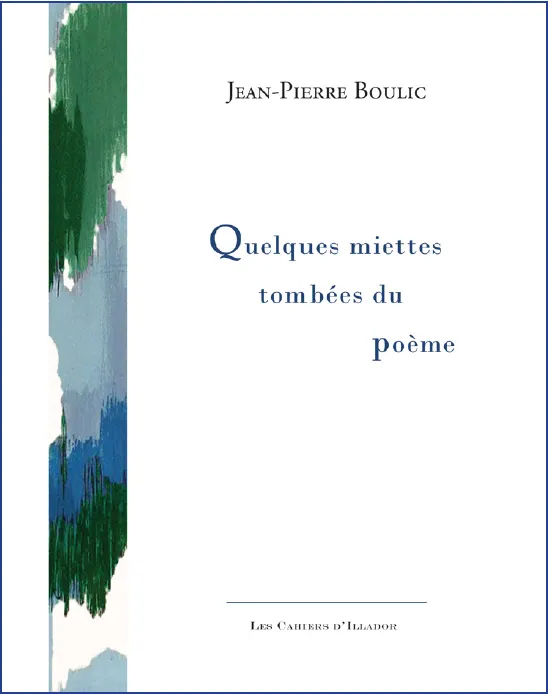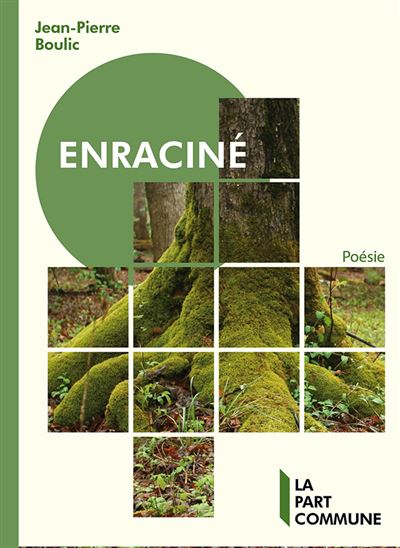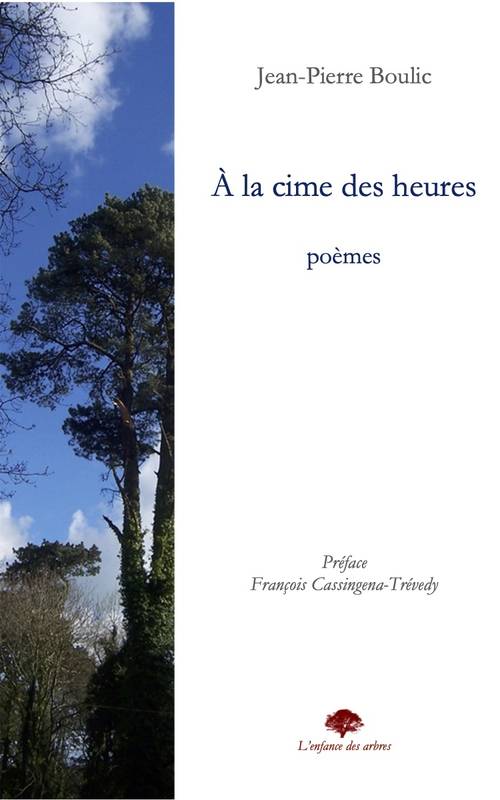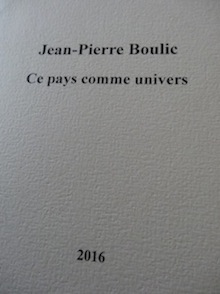Quand on est poète, que dire d’un voyage qu’on a fait au Japon ? « Je n’ai rien à raconter », nous dit Jean-Claude Caër, retour du Pays du soleil levant. « Pas d’histoires, pas d’anecdotes/Seulement des sensations diffuses, des malaises,/Une solitude appuyée ». Car son nouveau livre, en effet, est un récit fragmenté (on se gardera bien de parler de carnet de voyage) à la manière des grands maîtres de la poésie japonaise. Jean-Claude Caër se met dans leurs pas, visite à leur manière les campagnes comme les villes et n’hésite pas à se rendre sur la tombe des plus illustres d’entre eux (Saigyô, Sôseki…).

Jean-Claude Caër, Devant la mer d’Okhotsk,
Le Bruit du temps, 96 pages, 18 euros.
Et, au bout du compte, appréhende le monde comme ils le faisaient. Avec distance. Dans la contemplation des êtres et des choses.
En allant à« l’étang du bas », au « jardin des mousses », au« mont Koya », « dans une barque », « à la petite cabane »… Mais, toujours, sans trop se faire d’illusion sur un monde qui est aussi, nous dit Jean-Claude Caër, « un enfer ». Et nous reviennent en mémoire ces vers de Kobayashi Issa : « Nous marchons en ce monde/sur le toit de l’enfer/en regardant les fleurs ».
Dans la lignée de cette « impermanence » soulignée par le bouddhisme, Jean-Claude Caër nous dit encore que « tout nous échappe/Et file entre nos mains ». Et quand « la montagne fume après la pluie de la nuit », on a le sentiment d’entrevoir une estampe japonaise. L’esprit du haïku est là, aussi, quand il écrit : « 27°/Au bord de la rivière Kamo/On joue de l’éventail » ou encore ceci : « Une croix/sur un bâtiment gris/perdue dans Tokyo »
Mais au-delà de cette profonde imprégnation de la culture japonaise par l’auteur, il y a, ponctuellement, dans ce livre, un subtil va et vient entre deux mondes. Celui de l’Extrême-Orient où Jean-Claude Caër pérégrine et celui de cet Extrême-Occident où il est né (sur la côte sauvage du Nord-Finistère). Devant cette mer d’Okhotsk, au nord du Japon entre Sakhaline et Kamtchatka, à quoi pense-t-il ? A« la plage de Keremma/Couverte d’algues brunes en septembre ». Et quand il se rend aux « jardins de sable » du Daitoku-ji à Kyôto, « dans ce désert miniature à taille humaine », il pense à nouveau à cette plage de Keremma « quand la mer se retire à l’infini du sable ». A Keremma, comme devant la mer d’Okhotsk, une même sensation d’infini, de puissance brute de la nature et des éléments.
Ailleurs, voici l’auteur dans un temple où « dès l’aube quatre moines récitent les sûtras » et « où les tambours résonnent dans le monastère » ? A quoi pense-t-il ? « A ces années de collège, où nous allions à la messe avant le petit-déjeuner ». Ici, dans ce monastère, la langue lui est « inconnue » comme l’était « le latin d’Eglise ».
Ce retour par la pensée à la « terre natale » le rattache à sa mère dont il évoque la figure à plusieurs reprises et qu’il croit découvrir un jour sous les traits d’une paysanne japonaise au travail. « Je t’ai peut-être vue, penchée vers la terre,/Travailler ce matin dans les champs/Près d’Abashiri ou de Obihiro/Sous ton grand chelgenn/Dans la campagne paisible sous le soleil de mai » (ndlr : Chelgenndésigne une coiffe du Haut-Léon). Universalité du labeur paysan que l’on soit d’Abashiri ou de Plounévez-Lochrist, commune de naissance de Jean-Claude Caër.
« Mère, j’ai traversé des cercles de douleur/L’écriture et la vue de la mer me calment ». Devant la plage de Keremma comme devant la Mer d’Okhotsk
François de Cornière : Ça tient à quoi ?
« Mon émotion est toujours là./Je me demande/ça tient à quoi ?/ça tient à quoi ? » François de Cornière écrit comme il vit et vit comme il écrit. Dans la lumière des jours et parfois leur noirceur. Ses poèmes sont abonnés à la simplicité, à l’absence d’éloquence. Le poète dit « je » pour nous faire partager sa vie, mais il dit aussi « l’homme ».
Ce qui donne leur piment à ses textes, c’est cet inattendu et ce merveilleux qui se glissent dans l’ordinaire des jours et dont sait témoigner le poète. A partir d’un point minuscule, François de Cornière ouvre toujours des perspectives. Voici que, dans une salle de cinéma, il imagine (non pas la possibilité d’une île) mais la possibilité d’un poème qui serait « d’art et essai ». A un autre moment, c’est un feuillet qui glisse d’un livre de sa bibliothèque et le voici embarqué – nous avec – dans la découverte de son auteur (le poète Jean Rousselot). Comme François de Cornière le dit lui-même, il accorde sa bienveillance « à tout ce qui peut échouer dans un poème un jour » : sur une terrasse en Crête, lors d’un lever matinal, pendant une promenade nocturne, à l’écoute d’un disque de jazz… « Je poursuis ici, confie le poète, le parcours qui a été toujours le mien : celui de la vie, traversée par des instants notés au vol parce qu’ils m’ont touché ».

François de Cornière, Ça tient à quoi ?,
préface de Jacques Morin, Le Castor
astral, 198 pages, 13 euros.
Mais voilà un poète aux allures de diariste ou de nouvelliste. A tel point qu’après une lecture de ses poèmes, une femme s’est approchée de lui pour lui dire : « Pendant que vous lisiez vos textes/je me suis plusieurs fois demandé/si c’étaient des poèmes/ou de très courtes nouvelles/vous voyez ce que je veux dire ? ». François ne sait plus ce qu’il a répondu mais il se dit sûr que ses poèmes ne sont pas « de vrais beaux/ou modernes comme il faut ». On n’y trouve pas, en effet, ces images poétiques (métaphores, métonymie, analogies… ) que l’on rencontre chez la majorité des auteurs. François de Cornière en apporte la démonstration à l’écoute enthousiaste de la bande son d’un film. « C’était formidable/sans les images j’avais tout vu/tout ressenti./Je m’étais dit qu’écrire ainsi de la poésie/sans ce qui fait la poésie/serait un sacré beau défi ». Beau défi qu’il relève depuis des années, nous faisant penser à cette belle remarque du poète palestinien Mahmud Darwich : « La prose est la voisine de la poésie et la promenade du poète. Le poète est perplexe entre prose et poésie » (Présente absence, Actes Sud)
Sans rechigner, partons donc dans le sillage de ce Nageur du petit matin (La Castor Astral, 2015) qu’est François de Cornière, poète des sens en éveil, à l’écoute des battements de son cœur (surtout quand la mer est fraîche). Il témoigne, sans faillir, des « minutes noires comme des minutes heureuses », fidèle en cela à l’injonction du poète suisse Georges Haldas qu’il a eu le bonheur de rencontrer à Genève et donc il évoque, dans ce livre, la mémoire.
Avec François de Cornière, les questions, les remarques, les confidences ou les exclamations — celles qui ponctuent son livre et qui sont celles de tous les jours — ont une étonnante densité dans leur simplicité. C’est pour cela qu’elles nous touchent et peuvent, mine de rien, nous mener très loin. « Tu as vu la lune ? », « Il y a combien d’années déjà ? », « Je t’aime bien sur celle-là », « Tu crois que c’était où ? », « J’ai pas été trop longue ? », « Lui, tu le reconnais ? », « A ton avis, on a fait combien de kilomètres ? » « Cette nuit tu as parlé en dormant », « ça a passé vite », « Tu veux que je prenne le volant ?», « A quoi Tu penses ?… Eh ! Oui, tout cela « ça tient à quoi ? »
Jean-Pierre Boulic : Laisser entrer en présence
Faire advenir, accueillir, se mettre à l’écoute : il y a dans la poésie de Jean-Pierre Boulic cette inlassable « quête de signes au cœur d’un monde qui ne demande qu’à répondre » (Philippe Jaccottet). Le poète breton le manifeste dans un nouveau recueil où « joie » et « souffrance » se répondent, dans une tonalité parfois sombre quand sont évoqués l’hôpital, la maladie, la mort. Chaque fois qu’il voit « une âme livrée à la douleur ».
Mais on retrouve aussi dans ce recueil la toile de fond géographique – disons plutôt « cosmographique » — de l’œuvre de Jean-Pierre Boulic : ce pays d’Iroise, au bout du bout du Finistère, avec « le vaste grondement de l’océan », « l’haleine du large » et « les goélands parés de blanc ». Le poète est un homme du rivage, un homme du seuil, dans la lumière des saisons. Voici « l’automne écorché », « la fraîcheur d’avril », « l’été déchiré ». Et il nous dit : « Entre en présence/De ce silence/Où palpite la source/De l’inépuisable printemps ».
C’est sous ces cieux-là qu’il importe, nous dit-il, de «Converser avec/les humbles choses muettes/Bleuets capucines ». De déceler « signes » et « traces » d’un autre monde dans le monde qui nous enveloppe.

Jean-Pierre Boulic, Laisser entrer en présence,
La Part Commune, 107 pages, 13 euros
Et de se mettre à l’écoute de l’oiseau qui « grisolle » comme de la voix qui « brasille ». Jean-Pierre Boulic aime les mots qui chantent pour mieux enchanter le monde. « Tu lèves les yeux/Vers un pays irrigué » et « Ce grand ciel est d’étoiles/Miettes sans tourments ».
Le malheur peut venir écorcher cette félicité. « Il tombe des cordes depuis des heures/On enterre la jeune morte/Au bout du chemin d’herbes et de pierres ». Ailleurs le poète nous parle d’une mère « qui vacille/De laisser partir l’enfant » ou de l’hôpital « où s’entend la souffrance ». Ce qui sauve ? « La salvatrice parole de l’amitié/ Plus incisive que celle d’un bistouri ».
Jean-Pierre Boulic nous laisse alors « entrer en présence » de figures charismatiques. Celles qui ont cultivé cette amitié féconde appelée fraternité. Voici la « sœur du réconfort/Parmi les chiffons de la ville immense ». Voici Thérèse, « Inépuisable auréole/Au cœur du présent ». Voici « Tibhirine/Cet étonnant visage/D’homme aux regards sans prises/Et le cœur sans entraves ».
Rapprochant en définitive l’écriture poétique de l’exercice spirituel (ainsi que l’a défini Gérard Bocholier), Jean-Pierre Boulic peut affirmer au bout du compte : ton poème « n’est point de toi/Il est ce que dit l’indicible/Du verbe créateur ».
- Lucie Grall, C’est toi qui mènes la danse - 6 mai 2025
- Rainer Maria Rilke, Lettres à une jeune femme - 6 mai 2025
- Eve Lerner, Un tant soit peu de lumière - 5 février 2025
- Jean-Yves André, Jacques Poullaouec, Femmes de pierre - 6 janvier 2025
- Jacques Josse, Trop épris de solitude - 21 décembre 2024
- Le 30e numéro de Spered Gouez, L’esprit sauvage - 6 novembre 2024
- Antonia Pozzi, Un fabuleux silence - 6 septembre 2024
- Jean-Pierre Boulic, Quelques miettes tombées du poème - 6 mai 2024
- Joseph-Antoine D’Ornano, Instantanés sereins - 1 mars 2024
- Cécile A. Holdban, Premières à éclairer la nuit - 6 février 2024
- Estelle Fenzy, Une saison fragile - 6 janvier 2024
- Maurice Chappaz, Philippe Jaccottet : Correspondance, 1946–2009 - 21 décembre 2023
- Marina Tsvetaïeva, Après la Russie - 6 décembre 2023
- Hélène Dorion, Mes forêts - 29 octobre 2023
- Cécile A.Holdban, Toutes ces choses qui font craquer la nuit - 22 septembre 2023
- Colette Wittorski, Ephéméride - 6 septembre 2023
- Jean-Claude Coiffard, Le ciel était immense - 21 juin 2023
- Cécile A. Holdban, Kaléidoscope, Tapis de chiffons - 6 juin 2023
- Claude Serreau, Réviser pour après - 20 mai 2023
- Philippe Jaccottet, La promenade sous les arbres - 29 avril 2023
- Gérard Bessière, De lumière et de vent - 20 avril 2023
- Chantal Couliou, Instants nomades - 6 avril 2023
- Paul Verlaine, Nos Ardennes - 19 mars 2023
- Michel Dugué, Veille - 1 mars 2023
- Marie de la Tour et Taxis, Souvenirs sur Rainer Maria Rilke - 21 février 2023
- Haïkus : Du bleu en tête - 5 février 2023
- Marie-Josée Christien et Yann Champeau, Marais secrets - 24 janvier 2023
- Yvon Le Men, prix Paul-Verlaine - 29 décembre 2022
- Gustave Roud, Œuvres complètes - 29 décembre 2022
- Liza Kerivel, Nos - 21 décembre 2022
- Cypris Kophidès, La nuit traversière - 4 décembre 2022
- Alain Vircondelet : Des choses qui ne font que passer - 18 novembre 2022
- Benoît Reiss, Un dédale de ciels - 6 octobre 2022
- Anne-Lise Blanchard, L’horizon patient - 22 septembre 2022
- Le haïku face au changement climatique - 1 juillet 2022
- Carles Diaz : L’arbre face au monde - 19 juin 2022
- Alain Vircondelet, Des choses qui ne font que passer - 20 mai 2022
- Olivier Cousin, La vie à l’envers - 3 mai 2022
- Yvon Le Men, Les Epiphaniques - 20 avril 2022
- Jean-Claude Albert Coiffard, Il y aura un chant - 5 avril 2022
- John Keats : La poésie de la terre ne meurt jamais - 21 février 2022
- Jean Lavoué, Carnets de l’enfance des arbres - 21 janvier 2022
- Claude Serreau, Résurgence ou les parenthèses du soir - 28 décembre 2021
- Stefan Zweig, La Vie d’un poète - 21 décembre 2021
- Christine Guénanten, Féerique fougère - 6 décembre 2021
- Xavier Grall – Georges Perros, Regards croisés - 21 novembre 2021
- Marie-Josée Christien, Eclats d’obscur et de lumière - 21 octobre 2021
- Yvon Le Men, La baie vitrée, Alda Merini, La folle de la porte à côté, Chantal Couliou, Du soleil plein les yeux - 6 septembre 2021
- Yeats : le poète irlandais réédité - 5 juillet 2021
- Anne-José Lemonnier, Au clavier des vagues - 20 avril 2021
- Eve Lerner, Le Chaos reste confiant - 21 février 2021
- Marie-Josée Christien, Constante de l’arbre - 6 février 2021
- François Clairambault, Les Anges sont transparents - 21 janvier 2021
- Nathan Katz, La petite chambre qui donnait sur la potence - 6 décembre 2020
- Colette Wittorski : L’immensité des liens - 31 octobre 2020
- Claude Vigée : la disparition d’un grand poète - 19 octobre 2020
- Nicole Laurent-Catrice, Pour la vie - 6 octobre 2020
- La douceur amère de l’Américaine Sara Teasdale - 19 septembre 2020
- Alain Kervern, « praticien » du haïku - 6 septembre 2020
- Marie-Claire Bancquart, De l’improbable précédé de MO®T - 21 juin 2020
- Nicolas Rouzet, Villa mon rêve - 6 juin 2020
- La vision Claire de Jacques Josse - 21 mai 2020
- Bernard Perroy et Nathalie Fréour, Un rendez-vous avec la neige - 6 mai 2020
- Le haïku face au changement climatique - 21 avril 2020
- Yvon Le Men et Simone Massi, Les mains de ma mère - 6 avril 2020
- Yves Elléouët, Dans un pays de lointaine mémoire - 21 mars 2020
- Etty Hillesum et Rainer Maria Rilke - 6 mars 2020
- Janine Modlinger, Pain de lumière - 26 février 2020
- Thierry Cazals et Julie Van Wezemael, Des haïkus plein les poches - 20 janvier 2020
- Bluma Finkelstein, La dame de bonheur - 5 janvier 2020
- Guénane, Ta fleur de l’âge - 20 décembre 2019
- Paul Guillon, La couleur pure - 6 décembre 2019
- Estelle Fenzy, La minute bleue de l’aube - 21 novembre 2019
- Jacques Rouil, Les petites routes - 6 novembre 2019
- Daniel Kay, Vies silencieuses - 25 septembre 2019
- En longeant la mer de Kyôto à Kamakura - 1 septembre 2019
- Autour de Salah Stétié - 6 juillet 2019
- Yvon Le Men : un poète à plein temps - 4 juin 2019
- Collection PO&PSY : le grand art de la forme brève - 4 juin 2019
- Fil autour de Jean-Claude Caër, François de Cornière, Jean-Pierre Boulic - 4 mai 2019
- Cécile A. Holdban : Toucher terre - 3 février 2019
- Rezâ Sâdeghpour, Yvon Le Men, Marc Baron - 4 janvier 2019
- Thierry-Pierre Clément reçoit le Prix Aliénor d’Aquitaine pour Approche de l’aube - 3 décembre 2018
- Gilles Baudry et Philippe Kohn, Roland Halbert, Xavier Grall - 3 décembre 2018
- Autour de Paol Keineg, Jean-Luc Le Cléac’h, Guy Allix et Amaury Nauroy - 5 novembre 2018
- Alexandre Romanès, Le Luth noir - 5 octobre 2018
- Le « roman » du poète Gustave Roud - 5 octobre 2018
- Japon : « Poèmes et pensées en archipel » - 6 avril 2018
- Marie-Hélène Prouteau enchante Nantes - 26 janvier 2018
- Antoine Arsan et son « éloge du haïku » - 26 janvier 2018
- Jean-Pierre Denis, Tranquillement inquiet - 26 janvier 2018
- Pierre Dhainaut, Un art des passages - 26 janvier 2018
- Jean-Marc Sourdillon La vie discontinue - 26 janvier 2018
- Jean Onimus, Qu’est-ce que le poétique ? - 26 janvier 2018
- Les méditations poétiques de Philippe Mac Leod - 14 octobre 2017
- Xavier Grall, Les Billets d’Olivier réédités - 30 septembre 2017
- Jean-Marie Kerwich, Le livre errant - 30 septembre 2017
- Mémoire d’Angèle Vannier - 30 septembre 2017
- Jean Lavoué, Ce rien qui nous éclaire - 30 septembre 2017
- Anne-Lise Blanchard, Le soleil s’est réfugié dans les cailloux - 30 septembre 2017
- Claude Albarède sur le Causse - 30 septembre 2017
- Fil de lecture : Yvon LE MEN, Guy ALLIX, Anne GOYEN, Terada TORAHIKO - 25 mars 2017
- Fil de lecture : Louis BERTHOLOM, Jean-Pierre BOULIC, Roland HALBERT. - 12 novembre 2016
- Fil de Lecture de Pierre Tanguy : Cécile HOLDBAN, Alain KERVERN, Gilles BAUDRY - 16 octobre 2016
- Denis HEUDRE : Sèmes Semés - 15 mai 2016
- Fil de Lecture de Pierre TANGUY : sur Philippe JACCOTTET et Jean-Michel MAULPOIX - 15 mai 2016
- Fil de lecture de Pierre Tanguy : sur Antonia POZZI, et SÔSEKI - 29 avril 2016
- FIL DE LECTURE de Pierre Tanguy : Grall, Jaccottet, Prouteau, Vernet, Bertholom - 8 février 2016
- Paol Keineg Mauvaises langues - 1 mars 2015
- Iraj Valipur, Zabouré Zane, femmes postmodernes d’Iran en 150 poèmes (1963–2013) - 17 février 2015
- Dorianne Laux, Ce que nous portons - 5 janvier 2015
- Sur deux recueils de Roland Halbert - 24 octobre 2014
- Andréï Tarkovski : ce qu’il nous dit de la poésie - 14 septembre 2014
- Pierre Jakez Hélias, une œuvre poétique à (re) découvrir - 31 janvier 2014
- A propos de Claude Vigée - 14 janvier 2014
- Lucia Antonia, funambule de Daniel Morvan - 23 décembre 2013
- Clin d’Yeu de Guénane - 27 novembre 2013
- Traversée de Marie-Hélène Lafon - 19 novembre 2013
- Hommage à Seamus Heaney - 18 novembre 2013
- Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie de François Cheng - 4 novembre 2013
- Le chant de la source de Fanch Peru - 26 octobre 2013
- Il fait un temps de poèmes, textes rassemblés par Yvon Le Men - 22 octobre 2013
- Chemin de feu, peinture et poésie, de Bernard Grasset - 2 octobre 2013
- Poétique de la théologie - 6 août 2013
- Littérature et spiritualité en Bretagne - 30 juillet 2013
- Sans adresse l’automne, Jean-Albert Guénégan - 16 juillet 2013
- Comme un nuage au fond des yeux, Geneviève Le Cœur - 9 juin 2013